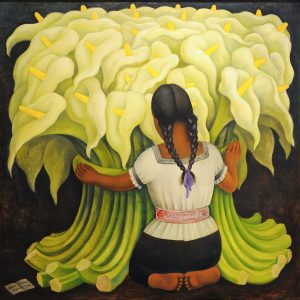Début 2016, des personnalités, des partis, associations, syndicats et organisations décidèrent de créer un Collectif Ni Guerres Ni Etat de Guerre. Il s’agissait de changer de perspective, à la suite des attentats qui avaient frappé la France fin 2015, et de poser la question : dans cette affaire, qui est vraiment l’agresseur ? Par exemple la France, qui bombarde l’Irak depuis tant d’années et la Syrie depuis septembre 2015 ?
Il s’agissait de mettre en lumière ce qui est passé sous silence ou mentionné comme de simples faits divers, c’est-à-dire les agressions impérialistes commises par la France. Dans un meeting du 15 janvier 2015, qui fut le point de départ du collectif antiguerre, Christine Delphy déclarait :
La France bombarde, en tant que membre d’une coalition comprenant les USA, l’Arabie Saoudite, le Qatar et quelques autres Etats du Golfe.
Or personne du gouvernement, ni le chef de l’Etat ni le premier ministre, ni aucun socialiste ne l’a dit ou laissé entendre.
Certes on ne peut pas effacer complètement les mots que l’un des témoins de l’attaque du Bataclan a entendu prononcer par un assaillant : « Nous sommes ici pour venger les gens que vous tuez en Syrie ». Mais ce propos ne donne lieu à aucun commentaire, ni d’un politique, ni d’un journaliste. Un propos de barbare n’est pas une parole, c’est un son inarticulé, un grognement de bête, un bruit.
La presse a bien mentionné le début des bombardements de Daech par la France en septembre—mais comme un fait divers. Cela n’a pas retenu l’attention. A cause de la façon discrète de présenter ces bombardements mais aussi parce qu’on s’est habitué à ce que la France fasse régner l’ordre dans son ex-empire colonial. Et la France bombarde, et commet des « homicides ciblés » dans tout le Sahel, depuis janvier 2013 sans que personne ne batte une paupière.
Pour quoi ? Dans quel but ? Avec quelles justifications ? Là est la question, non seulement en ce qui concerne la « vengeance » du Bataclan, mais toutes les autres « OPEX » – opérations extérieures menées depuis janvier 2013. Serval 1 puis Serval 2 au Mali, transformé en « Barkhane » – pour faire croire qu’il ne s’agit pas de la même chose, et cacher que, selon un militaire, « on est là pour longtemps » ; Sangaris en Centrafrique – une opération « humanitaire » censée éviter les massacres inter-religieux qui n’évite rien du tout ; Chammam à Djibouti, dont personne n’a entendu parler ; l’entrée dans la coalition anti-Daech en 2014, dont personne n’a entendu parler non plus, car il faut préserver le mensonge que la France agit seule, comme une grande.
Il s’agissait également de combattre l’état d’urgence (devenu permanent) sous le prétexte que la « France était en guerre ». Mais nous sommes en France et c’est donc en France que nous pouvons nous battre en priorité contre « notre » propre impérialisme : cette déclaration fondatrice du Collectif est plus que jamais d’actualité et fait regretter que le Collectif ait disparu à la veille de la guerre d’Ukraine…
Je publie ici deux textes parus dans le Bulletin du collectif, « Guerre et cadavres » (mars 2018) (voir rubrique La guerre des démocraties) et « Des écoles pas de canon, pas de canon dans les écoles » (octobre 2016).
__________________________________________________________________
A l’heure où les dépenses militaires de la France augmentent et où l’école et l’université manquent de moyens, il n’est pas sans intérêt de se pencher sur les relations entre l’Armée et l’Education nationale.
Un nouveau protocole (le cinquième) a été signé en mai 2016 entre les ministères de l’Education nationale, de l’Agriculture et de la Défense : il vise à enseigner à la jeunesse scolaire et universitaire « l’esprit de défense et de sécurité ». Qu’en est-il ?
L’idée d’enseigner à l’école « l’esprit de défense » a germé dans la tête de Charles Hernu en 1982, alors qu’il était ministre de la Défense[1]. Six ans après la suppression du service militaire, il s’agissait de mettre l’école à contribution pour sensibiliser ses élèves à « l’esprit de défense ». La formation des enseignants dans cette perspective est apparue en 1989 et l’intégration de cette notion dans les programmes en 1995.
Le nouveau protocole de 2016 approfondi la coopération Armée – Ecole et l’étend à l’enseignement primaire et à l’enseignement supérieur ainsi qu’à la recherche. Mais surtout, il explicite une orientation nouvelle qui correspond aux doctrines récentes en matière d’utilisation des forces armées.
L’implication directe de l’Ecole dans la chose militaire repose sur une analyse du changement des menaces auxquelles le pays doit faire face. On peut ainsi trouver dans les textes des deux ministères, Défense et Education, l’idée qu’après la fin de la guerre froide, où la menace était précise et relevait essentiellement d’une préparation des forces armées, s’est ouverte une époque où les menaces sont multiples et diffuses : terrorismes, possibilité d’attaques déloyales contre la substance économique d’une nation ouverte par la mondialisation de l’économie, risques pesant sur l’approvisionnement en énergie et l’environnement, cyberattaques, etc.
L’idée principale ici est que le seul instrument militaire ne suffit pas à affronter ces menaces : il faut une implication de tous les citoyens, qui doit se préparer dès l’école (et désormais dès l’école primaire).
Cette nouvelle doctrine, issue des thèses nord-américaines, consiste à relier, voire à fusionner la sécurité extérieure et la sécurité intérieure. Elle est exposée dans le dernier Livre blanc de la Défense (2008) qui devient significativement Livre blanc de la Défense et de la Sécurité nationale.
L’unification des tâches de sécurité, externe et interne, a deux conséquences désormais bien visibles : l’armée se voit confier des tâches de police tandis que la police se militarise. Mais surtout, l’idée s’installe dans les esprits qu’il ne s’agit plus de défendre un territoire contre un ennemi extérieur, mais de faire face à des dangers intérieurs sans cesse rappelés dans les discours officiels (« nous sommes en guerre ») et dans la pratique avec un état d’urgence plusieurs fois reconduits.
Or, cette « sécurité nationale » ou « sécurité intérieure » est une notion bien floue, qui a été introduite dans la doctrine militaro-policière, et aujourd’hui dans les programmes scolaires, sans aucun débat public, ni dans la société, ni au parlement. Pas plus que la guerre extérieure, la guerre intérieure ne mérite donc délibération politique !
D’autres notions tout aussi vagues, telles que « cohésion nationale » ou même « valeurs de la République[2] », viennent s’y ajouter pour former un ensemble d’injonctions destinées à façonner les esprits et à justifier la répression à l’encontre d’ennemis eux bien précis : les musulmans ou réputés tels, les classes populaires, les mouvements sociaux.
Autre mot fétiche, la résilience.
La résilience nationale est définie comme « la volonté et la capacité d’un pays, de la société ou des pouvoirs publics à résister aux conséquences d’une agression ou d’une catastrophe majeures, puis à rétablir rapidement leur capacité de fonctionner normalement, ou à tout le moins dans un mode socialement acceptable ».
Ce qui est important ici, c’est la nécessité d’impliquer l’ensemble de la population, notamment en cas de menace d’un ennemi intérieur : l’école se voit attribuer le rôle de l’y préparer.
Ces notions floues, « résilience », « cohésion », « engagement » servent à enfumer et à atténuer les effets d’une politique qui ne serait pas pour l’heure « socialement acceptable ». On pourrait traduire la citation précédente ainsi : des grèves avec occupation se multiplient, des blocages s’étendent, l’essence manque, les poubelles s’entassent, la jeunesse des quartiers populaires entrent en action, le chef du patronat traite les grévistes et les jeunes de terroristes. Le gouvernement estime que la cohésion nationale est menacée, que la Nation est atteinte, et donc les valeurs de la République, et il en appelle à la résilience. Il a bien préparé les choses : de la maternelle à l’université, les enseignants ont été conviés à préparer les élèves à se mobiliser pour « faire fonctionner normalement » le pays, dans un « mode socialement acceptable » (par exemple en faisant primer la sécurité sur la démocratie). Des trinômes académiques (constitués de représentants des ministères de la Défense et de l’Education, et de l’Institut des hautes études de la défense nationale) existent partout sur le territoire et ont constitué des relais comme les y invite le protocole de 2016.
Bien sûr, pour l’instant, le pouvoir ne peut énoncer de telles perspectives : mais il prépare les esprits. Le noyau dur de la mobilisation des esprits, de la résilience, est quant à lui bien précisé : c’est l’armée.
Le protocole l’exprime ainsi :
« L’enseignement de défense et de sécurité nationale, conçu en lien avec la formation à la citoyenneté, est centré sur la défense militaire, qui lui confère sens et visibilité, et concerne l’ensemble des disciplines.
Il permet aux élèves de :
– percevoir concrètement les intérêts vitaux ou nécessités stratégiques de la Nation, à travers la présence ou les interventions militaires qu’ils justifient ;
– comprendre le cadre démocratique de l’usage de la force et de l’exercice de la mission de défense dans l’État républicain ;
– appréhender les valeurs inhérentes au métier militaire, à partir de l’étude des aspects techniques. »
L’école est ainsi appelée à expliquer et à justifier les guerres que l’impérialisme français conduit dans plusieurs régions.
Un témoignage (datant de 2015, donc dans le cadre du protocole précédent) montre jusqu’où peut aller l’intrusion de l’armée dans l’école. Dans l’académie de Clermont-Ferrand, les enseignants ont été conviés à une journée de formation sur le thème de la défense nationale pour préparer une action en classe de troisième.
L’expérience est ainsi relatée dans un blog de Mediapart[3], nous citons :
« La pédagogie mise en œuvre fait l’objet d’un hallucinant powerpoint dans un premier temps mis en ligne sur le site de l’académie avant d’en être retiré. Extraits :
« Diviser la classe en cinq groupes. Expliquer à chaque groupe qu’il constitue un ennemi impitoyable de la France et qu’il doit mener une attaque contre cette dernière en 2015. Question : comment allez-vous procéder ? [Après] un temps d’échange entre les élèves, chaque groupe vient devant la classe expliquer sa stratégie. »
Dans le cadre de l’inévitable étude de cas, les élèves s’intéressent ensuite au nouveau véhicule blindé VBCI ; un petit film de Giat Industrie leur permet d’arriver à cette trace écrite dont on mesure toute la sagacité : « l’armée française effectue ses missions à l’étranger, il est important d’être bien accepté par les populations locales. Le fait que le VBCI soit pourvu de roues et non de chenilles y contribue » (sic). Histoire, sans doute, de faire oublier par lesdites populations locales les soupçons d’abus sexuels dont sont accusés certains militaires…
Bien sûr, on veillera à « privilégier la mise en activité des élèves avec des partenaires extérieurs (…) : le délégué militaire départemental, le 92e RI, la réserve, le centre d’information et de recrutement des forces armées etc. »
7 octobre 2016
-
Jusqu’à sa démission en 1985 suite à l’affaire du Rainbow Warrior, le bateau de Greenpeace dynamité à Auckland par une opération de commando préparée avec Mitterrand, et qui a coûté la vie au photographe Fernando Pereira. ↑
-
Souvent réduites à une seule, la laïcité, qui elle-même a brutalement changé de sens, puisqu’elle s’applique désormais aux individus. ↑
-
Le blog de B. Girard : https://blogs.mediapart.fr/b-girard/blog/161015/leducation-morale-et-civique-ca-sert-aussi-faire-la-guerre ↑