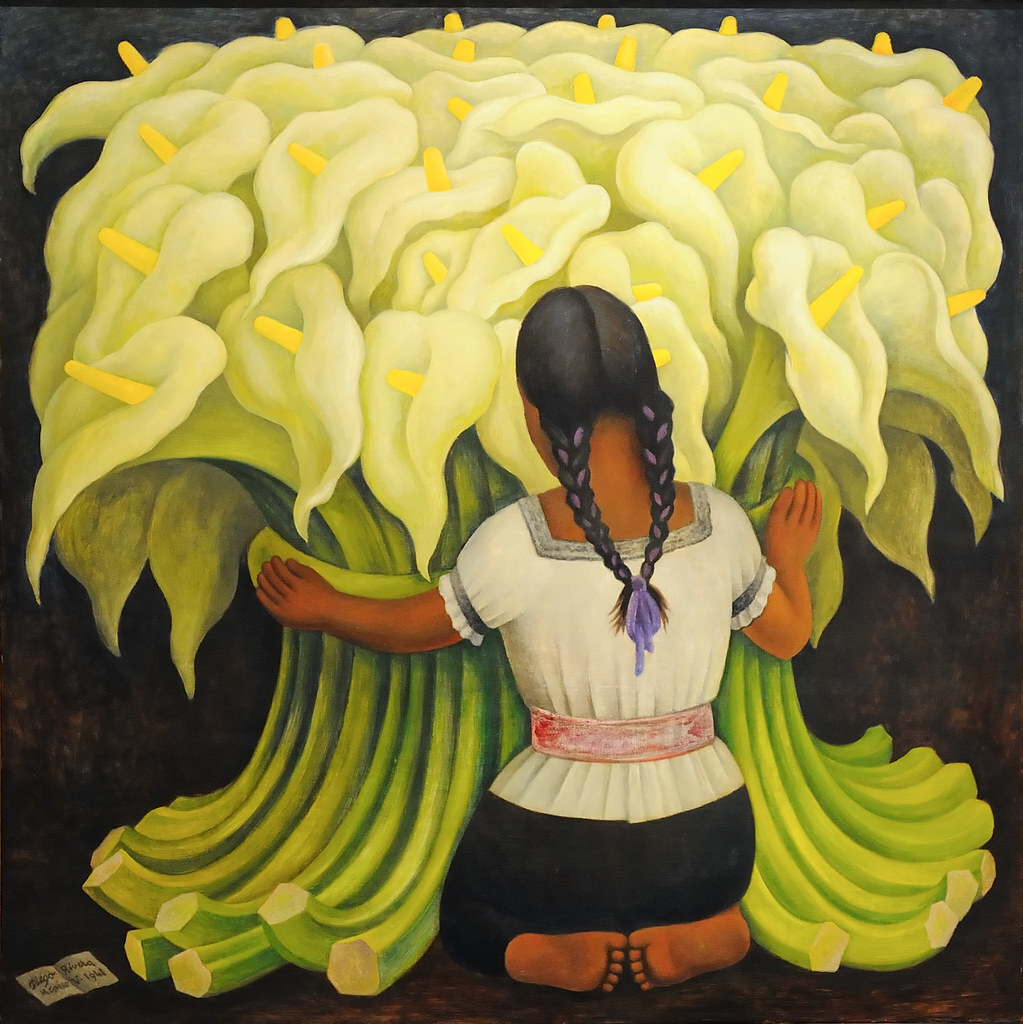Présentation générale du site danarkeo.fr
A la mémoire de quatre camarades et amies récemment disparues, qui ont su tenir bon, et dont la fougue n’avait d’égale que la fidélité à nos principes
Madjiguène Cissé
Josefina Clave
Catherine Grupper
Lodie Mansour
Les textes rassemblés dans ce site d’archives ont été écrits de mai 1981 à nos jours. Leur publication ne cherche pas à remâcher le passé, mais à atteindre le cœur du présent où fusionnent et macèrent les éléments méphitiques semés pendant ces quarante dernières années pour composer un monde de crises et de guerres qui laisse le mouvement ouvrier sans voix, sans tête et sans muscle.
Les plus anciens de ces textes donnent à voir les multiples facettes d’un capitalisme qui avait repris l’offensive au tournant des années 80, avec de nouvelles méthodes. Comme souvent, la France a offert un tableau chimiquement pur du cours de l’histoire : alors qu’ailleurs la contre-offensive fut conduite par de grandes et sinistres figures de la droite radicale, en France le sale travail fut orchestré par la gauche et par ses satellites d’extrême-gauche. Au moins, cette infamie donnait à voir la source de tous les maux qui ont démoralisé, désorganisé et anémié la classe ouvrière depuis plus d’un demi-siècle. A savoir : l’abandon du communisme au nom d’une supériorité du capitalisme, présenté comme le seul régime offrant liberté et démocratie au prix de quelques défauts qu’on tentera de corriger. Même chez ceux qui se réclament encore du communisme, la voie concrète pour passer de l’idéal à la réalité fait l’objet d’une véritable détestation, toujours au nom de la liberté et de la démocratie, et qui tient en une phrase rassurante : je suis communiste, mais pas stalinien. La formule trahit le mal profond qui a corrompu le mouvement communiste[1] et l’a conduit à « fuir l’histoire » selon l’expression de Domenico Losurdo. En rayant d’un trait un demi-siècle de construction du socialisme, les « communistes antistaliniens » gommaient par magie un extraordinaire processus de luttes, de contradictions, de flux et de reflux, de succès et d’échecs, s’interdisant à tout jamais d’appréhender les problèmes concrets que nous devons résoudre et que nous pourrions résoudre grâce à la riche expérience de la révolution bolchévique. Fuir l’histoire, c’est aussi fuir le présent. Triomphe alors le règne de l’apolitisme, où fleurissent des programmes politiques sans que jamais ne soient précisées les conditions de leur réalisation. En fin de compte, cette capitulation s’est traduite inéluctablement par un renoncement à toute théorie révolutionnaire, à toute stratégie émancipatrice, à toute organisation de classe.
Les textes présentés ici furent écrits pour tenter de construire et de tenir une « ligne générale » pendant cette trop longue période de reflux. Ils peuvent peut-être contribuer à se déprendre de ce passé délétère pour agir et reprendre l’offensive : tel est notre espoir.
Le choix des premiers textes ne doit rien au hasard. La fin des années 70 ouvre en effet une période où débute le sinistre cycle de la réaction dite « néo-libérale », qui fut en France pleinement marqué par l’élection de François Mitterrand à la présidence en mai 1981.
Le capital reprenait l’offensive, après que le système eut, dans les années 60 et 70, rencontré partout des difficultés, de la « zone des tempêtes » jusqu’au cœur des métropoles. Les crises monétaires se succèdent, le pillage néocolonial se heurte à des oppositions croissantes et variées, les chocs pétroliers de 1973 et 1979 amplifient une inflation qui perturbe considérablement les circuits financiers. Les luttes de libération nationale trouvent un écho au cœur des métropoles impérialistes, enflammant une jeunesse dont la révolte peut parfois déclencher le soulèvement de l’ensemble de la classe ouvrière (comme en mai-juin 68 en France).
Pour reprendre la main, les groupes dirigeants des principaux pays capitalistes lancèrent à la fin des années 70 une contre-offensive dite « néo-libérale », dont le succès ne pouvait être assuré qu’à deux conditions : d’un côté, une intervention massive des Etats qui devaient établir de nouvelles règles favorables à la domination du capital financier, et de l’autre une désintégration du mouvement révolutionnaire, au Nord comme au Sud. Au-delà de l’élimination du communisme, l’objectif était d’en finir avec la possibilité même du réformisme et de mettre un terme aux compromis entre le capital et le travail qui avaient jalonné les années 20 à 70. Par un tour de passe-passe, l’étiquette « réformiste » devint l’apanage de la réaction, qui présenta de la sorte sa camelote rétrograde en qualifiant tout opposant de « conservateur ».
Il va sans dire que la gauche mitterrandienne devait briller dans cet exercice de magie noire qui eut pour effet d’anesthésier pour longtemps le mouvement ouvrier. Son talent n’eut d’égal que l’urgence qui la poussait à agir pour aligner la France sur la stratégie du nouvel ordre « libéral ». En effet, le pays affichait un retard désespérant pour un capital financier en appétit de contre-réformes. La cause résidait dans la vitalité d’un mouvement ouvrier qui, déçu par les maigres résultats des puissantes grèves de mai-juin 68, continua le combat tout au long de la décennie 70, remportant souvent de belles victoires.
Si l’on garde en mémoire cette mobilisation, on mesure l’ampleur de la régression inaugurée par le premier septennat de Mitterrand. Sous la houlette du vieux maurassien, la gauche permit à l’Etat français de rattraper le retard et de rejoindre le Royaume Uni de Thatcher (1975), les USA de Reagan (1980) et l’Allemagne du camarade socialiste Helmut Schmidt (1974) dont Mitterrand vénérait le fameux théorème : les profits d’aujourd’hui sont les investissements de demain et les emplois d’après-demain.
Avec l’élection de François Mitterrand, le tournant néo-libéral prit la figure politique singulière de l’Union de la gauche et de ses satellites de l’extrême gauche. Ainsi, cette gauche qui voulait « changer la vie » a-t-elle plébiscité un vieux politicien réactionnaire, qui avait chassé le « métèque » dans sa jeunesse au quartier latin, ancien collabo, ami fidèle du chef de la police vichyste Bousquet, un colonialiste, sioniste, va-t’en guerre, soutien indéfectible de l’impérialisme états-unien. Un politicien qui, après les années d’errement de la collaboration, effectua son retour en politique grâce à l’extrême droite, avec laquelle il a toujours entretenu des liens étroits. Ne furent aveugles que ceux qui fermèrent les yeux. C’est dans la Nièvre que Mitterrand a savouré sa victoire en mai 81, parce que c’est dans la Nièvre que trente-cinq ans plus tôt il est revenu en politique (novembre 46), en se présentant sous le drapeau du groupe « Action et Unité républicaine », qui affichait pour tout programme : « contre la bolchévisation de la France, amnistie des collabos au nom d’une unité nationale soudée par le péril communiste ». C’est donc dans la Nièvre que le monsieur « l’Algérie c’est la France » envoie à ses nouveaux amis de la gauche et de l’extrême gauche le message qu’ils devront boire le calice jusqu’à la lie puisqu’il n’a rien renié.
Pourtant, la gauche et ses satellites ne vécurent pas cette union sacrée comme un supplice. Leur ralliement ne fut pas arraché dos au mur, sous le prétexte de « barrer la route au péril brun » comme cela fut claironné plus tard pour ramper devant Chirac ou Macron. L’adhésion fut assumée dans la joie et l’enthousiasme, voire dans une humeur révolutionnaire qui faisait dire à des militants égarés qu’un disciple de Barrès conduirait le peuple français dans la voie du progrès et, pourquoi pas, du socialisme. Les dégâts d’une telle posture furent immenses. Ils se payent aujourd’hui si cher qu’il n’est pas vain d’en chercher le ressort intime.
En mai 1981, nous constations que l’élection présidentielle mettait fin à la période de l’après-68, période où fut tentée en vain la création d’un mouvement révolutionnaire extra-parlementaire, c’est-à-dire indépendant des partis de pouvoir, libéré de tout agenda électoral et fondé sur une analyse marxiste-léniniste de l’Etat. Mais nous n’avions pas encore entrevu que cet échec viendrait clore un cycle plus long, au cours duquel la révolution était encore à l’ordre du jour avec l’une de ses conditions essentielles, l’élaboration d’une théorie révolutionnaire. Pour entraver la première, il fallait liquider la seconde, à savoir le marxisme-léninisme. Enoncer de tels propos peut paraitre incongru aujourd’hui. Pourtant, la cible fut clairement désignée dès le lendemain de l’élection présidentielle.
Le 29 juin, Jean Daniel écrivait dans son éditorial du Nouvel Obs : « Mitterrand s’est donné comme dessein d’extirper le léninisme du mouvement ouvrier français et d’effacer, en somme, le Congrès de Tours ». Dans sa première grande interview accordée après son élection, Mitterrand déclarait : « Entre le marxisme-léninisme et notre socialisme, je veux dire entre Lénine et Blum, le conflit idéologique n’a pas cessé. Aucun moment d’inattention ne nous sera permis » (Le Monde du 2 juillet 1981).
Ces bravades du nouveau président pourraient laisser croire qu’une bataille idéologique enflammée opposait alors le marxisme-léninisme et le réformisme. Or, cet affrontement appartenait à la période précédente. Derrière la cible d’une théorie révolutionnaire moribonde qu’il fallait à tout prix empêcher de renaître, se profilait le véritable but du moment, liquider tout projet réformiste. Avec le « néo-libéralisme », le temps des réformes et des compromis prend fin. Effacer le Congrès de Tours signifiait gommer non seulement Thorez, mais aussi Blum.
La période ouverte par 1981 allait modifier en profondeur les conditions de la lutte. Finies les controverses autour de la stratégie, terminé le débat entre réformisme et révolution, dépassées les discussions théoriques et idéologiques sur le capitalisme, l’impérialisme et l’Etat bourgeois. Désormais, le mouvement devait regagner l’enclos des luttes défensives, dos au mur, sans perspective et conduites uniquement en réaction aux décisions réactionnaires d’un pouvoir qui paraît agir en roue libre.
Cette destruction de la politique n’a rien de spontané. Liquider à ce point toute idée de programme, de stratégie et d’organisation résulte d’un effort colossal de l’Etat bourgeois qui sait miner et contenir le mouvement populaire avec une science qui lui fait défaut dans sa conduite calamiteuse de l’économie. Le succès de cette entreprise de dévoiement n’aurait pu être assuré si le mouvement communiste n’avait pas été ruiné de l’intérieur. Lénine avait montré que le parti ouvrier bourgeois, autrefois l’exception, était devenu inévitable et typique dans tous les pays impérialistes, où l’immense butin amassé sur le dos des peuples du Sud ruisselle sur la métropole pour y former une couche privilégiée du prolétariat, sensible au compromis et parfois à l’union sacrée avec l’Etat bourgeois. Lénine avait indiqué que l’opportunisme (composé des courants qui détournent la classe ouvrière de son objectif révolutionnaire) formait le plus solide rempart pour assurer la survie du capitalisme. C’est pourquoi il n’a cessé de proclamer que la lutte contre l’impérialisme, si elle n’est pas indissolublement liée à la lutte contre l’opportunisme, « est une phrase vide et mensongère ».
La mue contre-révolutionnaire des partis communistes des pays impérialistes n’aurait pas été si radicale sans la régression du pays de la révolution d’Octobre. Le puissant point d’appui du mouvement communiste international allait se transformer en son contraire sous la houlette de Nikita Khrouchtchev, et optait pour une stratégie contre-révolutionnaire – « révisionniste » comme on le disait à l’époque, dans le sens traditionnel de révision du marxisme-léninisme. Le grand nettoyage fut opéré à l’échelle mondiale, à travers une lutte d’une petite dizaine d’années au sein du mouvement communiste international, opposant principalement les partis communistes chinois et albanais (Parti du Travail) à Khrouchtchev et à la direction du PCUS (ainsi qu’à celles des grands partis suivistes, comme les partis français et italiens).
Il suffit de rappeler en quelques mots les thèmes de ce débat pour saisir l’ampleur de la défaite idéologique qui a emporté le mouvement révolutionnaire dans le précipice : réformisme ou révolution, passage au socialisme par la voie pacifique ou non, question de la guerre et de la paix, le colonialisme et l’impérialisme ont-ils changé de nature, le social-chauvinisme, le racisme, le nationalisme, le socialisme, la dictature du prolétariat, etc.
De ces milliers de pages de polémique consacrées à débattre de questions vitales pour le sort de la révolution, et en fin de compte de toute lutte, nous retiendrons deux points clés : la question de l’internationalisme prolétarien et celle du pouvoir. Ces questions sont intrinsèquement liées. Le chauvinisme, plaçant le mouvement ouvrier sous la tutelle de l’Etat impérialiste dont il ne peut s’émanciper, est conduit à interdire toute stratégie de prise du pouvoir pour détruire le monde ancien et construire la société nouvelle.
Le mouvement est ainsi soumis à ce que Lénine appelait la conception libérale de la lutte de classe. « Le libéralisme, écrivait-il en 1913, est prêt à reconnaître la lutte de classe jusque dans le domaine de la politique, mais à une condition : que l’organisation du pouvoir d’Etat ne fasse pas partie de son champ d’action »[2].
Après 1981, les militants révolutionnaires devaient aborder la nouvelle situation avec de sérieux handicaps. Il fallait surmonter l’isolement (nous étions « sans parti ») et l’éparpillement pour affronter des tâches nouvelles pour nous : un travail d’analyse, le plus systématique possible, pour décortiquer tous les aspects de la politique en cours et en révéler la nature profondément réactionnaire sous la phrase de gauche, tout cela dans la perspective de construire une théorie de la révolution en France.
Ces difficultés propres à la nouvelle conjoncture plongent leurs racines dans une situation que nous n’avons jamais pu dépasser, un problème que nous n’avons pu résoudre. Au cours des années 60-70, la seule lutte idéologique ne pouvait suffire à l’emporter dans le combat livré contre un PCF voué à réviser le marxisme et à liquider le marxisme-léninisme. Pour convaincre les adhérents de ce parti et, au-delà les militants du mouvement ouvrier, il aurait fallu édifier une force apte à tracer concrètement, politiquement, la voie de la révolution en France. Cette tâche ne put être accomplie (entre autres parce que l’extrême gauche tout entière était frappée d’inaptitude politique). Dès lors, nous devions côtoyer dans les luttes des militants du PC de grande valeur, sincèrement désireux d’abattre le capitalisme, persuadés parfois qu’ils œuvraient pour la révolution prolétarienne, et avec qui nous partagions le même « désir de communisme » et la même conviction de la nécessité d’un parti, mais que nous devions en même temps critiquer et parfois combattre parce que porteurs d’une ligne qui s’éloignait de la révolution, et qui tôt ou tard les conduirait d’échec en échec. Nous avions hélas raison sur ce dernier point, sans que la décomposition du PCF et de ses satellites ne laissât place à ce qui était et reste le cœur de notre combat, l’édification d’un authentique parti communiste.
Assumer des activités d’analyse, de propagande, voire de théorie, était nouveau pour nous qui étions de simples militants. Une certaine publicité en a été donnée, avec la création de deux revues, d’abord L’Emancipation (1979-1983) puis La Voie du socialisme (1987-1990)[3], où plusieurs textes de ce site ont été publiés. Ces publications n’ont été possibles que grâce à un travail collectif de grande ampleur, nécessitant des échanges, des discussions, des controverses incessantes.
Parallèlement, l’activité de notre petit groupe se déployait dans deux directions : issus du mouvement marxiste-léniniste (et pour la plupart d’entre nous du PCMLF), nous avons assisté avec tristesse mais sans surprise à la dissolution de ce mouvement et à son éparpillement. Nous avons tenté de discuter avec tous les petits groupes marxistes-léninistes qui se sont formés ici ou là, dans le but de reconstituer une unité du mouvement autour de l’élaboration d’une stratégie révolutionnaire. Nous avons parfois fait un bout de chemin avec tel ou tel, mais en fin de compte, cette tâche a échoué. Cette partie de notre activité des années 80 à 2000 n’est pas relatée ici.
La deuxième direction nous a conduits à nous engager autant que possible dans les combats anticapitalistes et anti-impérialistes qui, à nos yeux, une fois passée la paralysie de 1981, n’allaient pas manquer de trouver une nouvelle vigueur. Certains textes présentés ici sont liés à ces engagements, en particulier contre les guerres impérialistes des années 90 ou pour le mouvement des sans-papiers après 1996.
Nos forces étaient limitées, si bien que beaucoup d’aspects du monde que nous voulons changer ne sont pas analysés, même s’ils ont fait l’objet de discussions. Par ailleurs, ne figurent dans ces archives que les articles que j’ai rédigés, alors que bien d’autres sujets ont été abordés par d’autres camarades dans nos publications (notamment sur les colonies et les néo-colonies, les questions économiques, sociales et politiques, etc.). Enfin, nous puisons aussi notre inspiration dans des mouvements qui produisent des analyses précieuses et robustes, qui sont autant de pierres à l’édifice bâti en commun – je citerai par exemple Survie, l’USTKE, le PIR puis le QG décolonial.
Ma dernière activité militante fut de participer à la constitution et à l’animation du Collectif ni guerres ni état de guerre début 2016. L’élaboration de sa plate-forme, fruit d’intenses échanges, fut un acte politique important dans le cours du mouvement anti-impérialiste – nous le devons entre autres à Christine, Houria, Ludivine, Nils. Malgré ses forces modestes, le Collectif déploya une activité soutenue, grâce au travail de militants décidés et énergiques, avec qui j’ai beaucoup partagé – entre autres Adrien, Christian, Hamadi, Maurice, Mehdi, Nicolas, Saïd, Sylvain, Youssef. Des divergences sont apparues avec certains d’entre eux, le Collectif est entré en sommeil, mais je demeure persuadé que la profondeur de notre engagement commun portera à nouveau ses fruits.
Il faut donc prendre les textes de ce site comme de simples buttes-témoins de la résistance du marxisme-léninisme. Ce travail collectif où est sans cesse remise sur le métier la doctrine vivante du marxisme a permis de prendre de justes positions lors des grands bouleversements de l’époque. Il a permis de tenir bon, de garder la ligne générale, à plusieurs mains, en attendant que d’autres s’en emparent pour la conduire plus sûrement vers des succès que nous espérons proches, ou plutôt que nous savons proches, tant il est clair désormais que la jeunesse si ardente et révoltée fera tout pour que, dans la course entre la révolution et la guerre, ce soit la première qui l’emporte.
Daniel Blondet
Mai 2003
Mes remerciements et ma gratitude vont à Hannah et à Younes pour leur aide précieuse dans la construction du site, et à Ludivine Bantigny pour la relecture attentive et bienveillante (et exigeante) de ces premiers textes.
Plan du site
Quand la gauche est au pouvoir
Réunit essentiellement des textes des premières années du mitterrandisme.
Autour des stratégies
Textes indiquant quelques axes stratégiques à partir de l’analyse de la situation, ou encore de réflexions nées de telle ou telle lecture.
La guerre des démocraties
Textes sur l’impérialisme et sur le mouvement anti-impérialiste
Etat de guerre
Guerres coloniales et impériales à l’extérieur, guerre de classe à l’intérieur.
Xénophobie
Les luttes de l’immigration.
Ecole et capitalisme
Actuelles
Des textes liés à l’actualité d’alors, mais aussi à celle d’aujourd’hui.
Bonus
Quelle chance ! Des textes écrits par d’autres camarades.
- Et plus largement tous les courants progressistes ou réformistes. ↑
- Tome 19, page 120. ↑
- La revue faisait suite au journal du même nom, 13 numéros publiés de mars 1984 à octobre 1986. Par ailleurs, nous avons fortement contribué au journal « Alerte contre le nouvel ordre mondial », 12 numéros parus de juillet 1991 à février 1996. Des articles de ces publications seront progressivement intégrés à ce site. ↑