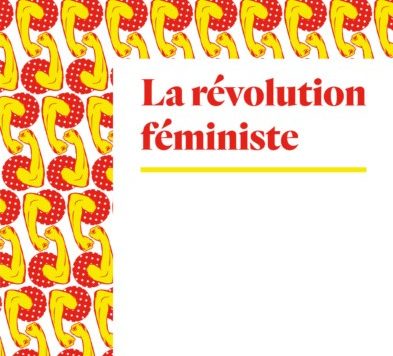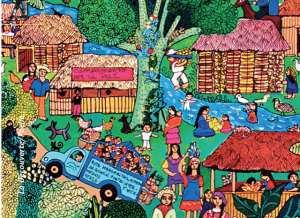Aurore Koechlin, La révolution féministe, Editions Amsterdam, 2019
Lorsque j’ai rédigé cette note de lecture, je n’avais pas encore lu le livre de Lise Vogel qui propose de construire une théorie du travail domestique[1]. Cet ouvrage écrit en 1983 est enfin disponible en français, publié en 2022 par les Editions sociales avec une introduction d’Aurore Koechlin.
Le problème auquel s’attèle Vogel est « de découvrir ou de créer des catégories afin de théoriser le travail non rémunéré des femmes dans la famille comme un processus matériel » (pages 307-308), dans le cadre d’une analyse de la reproduction de la force de travail (qui, dans la plupart des sociétés de classe, est réalisée dans un « système de formes familiales hétérosexuelles »). Elle part de Marx, « qui a beaucoup à dire », mais dont elle juge les analyses insuffisantes, car il ne développe guère la question du travail concret que requiert la consommation individuelle de la force de travail. Marx occulte ainsi ce que Vogel nomme « la seconde composante du travail nécessaire », soit le travail non rémunéré qui participe au renouvellement de la force de travail, qualifié de « composante domestique du travail nécessaire ». Celle-ci, n’ayant pas de valeur, reste dans l’ombre, elle joue cependant un rôle crucial dans le processus d’appropriation de la survaleur.
Le travail de Vogel, en partie repris par Koechlin, est des plus important. Il montre que le capitalisme fait sans cesse évoluer cette « composante domestique du travail nécessaire », ne serait-ce que pour une raison fondamentale qu’elle met bien en lumière, et qui tient à la contradiction à laquelle se heurte le système entre d’une part accroître l’utilisation des femmes dans la production de plus-value et d’autre part les assigner dans un travail domestique qui ne crée pas de valeur – et qui, par conséquent, n’a cessé d’être réduit depuis le XIXe siècle.
Les travaux de Vogel et de Koechlin produisent de grandes avancées dans l’étude des liens entre production et reproduction, étude qui est en grande partie à faire comme le souligne Koechlin. Ils posent une question stratégique : comment associer l’appropriation collective des moyens de production et celle des moyens de la reproduction sociale. Cette question est aussi abordée par Silvia Federici dans Le capitalisme patriarcal (La Fabrique, 2019), publié peu de temps après la rédaction de ma notice. J’aurais sans doute rédigé celle-ci différemment si j’avais eu connaissance de ces deux ouvrages, mais il reste que je peux maintenir deux points essentiels que j’aborde dans mon texte. Le premier est le suivant : il existe une tendance à réduire la reproduction à la question de l’entretien (et du renouvellement) de la force de travail, et donc à ne pas tirer toutes les conséquences du fait qu’elle est avant tout la reproduction de l’ensemble des rapports sociaux capitalistes. Et il faut préciser, point capital, que contrairement au mode de production précédent, sous le capitalisme, la classe ouvrière ne peut échapper au fait qu’elle est « une appartenance au capital », y compris dans la sphère de la reproduction. Comme le dit Marx, la consommation individuelle de l’ouvrier forme un élément de la reproduction du capital.
Le second point concerne les rapports entre les trois oppressions (de classe, de genre, de race). Koechlin s’attache sérieusement à cette question essentielle, avec des arguments pertinents, mais je tente une critique en estimant qu’elle ne va pas jusqu’au bout de sa pensée alors même qu’elle donne tous les outils nécessaires.
Il me semble que la seule manière de clarifier cette question repose sur l’affirmation de la prééminence du rapport de classe, qui tient à sa réalité en quelque sorte matérielle, à savoir que c’est dans ce seul rapport qu’est produite la plus-value. Cette thèse est sans doute présentée (dans cette notice comme dans d’autres textes) de manière maladroite, avec une insuffisante définition des catégories et des concepts utilisés,
Mais il me semble important de rappeler l’analyse de Marx, selon laquelle le procès capitaliste de production est par lui-même un procès de reproduction des rapports sociaux (ce qui signifie : tous les éléments de la reproduction appartiennent au procès de production lui-même). Il est important de le faire pour étudier de manière concrète l’évolution de la famille, de l’école, de la division du travail et construire une stratégie révolutionnaire.
_________________________
Note de janvier 2020
Voici un ouvrage remarquable à plus d’un titre, parce qu’il progresse dans l’étude théorique des liens entre production et reproduction de la force de travail, parce qu’il témoigne d’un souci de définir une stratégie, parce qu’il rend compte de manière concrète des expériences des mouvement féministes (de leurs difficultés et de leurs impasses), parce qu’il met en valeur le renouveau de ces mouvements qu’Aurore Koechlin (AK) entend éclairer par la question du rapport entre mouvement féministe et mouvement ouvrier.
Mon propos se limitera à mettre en discussion les thèses relatives à la critique de l’intersectionnalité, ainsi qu’à la théorie unitaire qui fonde l’approche de la stratégie par l’auteur (« articuler une véritable politique féministe à la meilleure analyse de la classe, de l’exploitation et du capitalisme », celle de Marx, page 148).
AK pointe bien l’apolitisme qui guette beaucoup des analyses féministes (et qui se cache derrière une « moralisation de la politique »), elle remet en quelque sorte les pendules à l’heure : qu’en est-il des mécanismes structurels ? qui détient le pouvoir ? Elle redit avec force que la question essentielle est celle du pouvoir Elle critique la réduction des structures aux individus : « On lutte contre les expressions de la domination, qui n’en sont que les symptômes, au lieu de s’en prendre au système qui les produit » (page 130). D’où la création d’espaces safe, qui ne mettent pas fin à la domination mais installent ponctuellement des lieux soustraits à la domination (page 131).
Il me semble toutefois que la critique pertinente de l’intersectionnalité à la française ne va pas jusqu’à trancher clairement la question des rapports entre classe, genre et race, si bien que, finalement, l’argumentation pourrait rester enfermée dans les mêmes impasses – c’est-à-dire l’impossibilité de relier ce qui a été artificiellement séparé, comme le souligne elle-même AK.
A la thèse des trois oppressions parallèles, l’auteur oppose celle « d’un système intégré et combiné des différents rapports de domination » (de classe, de race et de sexe), mais sans aller jusqu’à l’affirmation que c’est le rapport de classe qui est déterminant (on pourrait dire aussi : originaire, universel, intégral).
Pourtant, à plusieurs reprises, AK conduit le lecteur sur cette voie, par exemple quand elle rappelle la centralité stratégique (parce que matérielle) du travail productif (et reproductif, mais je reviendrai sur cette deuxième question essentielle plus loin), ou celle de la question de la séparation entre moyens de production et force de travail.
Le but du capitalisme est l’appropriation privée de la survaleur produite par la force de travail salarié. Ce rapport de classe qui est la base de toute la société ne saurait être mis sur le même plan que les rapports de race ou de sexe. Ni les oppressions de race ni celles de sexe n’engendrent en tant que telles de la valeur. Ce procès de valorisation (et d’appropriation de la survaleur), qui constitue la base du système capitaliste, est le propre de l’oppression de classe.
De ce fait, le genre et la race sont des déterminations de la classe, alors qu’on ne peut soutenir l’inverse (et dire que la classe serait une détermination du genre ou de la race). Ce point est important pour construire la stratégie L’accumulation sans fin de survaleur et son appropriation par une classe déterminée est un processus qui ne dépend pas spécifiquement du genre et de la race, mais uniquement (dans son essence) de l’existence d’une classe séparée des moyens de production, le prolétariat : un changement radical dans les rapports de sexe ou de race ne peut passer que par un changement radical dans les rapports de classe, c’est-à-dire que par l’abolition de la propriété privée des moyens de production.
Je sais qu’il est très difficile d’affirmer l’universalité (et en quelque sorte la prééminence) de la classe après qu’un siècle de marxisme à la française a relégué au second plan, parce qu’il ne les comprend pas, les oppressions de genre et de race (ainsi que, c’est corrélé, le colonialisme et l’impérialisme). Mais il le faut pourtant, pour déployer pleinement la stratégie révolutionnaire et pour que les luttes du féminisme et de l’antiracisme y jouent pleinement leurs rôles.
Dire que le caractère essentiel du capitalisme se situe dans la séparation entre les producteurs et les moyens de production revient à souligner que l’essentiel se joue dans l’acte d’achat/vente de la force de travail : c’est là le point de départ décisif, l’acte préliminaire, qui détermine le caractère spécifique du capitalisme. Avant d’exister dans le procès de production, où le marxisme vulgaire a limité son horizon, le rapport social capitaliste existe au préalable dans la circulation, au moment où se font face le capitaliste et le travailleur salarié. Or, ce « simple » face à face résulte de vastes bouleversements sociaux et politiques
Il faut bien comprendre les rôles respectifs des instances économiques et politiques dans cette affaire (on le précisera plus loin en abordant la question de la reproduction). Contentons-nous de dire ici que le procès de développement du capital produit à lui seul, en tant que tel, tous les éléments de sa reproduction. La force de travail en sort aussi nue et dépouillée de tout que lorsqu’elle y est entrée, si bien qu’elle ne peut que se soumettre à nouveau au procès de valorisation du capital.
Mais cette force de travail n’existe pas à l’état pur, comme une catégorie abstraite. Elle est façonnée par des déterminations historiques, sociales, culturelles. Si les conditions de sa reproduction comme classe corvéable sont purement économiques (comme nous le verrons), sa reproduction concrète est en partie dans les mains de la famille, ainsi que, de plus en plus, de l’Etat.
La seule « exploitation économique » suppose tout un monde social organisé dans l’unique but d’accumuler du capital : pour que chaque jour les quelque deux milliards de salariés que compte le monde se présentent à la porte de leur entreprise pour se faire tondre la laine, il faut que les Etats usent de gigantesques moyens, de tous les moyens, la répression, la force, la division du travail, la concurrence, les hiérarchies, la morale, l’idéologie, la guerre, qui sont autant de déterminations du rapport capital/travail.
Cependant, l’extrême diversité de ces milliards d’individus soumis au même joug est le signe le plus évident qu’ils le sont seulement à un titre humain, et non pas à un titre particulier (comme femme, jeune, Noir, Blanc, immigré…). Ils ne subissent pas un tort particulier, mais un tort absolu, qui confère à leur situation « un caractère universel en raison de ses souffrances universels » comme le dit Marx. C’est pourquoi le prolétaire n’a pas d’identité, pas de patrie, pas de culture propre, pas de profession – « prolétaire », répondit Blanqui au juge qui lui demandait son métier[2].
Ce caractère universel de l’exploitation a souvent conduit à une conception abstraite de la classe, réduite à une prétendue sphère purement économique, laissant de côté les déterminations concrètes que sont la race et le genre. Une telle conception dépouille la classe des rapports sociaux qui font sa chair et, ce faisant, abaisse la lutte de classe – je dirai qu’elle la dépolitise et la rend inefficace.
AK écrit à juste titre que le rapport de classe ne peut être que racialisé ou sexué. Comment faut-il le comprendre ? L’universel n’existe que dans le particulier. Le rapport racialisé est une détermination spécifique du rapport de classe, mais il le contient tout entier. Et la classe n’existe que « racialisée » et « genrée », pour le dire en terme peu élégants. Dire cela, ce n’est pas considérer comme mineure l’oppression raciale. C’est au contraire lui reconnaître sa pleine dimension, non pas comme une oppression parallèle à l’oppression de classe, mais comme une expression de cette dernière.
L’opposition de race est l’existence concrète de l’opposition de classe – elle n’est ni à côté, ni inférieure, ni moins étendue même quand elle concerne une minorité de prolétaires. Car elle contient tout le rapport de classe (comme la cellule contient tout le code génétique dit Bannerji), de même qu’elle marque la classe dans sa totalité. C’est pour cette raison que l’émancipation raciale fixe la mesure de l’émancipation générale de la classe, de la même manière que « le degré de l’émancipation de la femme est la mesure naturelle de l’émancipation générale »[3].
Nous suivrons ici Bannerji, qui précise :
« Une organisation de classes concrète est impossible sans relations historiques, culturelles, sexuelles et politiques. Sans ces médiations sociales, ces temps de construction et ces déterminations convergentes, l’organisation de classe concrète comme forme historique serait impossible »[4].
La tendance spontanée du capitalisme est d’utiliser, voire de façonner, ces multiples relations qui forment le tissu de la classe exploitée pour organiser en son sein une concurrence généralisée entre les travailleurs.
Par essence, le capitalisme ne peut exister qu’au travers de la concurrence entre capitaux et entre forces de travail[5]. Cela signifie que la concurrence est originaire et qu’elle s’exprime par la distribution des situations qu’elle organise entre les catégories (jeunes, femmes, qualifiés, non-Blancs, etc.), elle est déjà là, sans cesse approfondie et élargie par l’amplification de division du travail.
Cette concurrence entre travailleurs, que ceux-ci cherchent constamment à contrecarrer par leurs luttes collectives, est souvent la source de graves illusions. Il faut dépasser les apparences, pour éviter de dire par exemple qu’un ouvrier prend le travail d’un chômeur, ou qu’un salarié mieux payé capte une partie du salaire de ses camarades. L’ouvrier Blanc dans une situation favorable n’enlève pas une once de plus-value à l’ouvrier non-Blanc, de même que ce dernier, en acceptant un bas salaire, ne tire pas par lui-même les salaires vers le bas : ce que reproduisent et l’un et l’autre en exerçant une pression l’un sur l’autre, ce sont les conditions d’une concurrence qui est déjà là.
En rester aux formes apparentes de la concurrence conduit à confondre causes et conséquences. La structure de la concurrence (sous la forme par exemple de la stratification ethnique ou sexuelle du marché du travail) n’explique pas la différence de salaire (et donc la distribution des privilèges) : c’est au contraire la distribution des salaires qui donne forme à la concurrence entre les travailleurs.
Cette concurrence est souvent organisée, par des mesures administratives ou législatives qui enferment une partie des prolétaires dans des catégories : c’est le cas avec l’apartheid ou la ségrégation, c’est le cas avec des lois patriarcales (plaçant les femmes sous la dépendance du chef de famille – salaire d’appoint), c’est encore le cas avec les « politiques d’emploi » qui organisent la jeunesse comme surpopulation stagnante[6].
La question de la reproduction
Mais il faut revenir pourtant au processus économique lui-même, c’est-à-dire se livrer à un travail d’analyse, qui fait donc abstraction des expressions déterminées de la classe (race, genre) pour regarder le mécanisme d’exploitation en lui-même. La question de la reproduction peut nous y aider.
Sur la reproduction, AK cite (page 88) le début de la préface de l’Origine de la famille où Engels mentionne deux facteurs déterminant le développement de la société, la production des moyens d’existence et la reproduction de l’espèce (voir page 15 des Editions Sociales de 1966). Cette thèse mettant sur le même plan ces deux facteurs a été contestée (comme le mentionne d’ailleurs une note des Editions sociales), pour rappeler que c’est le mode de production des biens matériels qui est le facteur principal.
Sans revenir sur cette controverse, je voudrais souligner que la reproduction ne peut se réduire à la seule propagation de l’espèce : il faut l’entendre comme la reproduction de l’ensemble des rapports sociaux capitalistes.
Marx ne se contente pas de dire que la production implique la reproduction (des conditions nécessaires à la production) : dans une des démonstrations les plus éblouissantes de son œuvre, il montre que le procès capitaliste de production est par lui-même un procès de reproduction des rapports sociaux. Cela signifie que tous les éléments de la reproduction appartiennent au procès de production lui-même. Nul besoin d’instances extérieures à ce procès pour créer les conditions de la reproduction.
« Le procès de production capitaliste reproduit donc de lui-même la séparation entre travailleur et conditions de travail. Il reproduit et éternise par cela même les conditions qui forcent l’ouvrier à se vendre pour vivre, et mettent le capitaliste en état de l’acheter pour s’enrichir. Ce n’est plus le hasard qui les place en face l’un de l’autre sur le marché comme vendeur et acheteur. C’est le double moulinet du procès lui-même, qui rejette toujours le premier sur le marché comme vendeur de sa force de travail et transforme son produit toujours en moyen d’achat pour le second. Le travailleur appartient en fait à la classe capitaliste, avant de se vendre à un capitaliste individuel. Sa servitude économique est moyennée et, en même temps dissimulée par le renouvellement périodique de cet acte de vente, par la fiction du libre contrat, par le changement des maîtres individuels et par les oscillations des prix de marché du travail.
Le procès de production capitaliste considéré dans sa continuité, ou comme reproduction, ne produit donc pas seulement marchandise, ni seulement plus-value ; il produit et éternise le rapport social entre capitaliste et salarié ».
(Le Capital, Editions Sociales, tome III pages 19-20).
Avant même de se présenter devant le capitaliste, la force travail appartient déjà tout entière à la classe capitaliste : ce point est important pour comprendre la place et le rôle de la famille dans la reproduction. La forme sociale de la force de travail n’est ni produite ni reproduite au sein de la famille : elle lui est conférée par un mécanisme extérieur, mécanisme purement économique. La famille ne reproduit pas la force de travail en tant qu’accessoire du capital. Le petit du prolétaire est déjà prolétaire avant même de pénétrer dans la chaleur du foyer familiale. Une méchante fée s’est déjà penchée sur lui pour l’enchaîner au procès de valorisation du capital plus solidement que l’esclave ne l’était à son maître. On ne peut donc mettre sur le même plan domination de classe et domination patriarcale : cette dernière est entièrement soumise à la première qui la configure pratiquement de bout en bout, en tous les cas qui lui assigne sa place et son rôle. En témoigne le point suivant : plus le système capitaliste se développe et s’élargit, plus il confie à l’Etat la charge de la reproduction de la force de travail (avec la part essentielle de l’éducation), plus il transforme une partie des tâches domestiques en produits du travail salarié, plus il transforme les femmes elles-mêmes en forces de travail salariées. Le modèle patriarcal s’en trouve profondément bouleversé, on peut même dire qu’il est atteint en son cœur même, si bien que l’oppression de la femme apparaît dans sa nudité crue, débarrassée du fatras poussiéreux des rapports familiaux, elle en devient dès lors encore plus insupportable.
AK souligne d’ailleurs à plusieurs reprises ces évolutions.
Le patriarcat change de forme, mais il subsiste malgré la dissolution du modèle matrimonial où il s’épanouissait : et cela pour la même raison qui avait fondé l’apparition de la famille, c’est-à-dire la propriété privée. L’élément essentiel ici est l’héritage : l’affaiblissement du modèle familial n’empêche pas la transmission du patrimoine. Pire : cette dissolution du modèle familiale traditionnel se fait au détriment des femmes.
C’est ce que met en évidence Nicolas Frémeaux (sur le site AOC, 9 octobre 2019). Grâce au droit d’héritage, la famille reste un lieu important où se transmettent (et non où se reproduisent) les inégalités sociales au sein des masses, du moins cette part des inégalités qui est dû au patrimoine. « Alors que les héritages et donations constituaient seulement un tiers du patrimoine total des ménages français dans les années 1970, ils en représentent aujourd’hui presque deux tiers. ». Mais Frémeaux remarque que ce retour de l’héritage « ne profite pas à tous puisque près de la moitié de la population n’hérite de rien ou presque quand, à l’autre bout de l’échelle, une part croissante de Français reçoit davantage en héritages et donations que d’autres en toute une vie de travail ».
La dissolution de la famille traditionnelle se traduit par un changement important dans cette transmission du patrimoine en en renforçant l’individualisation. D’un côté, le nombre de couples mariés diminue, au profit de formes alternatives (comme le PACS) dont le régime matrimonial par défaut est celui de la séparation des biens. De l’autre, de plus en plus de couples mariés optent pour la séparation des biens (qui q doublé en quelques années, 20% en 2010).
« Au final, une fois l’ensemble de ces changements pris en compte, on note que la part des biens détenus individuellement dans le patrimoine total des ménages a augmenté d’environ 15 points de pourcentage en passant d’environ 35% de l’ensemble du patrimoine des ménages en 1998 à plus de 50% en 2015. »
Le plus important ici est de constater que cette individualisation du patrimoine a renforcé les inégalités entre hommes et femmes : la situation économique inférieure des femmes était en partie compensée par le régime de la communauté des biens que les nouvelles normes bourgeoises du couple ont affaibli.
Ainsi, la dissolution du mariage traditionnel n’a pas atteint le patriarcat, il en a changé la forme : ce que la femme a gagné en quittant le foyer pour travailler, elle l’a perdu en subissant l’individualisation de la transmission du patrimoine. « Abolition de l’héritage ! », proclamait à juste titre le Manifeste.
Précisons le tableau en regardant la place des moyens de subsistances de l’ouvrier (logement, habits, nourritures, etc.), essentiels dans la reproduction domestique. Ce n’est pas la famille qui achète les moyens de subsistances, ce sont au contraire « les moyens de subsistance qui achètent l’ouvrier lui-même » (Le Capital, tomme III, page 14).
Voici le schéma. Le salaire est une partie du capital aliéné contre la force de travail, il est échangé par l’ouvrier contre des subsistances dont la consommation sert à reproduire la vie du travailleur. La consommation individuelle de la classe ouvrière sert donc à transformer les subsistances qu’elle achète (grâce à la vente de sa force de travail) en nouvelle force de travail corvéable. Cette partie du capital qui achète l’ouvrier représente ses moyens de subsistances (et ne représente que cela puisque le reste du produit est approprié par le capitaliste). Ce sont bien les moyens de subsistance qui « achètent » l’ouvrier : c’est une autre manière de dire que l’ouvrier appartient tout entier au capital comme tout autre instrument de travail, ou encore que sa consommation individuelle forme un élément de la reproduction du capital.
Ce rapport purement économique est la base sur laquelle s’est édifiée et configurée la « société de consommation », à grande échelle depuis qu’au XXème siècle la classe ouvrière est devenu la principale classe consommatrice de marchandises.
Le tableau est le suivant : les moyens de subsistances dont l’ouvrier a déjà produit l’équivalent en valeur[7], l’ouvrier consomme ces moyens de subsistances si bien qu’il n’a plus rien et doit retourner vendre sa force de travail, l’accès à ces moyens de subsistance est par ailleurs entièrement configuré par le capital (standard des produits, centres commerciaux, soldes, etc…). La famille n’est plus qu’un segment de ce processus de reproduction, entièrement dépendante de son contenu et de sa forme, contrairement à la famille sous le féodalisme qui était le foyer où se produisait et se reproduisait les moyens de subsistance.
Analysant cet exposé de la reproduction, Alain Bihr reproche à Marx une conception mécaniste du procès de reproduction du capital, qui en ferait un procès quasi-automatique (« le régime capitaliste se soutient par la seule force économique des choses », écrit Marx dans Le chapitre inédit du capital, 10×18, p 204)[8]. Marx supposerait ainsi que le procès de production trouve en lui-même l’intégralité des conditions de sa répétition.
Bihr estime que Marx néglige le fait que la dynamique autoreproductrice du capital se maintient grâce aussi « à l’appareillage de domination politique et idéologique qui assure la reproduction des rapports de classe dans leur ensemble » (Bihr page 223).
Toutefois, Bihr rappelle que Marx a montré lui-même le rôle de l’Etat et de la violence politique dans le chapitre sur l’accumulation primitive, mais il estime que Marx l’a oublié dans l’exposé de la reproduction.
Or, Marx n’a rien oublié de tout cela : en témoigne par exemple le chapitre sur la journée de travail dans la troisième section du Capital où il montre le rôle de l’Etat et du corps législatif pour garantir la mise à disposition de la force de travail pour la lasse capitaliste.
Il faut revenir sur la démonstration de Marx sur la reproduction. Que veut dire exactement Marx lorsqu’il affirme que la servitude économique découle intrinsèquement du seul mouvement cyclique de la reproduction du capital ?
Pour mieux faire comprendre son propos, Marx compare la situation du paysan corvéable et celle du salarié. Le premier détient ses moyens de production, avec lesquels il va travailler par exemple trois jours de la semaine sur son propre champ, et les trois jours suivants sur la terre seigneuriale (la corvée)[9]. Ce paysan reste seul possesseur de son fonds d’entretien, qu’il reproduit sans cesse sans que jamais il ne prenne la forme d’un moyen de paiement dont un tiers lui ferait l’avance. Par ailleurs, son travail forcé et gratuit ne revêt jamais la forme de travail volontaire et payé (comme dans le salariat). C’est donc une contrainte politique[10] qui force le paysan corvéable à travailler gratuitement sur la terre seigneuriale, et non une contrainte purement économique comme pour le salarié. Avec le capitalisme, le rapport de domination et de subordination prend une nature objective, purement économique[11].
Au passage, faisons observer que c’est la raison pour laquelle le capitalisme est le premier système économique à l‘intérieur duquel ne peuvent se développer des rapports sociaux préfigurant un autre système. Des rapports bourgeois se sont développés à l’intérieur du féodalisme (accumulation de capital commercial, financier, rôle des banques, des premières industries, etc.). Des rapports socialistes ne peuvent se développer à l’intérieur du capitalisme.
AK a raison de souligner que « la question de la reproduction est tout aussi centrale que celle de la production » (page 105). Il faut simplement préciser que c’est pour la raison que, dans le système capitaliste, le procès de production est en même temps, par lui-même, un procès de reproduction.
Les conséquences à tirer en termes de stratégie restent à écrire. Les bases sur lesquelles AK propose de le faire sont robustes. Elle rappelle la question centrale du pouvoir. Elle affirme que la convergence des luttes ne peut se faire qu’à partir d’une théorie affirmée de l’unité des divers rapports d’oppression et d’exploitation.
« A l’opposé de la vision intersectionnelle, qui divise la société en une multitude de systèmes de domination parallèles et définissant des positions symétriques et essentialisées dominant-e-s/dominé-e-s, on doit défendre l’idée d’un système intégré et combiné des différents rapports de domination ancrés dans l’histoires et les sociétés considérées (classe, race, genre), produits et reproduits par des structures économiques, sociales et politiques (Etat, justice, police). Ce système intégré a pour base matérielle un mode de production et un mode de reproduction qui sont corrélés » (page 149).
Janvier 2020
- Le marxisme et l’oppression des femmes, vers une théorie unitaire, Editions sociales, 2022 ↑
- Dans la Critique du droit politique hégélien (E.S., 1975, page 211), Marx souligne que le prolétariat « est un état social qui [est] la dissolution de tous les états sociaux. ». Le prolétariat est la seule classe qui dans l’histoire préfigure la disparition des classes. La notion d’identité de classe est dépourvue de sens, et il ne saurait y avoir au sein de la classe des identités propres au genre ou à la race. ↑
- Cette phrase de Fourier est parfois attribuée à Marx-Engels, qui la reprennent à leur compte dans La Sainte famille (Œuvres philosophiques, Pléiade, page 645). ↑
- La passion de la nomination : identité, différence et politique de classe, in Race et capitalisme, page 112. ↑
- Son but est d’accumuler le maximum de survaleur : tel capital ne peut le faire qu’en cherchant à réaliser sur le marché un profit extra, en concurrence donc avec les autres capitaux. ↑
- La surpopulation affectée à des emplois irréguliers et à disposition du capital. ↑
- L’ouvrier est payé une fois qu’il a créé de la valeur, il est payé avec une partie de cette valeur qu’il a lui-même produite antérieurement. ↑
- Voir A. Bihr, « La reproduction du capital », tome 1 page 220 sq., Editions Page deux 2001. Cet ouvrage en deux tomes est une remarquable analyse du Capital. ↑
- Voir Tome III page 11. ↑
- Chapitre inédit page 202. ↑
- Chapitre inédit page 206. ↑