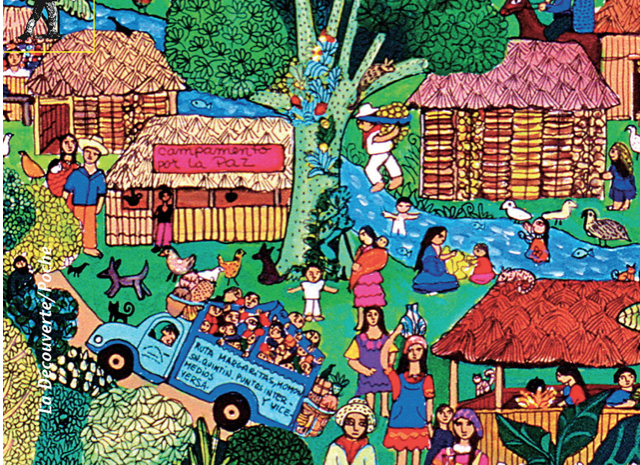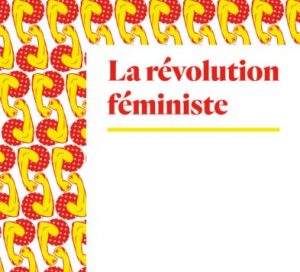Note sur un livre de Jérôme Baschet
Cette notice a été rédigée pour une amie, liée à Jérôme Baschet. Jérôme est un intellectuel militant anti-impérialiste, qui, entre autres, travaille ou a travaillé au Chiapas auprès des Zapatistes. Nous l’avions invité pour une conférence au Collectif Ni guerres ni état de guerre. L’ouvrage ici commenté fait partie de ces livres que j’apprécie beaucoup, car les auteurs, militants engagés, y développent leurs idées avec clarté et sincérité (c’est-à-dire sans cacher les difficultés théoriques qu’ils rencontrent). Ce sont donc des écrits propices à la réflexion et à la polémique positive. Ici se trouve discutée la question du développement des contradictions internes au système capitaliste, de la réalité et de la nature des processus annonciateurs de la société communiste future, et des conséquences pratiques stratégiques.
***
Note sur le livre Adieux au capitalisme, autonomie, société du bien vivre et multiplicité des mondes, Jérôme Baschet, La Découverte, 2014.
Je vois trois parties dans le livre : un premier chapitre qui donne à voir une synthèse remarquable de ce qu’est le capitalisme aujourd’hui. Deux derniers chapitres où les prémisses de la pensée de Jérôme Baschet (JB) sont enfin exposées, ou plutôt simplement évoquées. Et, entre les deux, trois chapitres où l’expérience zapatiste est présentée dans le but d’en tirer des leçons pour ici en France.
L’exposé est submergé de tensions et de contradictions, qui rend sa lecture assez passionnante. JB est un esprit fin et honnête, si bien que les limites, voire les impasses, de son « programme » sont le plus souvent par lui-même indiquées. On pourrait lire, sans trop de mauvais esprit, les trois chapitres centraux comme une sorte de manuel des apories de l’autonomie et de l’horizontalité.
Le premier chapitre analyse dans le détail l’ordre social capitaliste et ses conséquences sur les subjectivités, JB montre bien comment tous ces éléments forment système. Malgré tout, cette introduction éblouissante prête le flanc à la critique une fois lus les autres chapitres. Si les propositions de JB consistent à se retirer de ce monde, c’est parce qu’il ne voit pas que les contradictions qui le rongent créent déjà les conditions de sa disparition. On retrouve là un vieux débat, qu’il est somme toute passionnant de réchauffer parce que cela signifie débattre des conditions mêmes de notre lutte. On peut y retrouver l’opposition classique entre marxisme (des entrailles du chaos monstrueux jaillira le monde nouveau – « le communisme n’est rien d’autre que le mouvement réel des choses ») et utopie : mettons de l’ordre dans le chaos, partout où nous le pouvons (voir le communisme owenien).
Commençons donc par la fin, puisque c’est là que les thèses qui guident la pensée de JB, évoquées ici ou là dans le livre, sont affirmées avec force.
La première concerne le rôle de la classe ouvrière – je cite le passage entier, car l’affirmation y tient tout entière, sans être démontrée :
Aucun mode de production n’a été détruit par la classe exploitée : ni l’esclavage par les esclaves, ni le féodalisme par les serfs ou autres dépendants. Le capitalisme ne peut pas davantage l’être par la classe ouvrière en tant que telle, quelle que soit l’importance de la lutte de tous les exploités, de tous les opprimés, dans un tel processus. Historiquement, ce sont toujours les forces extérieures à l’antagonisme de classe principal qui ont été décisives dans la transition d’un système à un autre (page 181).
Thèse discutable « historiquement » : les classes exploitées, les esclaves, les paysans, furent au contraire les forces décisives pour changer de système ; mais ce qui est « historiquement » prouvé c’est qu’elles ont œuvré pour finalement installer une nouvelle classe exploiteuse. La classe ouvrière interrompt ce cycle : elle est la dernière classe, le prolétariat (moderne) disait Marx est la classe qui représente la dissolution de toutes les classes. Une fois que la classe ouvrière aura récupéré les richesses lui permettant de reproduire son existence, où iront donc les autres richesses produites : à la société tout entière, ou à une classe qui les accaparera ? Laquelle ? Cela ne peut être que la bourgeoisie capitaliste, sinon quoi d’autre ?
Au fond, JB sent bien qu’il s’agit de la dernière classe, puisque selon lui la fameuse force extérieure qui mettrait fin à l’antagonisme de classe, il ne peut la trouver dans aucune autre classe – il la voit dans une « force inédite », la « Terre Mère », qui se soulèvera….
Le recours à Postone (note 18 même page) n’est pas d’un grand secours ici : Postone se trompe lorsqu’il estime que la classe ouvrière est définie par le travail et que, pour cette raison, elle ne pourrait être l’agent d’un dépassement de la « société du travail ». Or, la classe ouvrière est définie par le travail salarié, et entend mettre fin au salariat (JB parle lui-même de l’abolition du travail salarié, condition pour restituer l’unité du faire humain, page 106). Que sera le travail hors du rapport salarial ? Certainement pas le même qu’aujourd’hui, dans son contenu, sa forme, sa configuration. On peut en avoir un avant-goût avec les retraités, qui perçoivent « une continuation du salaire » (mais ce qui n’est en fait pas un salaire), et qui produisent, s’ils sont en bonne santé, hors de la condition salariale (même si l’environnement salarial continue à peser).
Pourquoi la classe ouvrière représente-t-elle la dissolution de toutes les classes ? Parce qu’elle n’a rien en propre (et qu’elle ne peut donc s’humaniser dans le système comme pouvaient le faire les serfs, les paysans, les bourgeois sous le féodalisme). Leur exploitation est absolue, c’est l’exploitation dans toute sa sécheresse comme dit le Manifeste : elle représente le tout du système, ce qui signifie qu’on ne peut y mettre fin sans abattre tout le système. Bourgeoisie et aristocratie foncière peuvent coexister pacifiquement. La bourgeoisie usuraire et commerciale a existé sous l’esclavage et sous le féodalisme. Bourgeois et prolétaires ne peuvent « coexister » que par l’exploitation absolue, universelle, des seconds par les premiers. Nous ne sommes rien, soyons tout.
Conséquence pratique :
En ne voyant pas l’universel concret[1] que représente l’exploitation capitaliste (pourtant approché dans le chapitre 1), JB est conduit à rejeter la Totalité et l’Universel, au profit d’un retrait – se retirer de ce monde Un au profit de la multiplicité des communautés.
D’où :
L’abolition du capitalisme est abolition de la totalité et c’est au règne d’une triple abstraction qu’elle met fin : celle de la marchandise (…), celle de l’Etat (et de l’ensemble des formes politiques fondées sur la représentation substitutive d’entités posées comme unifiées), celle enfin de l’Universel (comme construction abstraite de l’Homme, masquant une universalisation des valeurs particulières de l’Occident) (page 185).
« Abolition de la totalité », l’expression n’est pas anodine, et doit sans doute être reliée au rejet de la centralité et de la prise du pouvoir d’Etat (on verra cela dans un autre texte).
Regardons donc cette abolition de l’abstraction de la marchandise. C’est la question du travail abstrait (autre expression de l’abstraction des marchandises), qui est généralisé, qui domine et entraîne cette « pernicieuse obsession de la mesure » (page 104).
Oui, le capitalisme a organisé la totalité à sa manière, en poussant l’économie marchande et l’appropriation de survaleur à son comble, mais il ne l’a fait qu’à la condition de pousser aussi à l’extrême les contradictions qui le rongent. La monnaie fétichisée fait oublier qu’elle est un rapport social, elle fait oublier que dans notre société la valeur d’une marchandise ne peut s’exprimer que dans la valeur d’usage d’une autre marchandise. Autrement dit, le travail abstrait n’exprime sa nature sociale que par le recours au travail concret. Sans compter que le but de ce processus, l’appropriation du surtravail par le capital, ne peut se réaliser que par l’exploitation de la valeur d’usage de la force de travail !
C’est cette contradiction en acte dans la Totalité (entre travail abstrait et travail concret, ou entre valeur et valeur d’usage, ou entre quantité et qualité) qui fait que l’abstraction devient vérité pratique : c’est-à-dire que le travail abstrait, catégorie qui existe depuis des millénaires, depuis qu’existe l’échange marchand, ne devient vérité pratique qu’au stade moderne de l’économie marchande[2].
Mais l’universel n’existe que dans le particulier, et l’abstrait dans le concret. Je m’appuie ici sur un passage un peu long de l’Introduction générale à la critique de l’économie politique.
Marx y fait l’éloge de Smith qui a mis en évidence « le travail tout court », le travail sans phrase comme il le dit ailleurs et il poursuit :
Avec l’universalité abstraite de l’activité créatrice de richesses, on a en même temps l’universalité de l’objet en tant que richesse, le produit tout court ou le travail tout court, mais en tant que travail passé, matérialisé (…). Or il pourrait sembler que l’on ait trouvé par là, simplement, l’expression abstraite du rapport le plus simple et le plus ancien de l’activité productrice des hommes, quelle que fût la forme de la société. C’est juste à certains égards, mais faux à d’autres. L’indifférence à l’égard d’un genre déterminé de travail suppose une totalité très développée de genres de travaux réels dont aucun n’est plus à même de prédominer. Ainsi les abstractions les plus générales ne surgissent qu’avec les développements concrets les plus riches (Marx, Economie I, Pléiade, pages 258-259), etc, etc.
La totalité est dominée par une catégorie abstraite pour autant qu’elle totalise la multiplicité du concret, processus qui ne vit et ne se développe que dans la contradiction. Abolissons le capitalisme, mais gardons la totalité !
Continuons notre éloge de la totalité – ou : il ne faut pas craindtr le développement de la force productive sociale.
En chassant partout où il le peut le travail vivant, le système de la machinerie révèle en même temps l’extraordinaire force libératrice qu’il recèle. Certes, le travail y perd toute autonomie et tout attrait, mais d’un autre côté, le salarié travaille moins longtemps pour lui (pour reproduire les conditions de son existence) et plus longtemps pour un autre (le capital). Dans ce sens, on pourrait dire que le capitalisme n’est pas caractérisé par la domination du travail, mais au contraire par la réduction du travail humain à un minimum, ce qui constitue la condition de l’émancipation du travail.
JB le sent bien d’ailleurs, lorsqu’en annexe il tente un savant calcul pour estimer que l’on pourrait travailler dix à douze heures par semaine. Mais ce qu’il ne voit pas dans le corps du livre, c’est que cette force libératrice, émancipatrice du travail est déjà à l’œuvre dans le capitalisme lui-même : d’où sa proposition de se retirer du Tout, de se replier sur des communautés restreintes, « territorialisées », et finalement de briser l’extraordinaire socialisation des forces productives que le capital développe involontairement, à son corps défendant, par la seule logique contradictoire qui le fait tenir – plutôt que de la libérer du corset étriqué du rapport salarial.
Une autre manière de considérer la contradiction qui fait fonctionner le Tout consiste à rappeler que la machinerie, créée par l’homme n’est autre que la force du savoir objectivée (Marx, toujours) : certes, ce savoir cristallisé dans la machinerie se dresse devant l’homme non comme sa créature, mais comme une puissance étrangère qui va l’asservir. Mais cette opposition, cette différence est en même temps unité profonde[3], entre la force intellectuelle, le savoir, et le processus de développement de la société organisée, configurée, selon la puissance de ce savoir. Il n’y a aujourd’hui pas un seul objet de consommation – depuis la nourriture jusqu’aux divers objets techniques en passant par le logement, l’habillement, la santé, le transport, … – qui ne soit le produit de l’intellect général, pour reprendre le terme de Marx.
Ainsi, la forme du savoir est incarnée dans des forces productives sociales qui sont aussi des organes immédiats de la pratique sociale (soit, comme dit Marx, du processus réel de la vie).
Imaginons un instant que la contradiction soit dépassée, que cette unité entre savoir et processus réel de la vie soit organisée en soi et pour soi, et ne fonctionne plus dans la séparation et l’aliénation, nous aurions alors non pas « un monde fait de plusieurs mondes » (plusieurs communautés « territorialisées »), mais une belle Totalité… ☺, c’est-à-dire un monde fait d’une infinité d’individus. Au passage, cela suppose de résoudre la contradiction entrer travail intellectuel et travail manuel.
Autre conséquence de tout cela chez JB, l’affirmation qu’il faut réduire la production pour étendre le temps libre.
Par exemple :
La récupération de la centralité du temps concret et de l’auto-organisation de la vie individuelle et collective implique une limitation radicale de l’exigence de production (page 96).
Sur le temps libre : ce temps disponible a une existence contradictoire, puisque l’insatiable appétit du capital le pousse à convertir ce temps disponible en surtravail et, s’il ne peut y parvenir entièrement, en surpopulation – on connaît la chose : travail épuisant d’un côté, chômage de l’autre [4]. La solution est que les salariés s’approprient leur propre surtravail.
La mesure de toute richesse (l’obsession de la mesure comme dit JB) est aujourd’hui le temps de travail : comment passer à autre chose ? C’est difficile à imaginer pour JB . Pour lui, la (re)conquête du temps passe par une suppression massive de production de biens et de services.
Je ne discute pas ici de l’inutilité ou de la nocivité de biens des richesses produites, qu’il expose à plusieurs reprises et avec laquelle on est en gros d’accord. Je cible ici la logique de son raisonnement.
JB ne voit pas que la production croissante de richesses est précisément la manifestation que le temps disponible s’accroît, puisque cette production croissante résulte d’une productivité croissante, elle-même résultat de l’objectivation du savoir dans un système de machinerie qui réduit le travail humain à un minimum. Ainsi, les conditions du passage de la mesure de la richesse par le temps de travail à sa mesure par le temps libre sont déjà là, produites par le système lui-même. Dans une société post-capitaliste, la force productive sociale croîtra rapidement en dégageant un temps disponible, un temps libre qui s’accroîtra pour tous, et ne sera plus un temps mort pour quelques-uns (chômeurs, inactifs). Et c’est bien ce temps libre, et non plus le temps de travail, qui sera la mesure de la richesse, parce qu’il en sera d’abord le signe le plus manifeste.
La méconnaissance de cette tension – contradiction concrète entre temps de travail et temps disponible conduit JB à se limiter à une mesure du temps de travail nécessaire, ce qui est quelque peu paradoxal lorsqu’on veut définir une société par le temps libre. Lorsqu’il reconnaît ce paradoxe (note 12 page 98), JB révèle l’origine des difficultés qu’il rencontre pour « sortir du cadre ». Il écrit :
Il est impossible de penser la société postcapitaliste autrement qu’à-partir-et-contre la logique capitaliste actuellement dominante : il est indispensable de mesurer la détente temporelle qu’entraînerait l’abolition de la logique de la valeur, pour montrer que prévaudrait alors un temps disponible, libre de toute mesure.
Pour aller jusqu’à penser que le temps disponible soit un jour (de bonheur) la mesure de la richesse, il faut commencer par reconnaître que les conditions de cette révolution sont déjà là, dans le capitalisme. Mais pour cela, il faut admettre l’essor de la force productive sociale, admettre que sa puissance productive existe parce qu’elle forme une totalité[5], conclure qu’il faut non pas se retirer de la totalité dans un territoire mais au contraire libérer la totalité des chaînes qui entravent son développement. JB montre bien ce que serait une société du temps disponible (pages 105-106 par exemple), mais il la pense comme séparée de la société actuelle, et non pas produite par ses contradictions.
Il existe deux manières pour les salariés de commencer à s’approprier la survaleur (le surtravail) accaparé par le capital : la réduction du temps de travail et l’augmentation des salaires (y compris l’augmentation du salaire socialisé, les cotisations sociales). La lutte pour la réduction du temps de travail est une lutte pluriséculaire que le mouvement ouvrier a toujours menée en la reliant au développement de la force productive sociale. Lorsque le mouvement ouvrier disait : nous voulons notre dû, c’est qu’il voulait récupérer les retombées de la productivité en matière de temps disponible et de salaire. C’est réformiste, au sens que cela ne change pas le système, mais cela consiste à pousser les contradictions concrètes du système et à créer les conditions de sa destruction. C’est le côté subversif de la chose.
Il me semble que c’est ce programme que JB refuse, parce qu’il refuse de prendre en compte les contradictions de la Totalité pour ne voir en elle qu’un universel abstrait, le Un uniforme qu’il faut fuir. Au lieu de le subvertir.
Je voudrais prendre un autre exemple de cette affaire. Et partir du point crucial, ultra-sensible du bouquin, lorsque l’auteur tente d’appliquer l’expérience zapatiste de l’autonomie dans nos pays (Faire croître nos espaces libérés, pages 157 sq). Il a bien des difficultés pour définir ces micro-espaces qui seraient autant de « bases de notre cheminement anticapitaliste ».
Alors que dans le « macro-espace » de la Totalité, il existe une zone libre, diablement subversive et émancipatrice, celle du salaire socialisé, de la cotisation sociale, qui répond au principe communiste : à chacun selon ses besoins[6]. Ce système qui fait circuler des centaines de milliards directement entre les salariés, sans passer par la case « valeur », représente une telle subversion du système que, dès le lendemain de la Libération (1947), les membres de la Société du Mont Pèlerin l’ont pris pour cible ; et que, depuis trente ans, les gouvernements s’évertuent à en ruiner les bases. Hélas, face à cela, le mouvement actuel est purement de résistance, et n’est pas offensif, ne porte pas en avant la valeur subversive de la cotisation sociale et ne montre pas la force anticipatrice de la société future qu’elle recèle. Friot a raison de protester contre cette abdication[7], qui tient précisément à un refus de considérer les contradictions de la Totalité.
Mais il me semble que c’était un point de départ pour aborder d’autres questions à débattre : l’autonomie, le pouvoir d’Etat, la centralité, la prise du pouvoir. A suivre…
_______________________________________________________________
- Bon, il faudrait préciser cela… ↑
- Voir Alain Bihr. ↑
- Je me rends compte ici qu’on aurait encore besoin de re-bosser le vieil Hegel, pour qui la réalité (bon, lui dirait « le concept de l’Idée », en vieil idéaliste !), la réalité donc est constituée de l’identité de l’identité et de la différence, autrement dit : la différence existe dans l’identité. ↑
- Mettre fin à cette contradiction ne consiste donc pas à « partager le travail ». Mais c’est une autre histoire… ↑
- Soit, répétons-le, que la domination du travail abstrait sur le travail concret se traduit par une réduction du temps de travail. ↑
- Modulo une partielle prise en compte du temps de cotisation pour ce qui est des retraites. ↑
- Un point de désaccord avec Friot : il développe une théorie unitaire du salaire (c’est-à-dire que selon lui le salaire socialisé est la forme sublime du salaire), alors que pour moi la cotisation sociale n’est pas à proprement du salaire (elle ne fonctionne pas comme salaire, comme capital variable), et c’est précisément en cela qu’elle est subversive. Cette différence dans les analyses permet d’éclairer ce que j’entends par déjà là. Pour beaucoup de camarades, le déjà là, ce sont des éléments de la société future qui s’incrustent au sein (ou à l’écart) de la société capitaliste. Ce qui est impossible tant que la société ne s’est pas approprié les moyens de production. Le déjà là que j’évoque renvoie aux contradictions de plus en plus aigües de la société capitaliste qui la rendent porteuse de la société future. Mais celle-ci ne peut advenir, même partiellement, tant que la classe productrice sera séparée de ses moyens de travail, c’est-à-dire tant qu’elle n’aura pas pris le pouvoir pour les restituer à la société tout entière. Donc, selon les interprétations, le déjà là soit permet d’oublier la question du pouvoir, soit la considère comme centrale (note rédigée en 2023). ↑