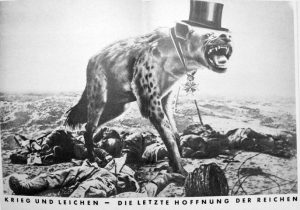Le 20 mars 2003, la « seconde guerre du Golfe » commence avec l’invasion de l’Irak par les Etats-Unis et leurs alliés, cette fois sans la France de Chirac et Villepin. L’association Alerte avait disparu depuis 1996, mais des liens subsistaient avec quelques militants, renforcés par la participation à l’essor des mouvements en France (lutte des chômeurs, mouvement de l’hiver 95, lutte des sans-papiers…). Il était évident que l’invasion de l’Irak allait bouleverser pour longtemps la situation dans la région ainsi qu’en Occident. L’idée de coucher sur le papier le résultat des discussions que nous avions paraissait utile : d’où cette note, qui est un projet de texte, qui n’a pas abouti. La seconde partie n’a pas été rédigée, elle devait comprendre des développements sur le réformisme et sur le type de mouvement et d’organisation que la nouvelle situation réclame.
______________________
4 mai 2003
La résistance
Ecrire sur « l’Irak et nous » suppose non pas d’oublier, mais de laisser de côté pour un temps les images qui nous parviennent de la guerre et de surmonter l’immense colère et la haine absolue contre les assassins : des quartiers détruits, des villages anéanties, les morts qu’on ne peut toujours pas dénombrés, les blessés arrivant sans cesse dans des hôpitaux privés de presque tout, les médecins opérant sans anesthésiant, l’eau et l’électricité coupées dans les principales villes, les bombes à fragmentation hachant la population de quartiers entiers, les gosses mutilés à jamais. Mais, surnageant au-dessus de cet océan de cruauté, et qui nous donne à nous, ici, la force d’écrire, la résistance du peuple irakien, pourtant fauché par douze années d’embargo, sa dignité et son courage face aux barbares apeurés qui organisent sous ses yeux le chaos.
Il faut d’abord parler de cette résistance, parce qu’elle est évidemment niée de toutes parts, et parce qu’elle est, déjà, l’élément clé qui va déterminer l’avenir de l’Irak, et, au-delà, de la région et du monde dans son ensemble. Cette résistance est niée dans la plupart des articles de presse et autres commentaires, y compris dans les rangs des organisations antiguerre.
Quel est le rapport de force militaire entre l’Irak et les Etats-Unis et son allié britannique ? Un budget militaire de 400 milliards de dollars du côté nord-américain, contre un milliard de dollars du côté irakien. Mais cette disproportion ne suffisait pas. On le sait désormais, et les peuples du monde entier doivent en tirer les conséquences : les armées de la superpuissance américaine ne combattent pas. Elles bombardent. Elles n’avancent qu’une fois le terrain « sécurisé » par des tonnes de bombes. La guerre n’est déclenchée qu’une fois réunies ces conditions du non-combat, de la non-confrontation. En ce qui concerne l’Irak ? Cette préparation a duré douze ans, et ceux qui estiment que la victoire des USA a été arrachée en trois semaines l’oublient. Douze années de bombardements quotidiens, et pas seulement dans les zones d’exclusions illégales. Partout où un radar irakien s’allumait, la zone était bombardée. Partout où des moyens de communications militaires étaient mis en place, la zone était bombardée. Partout où des concentrations de troupes pouvait s’organiser, casernes, campements, la zone était bombardée. Partout où des rampes de lancement pouvaient préparer des missiles, la zone était bombardée. Partout où une activité pouvait faire penser que l’Irak reconstituait son aviation, la zone était bombardée. Des milliers de civils sont morts au cours de ces expéditions destinées à faire du ciel irakien une zone déjà aux mains des Etats-Unis.
Mais cela encore ne suffisait pas. L’embargo sévère imposée par les résolution de l’ONU en 1991 et 1992, les multiples missions d’inspection truffées d’agents de la CIA allaient permettre aux USA de s’assurer que l’Irak ne pourrait disposer d’aucun moyen militaire propre à mettre en danger ses soldats le jour de l’invasion.
A la suite de ces douze années de guerre encadrée par l’ONU et tolérée par la « communauté internationale », l’armée irakienne n’existait plus en tant qu’armée moderne : pas d’aviation, pas de missiles, pas de moyens de communication ou de détection. Dès lors, le peu de matériel rafistolé dont elle disposait (tanks, pièces d’artillerie) pouvait être anéanti du ciel dès que l’aviation US entrerait en action.
De surcroît, l’Irak se souvenait des hauts faits de l’armée états-unienne en 1991 au moment de la reprise du Koweït : des milliers de soldats irakiens enterrés vivants (« pour l’exemple » avaient reconnu les officiers US, pour que les autres prennent peur et se soumettent), et la bombe à souffle carbonisant des milliers de civils et de militaires en fuite sur « l’autoroute de la mort » dans le sud de l’Irak.
Malgré tout cela, malgré cet invraisemblable rapport de force, malgré l’épuisement de douze ans de guerre et d’embargo, l’Irak a résisté. Oum Quasr qui devait tomber en quelques heures a résisté plus d’une semaine, et encore, les Anglais ne purent mettre le pied que dans les quartiers portuaires. Bassorah devait tomber le premier jour, avec une population jetant des fleurs aux soldats et embrassants leurs rangers : Bassorah n’a été prise qu’après Bagdad. Pourtant, la nouvelle de sa chute fut donnée le premier jour, puisque le scénario était écrit. Par la suite, toute approche d’un village ou d’une ville était un calvaire pour les troupes de la coalition. Ils décidèrent de les éviter et de rouler dans le désert pour rejoindre Bagdad le plus vite possible, et se conformer au plan pré-écrit de la guerre éclair.
C’est alors que l’état-major prit conscience de la double difficulté qui se présentait : premièrement, la population était hostile aux envahisseurs, la résistance était forte, les villes ne se rendaient pas ; deuxièmement, l’étirement de la ligne d’attaque la rendait vulnérable, l’approvisionnement était peu sûr, d’autant que des troupes étaient envoyées de Bagdad pour livrer bataille.
Au cours de la fameuse semaine de « pause », une discussion eut lieu entre l’état-major et le gouvernement Bush, ce dernier souhaitant que les chars Abrams soient filmés le plus vite possible au cœur de Bagdad, coûte que coûte – entendant par là coûte que coûte pour le peuple irakien. Puisque les villes ne se rendaient pas, on allait les détruire, puisque la population ne jouait pas les scènes de liesse prévues, on allait l’assassiner. Cette deuxième semaine fut le tournant de la guerre : feu vert au carnage. Comme certains journalistes l’ont rapporté, les troupes US se mirent à tirer sur tout ce qui bouge, et « même sur ce qui ne bouge pas ». La technique des nazis (cinquante otages pour un soldat allemand) fut appliquée à grande échelle : un village résistait, il était rayé de la carte ; un tir provenait d’une maison, le quartier était détruit et passé au shrapnell. Cette technique de la destruction des civils, ces multiples Oradours étaient possibles parce qu’auparavant l’armée US s’était assuré la maîtrise totale du ciel. Lors de la bataille de Bagdad, les avions de la coalition volaient constamment au-dessus de la ville en plein jour, pouvant raser des quartiers entiers sur appel des troupes au sol.
Les chars Bradley avançaient, avec leurs mitrailleuses à 2000 coups/minute, tirant des obus plus gros que les fameuses « ogives » irakiennes découvertes par les « inspecteurs ». La première incursion des chars Abrams et Bradley dans la banlieue sud de Bagdad, avançant dans un champ de ruine, résultat des bombardements incessants qui précédèrent la percée, fit 3000 morts irakiens en trois heures. Les combattants irakiens ne purent résoudre ce dilemme, se concentrer pour attaquer et être anéantis, se disperser et s’embusquer et voir assassinés autour de soi des milliers de civils. Après douze ans d’embargo, trois semaines de bombardements qui ont dépassé en intensité ceux de 1991, Bagdad put encore tenir quelques jours dans cet enfer, avant que les chars américains ne s’emparent de leur premier objectif, l’hôtel où résidaient les journalistes… après y avoir fait quelques morts pour bien signifier qui était le maître.
Nous savons peu de choses sur les combats de cette guerre, notamment sur ceux de Bagdad où bien des faits restent dans l’ombre, nous ne savons rien de l’organisation de la résistance, nous ne savons pas ce que sont devenus les instances dirigeantes du pays, mais nous savons que le peuple irakien a résisté à la plus gigantesque force d’invasion jamais réunie, il l’a fait sous de multiples formes, à des degrés divers, préservant sa dignité, montrant son héroïsme, et manifestant la claire conscience des enjeux, car, qu’ils soient ou non en faveur du régime baasiste, les patriotes irakiens savent pourquoi l’impérialisme US agresse et envahit l’Irak, et ils savent pourquoi il faut lui résister.
Car le rejet de l’occupant impérialiste est quasi unanime. La première défaite des USA tient dans ce refus de pactiser avec l’occupant, y compris de la part d’opposants au régime baasiste.
Il fallut les mensonges des premiers jours, et la pitoyable mise en scène du déboulonnage de la statue de Saddam pour faire croire le contraire. Seules les marionnettes sorties de leurs cinq étoiles londoniens, les « opposants » amenés sur les blindés US, les truands et autres maffieux crièrent « America good ». Comment penser d’ailleurs qu’après douze années d’embargo et de bombardements meurtriers le peuple irakien allait jeter des fleurs à l’occupant ? Le cynisme propre aux impérialistes anglo-américains n’allait pas arranger l’affaire. Pendant que les shrapnels mutilaient des milliers d’enfants, le premier convoi humanitaire anglais débarquait à Bassora des toboggans et des jeux de square, sous le regard effaré de la population qui, pourtant, en a vu depuis douze ans ! Toujours à Bassora, les premières distributions d’eau provoquaient des mouvements d’hostilité à l’occupant, certains irakiens refusant ces « dons » comme du poison. A peine tombée, Bagdad manifestait son hostilité. Des manifestations ont lieu quotidiennement autour de l’hôtel Palestine, qui présente l’avantage de réunir une partie de l’état-major US et les journalistes, qui ont d’ailleurs l’interdiction de prendre contact avec les manifestants. « US go home » est crié chaque jour, dans chaque ville irakienne, par des dizaines de milliers de manifestants, parfois au péril de leur vie comme à Mossoul. La première réunion des « opposants » sortis des fourgons de l’armée américaine dut se tenir en plein désert, à l’écart des journalistes, alors que dans la ville voisine de Nasiriya 20 000 irakiens manifestaient leur colère contre cette assemblée de traîtres. Ceux-ci devront vivre dans des bunkers, et dès qu’ils sortiront ils se feront liquider, comme cela a déjà commencé.
Cette résistance exemplaire des Irakiens doit être connue et reconnue, elle doit susciter chez nous admiration et détermination. Mesurons bien ce que sont en train de faire nos sœurs et nos frères d’Irak, après douze ans de guerre sans nom, après trois semaines de bombardements cruels, dans l’enfer et le chaos organisés par l’occupant. Par delà les clivages et les difficultés politiques qui surgissent parmi eux, et malgré l’isolement dans lequel les laisse la communauté internationale, les Irakiens manifestent un courage exemplaire, leur refus de se soumettre, de se compromettre, leur résistance constituent un événement considérable, historique.
Les pillages
Avant d’amener les « opposants politiques », les blindés de l’occupant ont déversé sur l’Irak déjà dévasté les pillards, les truands, les maffias. Dans ces formules si caractéristiques et transparentes qu’ils accumulent jour après jour, les dirigeants américains ont justifié les pillages en les présentant comme les premiers « actes révélateurs de la liberté retrouvée du peuple irakien ». La liberté de piller, c’est bien la seule liberté que comprennent et qu’autorisent ces gens. On sait désormais comment ces razzias furent organisées et programmées. Dans certains cas, ce furent les blindés anglo-américains qui ouvrirent la voie aux petites frappes. Les maffias de plus grande envergure, dirigées de Washington, organisèrent le pillage systématique du musée de Bagdad, faisant soigneusement le tri entre les copies et les originaux. La presse nord-américaine parle déjà d’un « muséum-gate », dans lequel seraient compromis les lobbies agissant depuis longtemps. Deux conseillers de Bush ont démissionné à la suite de ces révélations.
Mais le pillage ne suffisait pas. Il y eut en même temps des destructions systématiques de tout ce qui représente le patrimoine culturel passé et présent de l’Irak : destruction des collections du musée de Bagdad et des musées des principales villes, incendies de la bibliothèque coranique, de la bibliothèque nationale, des archives nationales, destruction des hôpitaux, des laboratoires des universités, etc. Ce que les bombes et les missiles avaient laissé debout fut anéanti par ces fameux « pillards » dont les bagdadiens dénoncèrent aussitôt leurs liens avec l’occupant. « Nous les ramènerons à un âge pré-industriel » avait annoncé Schwarzkopf en 1991. Bush junior avait promis de « terminer le travail ». Voilà qui est fait.
Le romancier Abdul Rahman Mounif déclare :
« La guerre et l’occupation de l’Irak n’ont pas pour seul objectif de renverser un régime, mais de se venger d’un pays, de son histoire et de sa civilisation et de réduire son rôle à néant. » « Comment expliquer autrement ce qui s’est passé au Musée de Bagdad, alors qu’un seul char et quelques soldats auraient suffi pour dissuader des pillards ? interroge-t-il. Comment justifier la mise à sac de la bibliothèque nationale, celle des wakfs (biens religieux) et des archives, et d’autres institutions culturelles irakiennes dans plusieurs villes ? Comment admettre, alors que l’Irak était coupé du monde à cause des opérations militaires, que des centaines d’œuvres volées aient pu franchir les frontières en moins de temps qu’il n’en fallait pour se retrouver à Londres, à Paris et en Iran ? N’était la mobilisation internationale, l’interception de ces trésors aurait-elle jamais été possible ? »
(Le Monde du 2 mai 2003)
La stratégie de l’impérialisme US
La guerre contre l’Irak a dévoilé dans sa nudité la plus crue et lugubre la stratégie actuelle des impérialistes nord-américains, qui marque une rupture avec celle qui avait cours au temps de Bush père et de Clinton. Quelques-uns de ses traits essentiels doivent être relevés.
Tout d’abord, il n’est plus question de « nouvel ordre mondial » : seul l’ordre américain compte, et cela sans dissimulation. Le résultat de cet hégémonisme est l’affaiblissement durable de toutes les instances internationales qui ont cherché à peser sur les événements : l’ONU, la Communauté européenne, la Ligue arabe. Même l’OTAN a été mise de côté, alors que c’est sous son drapeau que les opérations furent menées contre la Yougoslavie. Quant à ceux qui se rallient, il n’est plus question d’alliance mais de soumission. Les piètres politiciens qui rampent aux pieds de l’équipe Bush, les Blair, les Aznar, ne cherchent même pas à donner le change. Blair a repris mot à mot la doctrine de l’extrême droite bushienne : il n’y a de place que pour une seule puissance, les Etats-Unis, à la tête du camp de la démocratie libérale contre le camp du terrorisme.
« Certains veulent un monde comportant plusieurs centres de pouvoir, qui, je crois, deviendront très vite des centres de pouvoir rivaux. D’autres croient, comme moi, qu’il nous faut un pôle de pouvoir qui embrasse un partenariat stratégique entre l’Europe et l’Amérique, et que d’autres pourront rejoindre »
(Entretien au Financial Times du 28 avril, in Le Monde du 30 avril 03)
Dans l’exercice de cette puissance hégémonique, les Etats-Unis s’affranchissent ouvertement de toute règle, c’est un autre trait de la doctrine actuelle. Ce qui était admis implicitement au moment de la guerre froide et de la lutte contre le communisme, le droit d’user de méthodes non démocratiques, devient désormais un point de doctrine. Le « deux poids deux mesures », tant dénoncé par les partisans de la cause palestinienne, est revendiqué explicitement :
« Entre nous, nous agissons selon le rule of law et les principes de la sécurité coopérative. Mais, face à des types d’Etat plus traditionnels, nous devons en revenir aux méthodes plus brutales des temps anciens – usage de la force, attaques préventives, duperie, tout ce qui est nécessaire pour affronter ceux qui vivent encore dans le monde du XIXe siècle, celui du chaque Etat pour soi. Entre nous, nous respectons la loi, mais, quand nous agissons dans la jungle, nous devons alors appliquer les lois de la jungle. » ( Robert Cooper, cité dans Le Monde 25 avril 2003)
Un autre trait concerne la doctrine de la guerre préventive. Il s’agit en réalité du point central de la stratégie actuelle de l’impérialisme US. Guerre préventive, cela peut s’énoncer autrement : guerre arbitraire, guerre infinie. Le reste en découle : pour qu’une puissance puisse s’arroger le droit d’occuper le pays de son choix et d’y renverser le gouvernement, et cela en prévention d’un danger dont on n’a pas à démontrer la réalité, il faut bien que toute espèce de règle et institution internationales soit ignorée, que certaines zones soient déclarées territoire ouvert au brigandage et au pillage, que la notion de souveraineté ne s’applique pas dans ces zones.
Encore une fois, ce qui autrefois donnait lieu à de sordides marchandages ou coups d’Etat préparés dans l’ombre s’opère désormais au vu et au su de tous : pendant des années (30 ou 40 ans ont pronostiqué des experts US), le gouvernement irakien, sera nommé à Washington et sera composé de gens qui conviennent aux USA.
Ce genre d’opération ne peut se faire qu’en temps de guerre, et nous sommes au temps de la guerre infinie. Cela fait plusieurs années qu’aux Etats-Unis, des voix ont retenti pour dire que ce pays serait prêt à tout, utiliserait tous les moyens, sans égards au reste du monde, y compris ses alliés, pour survivre, pour défendre son économie au bord du gouffre. Nous y sommes. Ce pays qui doit mendier pour survivre s’est doté de la plus puissante machine militaire jamais vue. C’est elle, et on pourrait presque dire elle seule, qui servira à maintenir le système en place. A la dette infinie correspond la guerre infinie : celle-ci tient lieu de politique.
On le voit en Irak même : seule la machine militaire fonctionne. La politique ne suit pas, tout est improvisé, au jour le jour. On nomme à la tête de l’Irak ce général en retraite Joe Garner, qui, dans une terre ravagée, calcinée, pillée, est juste capable entre deux prières (ou plutôt deux Miserere), de répéter que son pays a « mené la guerre la plus miséricordieuse jamais livrée dans l’histoire ».
Garner a tenu à peine plus d’une semaine. « Nous n’avons pas de calendrier » avait-il déclaré. Son successeur n’en n’aura pas davantage. L’impuissance politique des Etats-Unis en Irak se révélera, d’autant plus que la résistance du peuple irakien, gagnera en puissance.
La question de la guerre n’est pas prise au sérieux
Il nous semble que cette situation de guerre, cette époque de guerre infinie n’est pas prise au sérieux. Quand nous disions « à dette infinie, guerre infinie » il ne s’agissait pas que d’une formule. Le système impérialiste vit sur des créances, et est dans son entier voué aux créanciers. D’un côté, la dette est immense, en particulier celle de la superpuissance US (30 000 milliards de dollars), et elle entraîne les budgets, les finances et les économies tout entières dans une spirale infernale, une fuite en avant. La dette américaine, toujours impayée, mais toujours alimentée par l’achat à l’étranger des titres du Trésor, la dette infinie donc, est le moteur de l’économie. De l’autre, les créanciers, qui vivent d’un prélèvement permanent et gigantesque sur ce circuit infernal, les créanciers ont plus d’argent que la société est capable d’en user de manière productive – autrement dit : lorsque ce capital excédentaire trouve à se placer, le rendement doit être maximum, le fruit pressé jusqu’à la dernière fibre. De surcroît, ce système est tout entier orienté vers les Etats-Unis, le pays par excellence de la dette infinie. Le flux mondial du capital doit couler dans cette direction, sans cesse, accompagnant le flux des matières premières bon marché.
La pression que les créanciers exercent sur toute la société est à la mesure de cette soif de profit qu’ils savent ne jamais pouvoir vraiment étancher. Ce sont eux qui fixent directement, sans que la sphère politique ne fasse rien d’autre que d’organiser la chose, les normes de la production, le prix des matières premières (on retrouve la question du pétrole), le taux de profit fixé a priori, la restriction des dépenses sociales, la mise aux enchères des biens et des services publics. Ces ordres sont désormais transmis sous la menace d’une pratique terroriste planétaire, d’un maccarthysme mondial où chaque Etat peut se voir inscrit sur la liste noire et se voir menacé d’une guerre préventive
Les conséquences politiques de cette situation sont-elles prises en compte par les mouvements militants ? Il nous semble que non, et c’est la raison pour laquelle ces mouvements sont, aujourd’hui en France, dans un grand état de faiblesse et dans une grande incapacité de mobilisation.
Ces mouvements vivent sur le passé, sans avoir pris vraiment en compte que deux cycles historiques se sont terminés, que deux types de compromis liés à ces deux cycles ont non seulement montré leurs limites, mais désormais leur impossibilité.
Le premier compromis est le réformisme. Dans les années 70-80, le choix réformiste s’est imposé contre la ligne révolutionnaire. Aux yeux des réformistes, ce choix apparaissait comme légitime parce que les « progrès de l’économie et de la société » pouvaient être partagés avec plus de justice, et cela jusqu’à introduire des réformes dites « de rupture » avec le capitalisme. L’arrivée au pouvoir en 1981 des partis réformistes a introduit une nouvelle période, non pas celle du réformisme, mais de la contre-réforme (dans le cadre de ce qu’on a appelé la « déréglementation » et la « mondialisation »). Mais pendant que l’impossibilité du réformisme se révélait, les affaires du monde capitalistes continuaient et ce second cycle s’achevait avec le siècle (nous suivons ici Claude Serfati qui fixe en 2000 la fin d’un cycle économique, avec la crise de l’Argentine et l’entrée en récession des Etats-Unis).
Le second compromis fut médiocre, à vrai dire minable, et, de l’aveu même de ses militants, la gauche y perdit son âme. Soit, le temps des belles réformes était révolu, on en convenait. Certes, le capitalisme « néo-libéral » dont on admettait le caractère inéluctable (tout devint inéluctable dans ces années 90) allait creuser les inégalités entre nations et au sein de chacune d’elle. Mais n’y aurait-il pas au bout du compte des effets bénéfiques ? Ne pourrait-on prélever une petite partie de ces énormes masses financières pour le redistribuer, comme au bon vieux temps ? Levons un impôt sur ces biens immoraux ! Ah, le beau programme ! Mais pendant ce temps, c’est le dollar qui constituait un impôt levé sur le reste du monde pour financer la dette américaine, l’économie américaine, les groupes militaro-capitalistes américains. Pendant ce temps, ce système de la dette infinie jetait dans la misère, le chaos, la famine, un pays riche, industriel, classé onzième au palmarès mondial, et de surcroît réputé bon élève du FMI, l’Argentine. Pendant ce temps, le gouvernement US préparait à répondre militairement aux dégâts que sa politique provoquait sur tous les continents. Bref, la guerre infinie, pour que continue la dette infinie.
Nous en sommes-là. Dans cette situation, nous devons répondre à une double question :
- Si aucune réforme progressiste ne peut plus être adoptée par le biais des partis réformistes, comment construire un mouvement extra-parlementaire apte à lutter contre la domination capitaliste et impérialiste ?
- Comment préparer ce mouvement pour qu’il résiste aux assauts directs de l’impérialisme US, qui ne laissera aucun mouvement de ce type croître tranquillement en Europe ?
A suivre
Version provisoire, 4 mai 2003