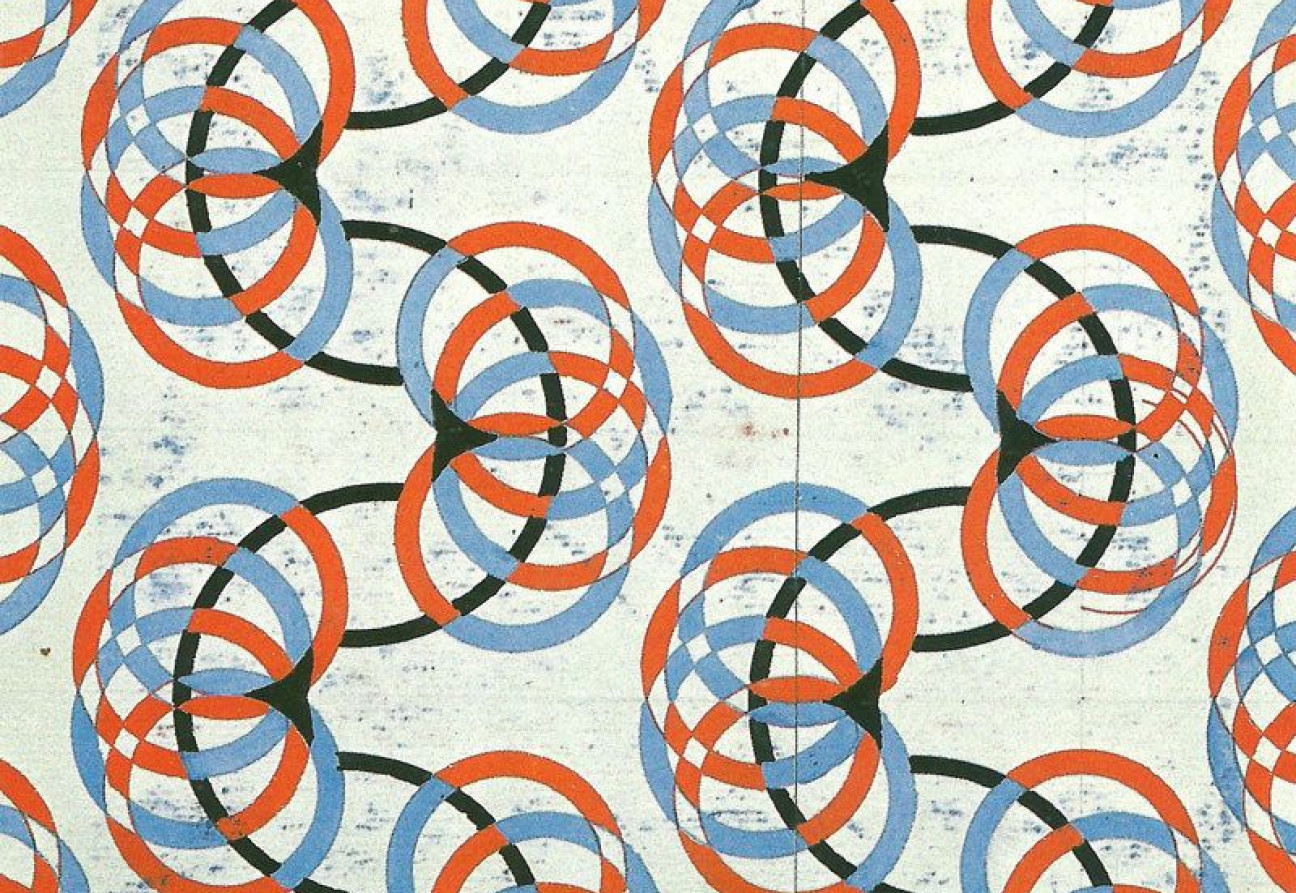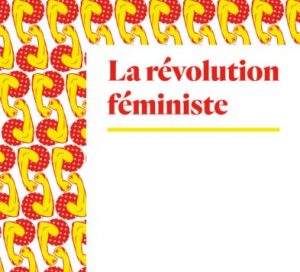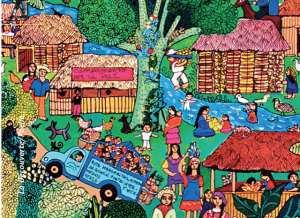Dans cet article publié dans le journal La voie du socialisme du premier semestre 1985, j’abordais la question du parti. J’écrivais alors que, quelle que soit la confusion qui progressivement a estompé les objectifs stratégiques assignés à la lutte politique, l’idée qu’elle doit être menée par un parti ouvrier reste un acquis du mouvement ouvrier français. Je ne sais si trente-sept ans plus tard je pourrais formuler cette idée de la même manière…
***
Article publié dans La voie du socialisme n° 6-7-8, janvier-juin 1985
La lutte politique de classe est aujourd’hui peu vigoureuse. Alors que les antagonismes de classe n’ont jamais été aussi exacerbés, leur reflet politique est terriblement atténué, la classe ouvrière n’existe pas comme une force politique indépendante. Elle n’a pas conscience que, pour transformer sa condition, il lui faut détruire le système capitaliste et instaurer le socialisme. Soumis à la bourgeoisie grâce à la tutelle révisionniste (du PCF), le mouvement ouvrier ne se développe pas en un véritable mouvement révolutionnaire. La classe ouvrière n’est évidemment pas satisfaite de son sort, mais les changements auxquels elle aspire ne trouvent pas une expression politique nette. Lénine indiquait : « L’expression la plus rigoureuse, la plus complète et la mieux définie de la lutte politique de classe, c’est la lutte des partis » (Œuvres, tome 10, p.75[1]).
Or aujourd’hui, le prolétariat n’a pas de parti indépendant, au sens de : indépendant politiquement et idéologiquement de la bourgeoisie. En conséquence, la lutte des partis ne reflète pas clairement l’antagonisme principal de notre société, la contradiction capital-travail. Tous les partis qui s’expriment actuellement sur la scène politique se prononcent en fait pour la perpétuation de l’esclavage salarié.
Mais il faut ajouter que le prolétariat, même sans parti indépendant, ne trouve pas l’occasion d’affirmer son poids et sa présence dans une lutte politique qui opposerait d’autres classes sociales ou différentes fractions de la bourgeoisie, comme cela a pu être le cas au XIXe siècle, avec la longue bataille pour la République.
Il existe en effet une grande différence dans les conditions historiques où se pose cette question de l’indépendance du prolétariat. Au siècle dernier, le problème pour le mouvement ouvrier révolutionnaire était de se dégager du parti radical bourgeois, pour lequel il combattait dans la mesure où il assumait souvent à la place de ce parti les tâches démocratiques républicaines de l’Etat bourgeois. Au XIXe siècle, la classe ouvrière française, plus que tout autre, a déployé son énergie révolutionnaire dans cette direction. A travers plusieurs révolutions, de 1789 à 1871, elle a forcé la bourgeoisie à créer un régime politique qui convienne le mieux au libre déploiement de sa lutte de classe : la république démocratique bourgeoise. Au cours de cette longue lutte, les conflits opposant les diverses fractions des classes réactionnaires ont toujours servi de prétexte à de nouvelles révolutions, où le prolétariat a joué le rôle de principale force motrice pour parvenir à assurer la conquête de la république. Mais, n’ayant pu que temporairement affirmer son indépendance et son hégémonie, il n’a pu arracher le pouvoir à la bourgeoisie libérale contre-révolutionnaire.
Dans la république bourgeoise, la classe ouvrière peut former son organisation politique indépendante. Mais, d’un autre côté, la démocratie bourgeoise crée les conditions pour que la classe ouvrière soit contaminée par les illusions parlementaristes et réformistes du démocratisme petit-bourgeois et pour qu’elle ne mette pas la possibilité d’un développement indépendant à son profit. Alors que dans la République bourgeoise moderne, le problème de la révolution socialiste se pose directement (puisque la classe ouvrière n’a plus devant elle que son ultime ennemi, la « bourgeoisie d’avant-garde » selon l’expression de Lénine), des voix s’élèvent pour orienter la lutte du prolétariat vers la défense de la république bourgeoise et l’obtention de maigres réformes sociales.
(…)
L’idée du parti ouvrier indépendant
Quelles illusions républicaines bourgeoises pouvaient subsister chez l’ouvrier-partisan de la Résistance ? Bien peu. Mais la trahison de la direction du PCF, en 1944-47, prolongeant l’orientation opportuniste de 1936, entraîna des répercussions considérables. En raison des traditions révolutionnaires de notre classe, ce fut un long processus, favorisé par la période de relative prospérité dans le développement des forces productives après la guerre. En outre, on exaltait le souvenir de 1936 pour entretenir l’idée que le parti pouvait participer au pouvoir grâce à la démocratie, et donc que le pouvoir n’était pas inaccessible à la classe ouvrière dans la société bourgeoise. Le prolétariat était ainsi conduit à penser qu’il pouvait arracher quelques avantages, et même participer au pouvoir sans faire la révolution, et il était incité à prêter l’oreille à ceux qui lui donnaient ce conseil : « Lutte pour améliorer ta condition d’esclave, mais considère comme une funeste utopie l’idée de renverser l’esclavage. »
Toute la politique des dirigeants opportunistes du PCF depuis 1935 a consisté à retarder et finalement à empêcher l’affrontement direct du prolétariat avec la bourgeoisie, poussé dès lors à orienter son énergie vers la défense de la démocratie bourgeoise et la reconstruction du pouvoir économique du capital.
Ainsi, le parti qui aujourd’hui encore apparaît comme celui qui représente « en toute indépendance » la classe ouvrière est en fait un parti complètement voué à la défense du capitalisme.
Le mouvement ouvrier français s’est reconnu pendant plus de soixante ans dans ce parti, et plusieurs générations d’ouvriers ont été formées dans l’idée qu’aucune de leurs aspirations ne pourrait se réaliser sans l’existence d’un parti politique ouvrier. Seul un tel parti est capable de faire entendre leur voix sur la scène politique. Ils se sont peu à peu convaincus que toute lutte économique pratique doit trouver un débouché politique, et qu’à cette fin ils doivent intervenir, par l’intermédiaire de ce parti, dans les affaires de l’Etat. Quelle que soit la confusion qui progressivement a estompé les objectifs stratégiques assignés à cette lutte politique, l’idée qu’elle doit être menée par un parti ouvrier reste un acquis du mouvement ouvrier français.
Cet acquis est évidemment contesté de toute part, mais il n’est pas si simple de l’anéantir car, outre l’expérience subjective du mouvement ouvrier, il est chaque jour conforté par les conditions objectives de la lutte. Dans la République bourgeoise moderne, le moindre problème concernant le travail et la vie des ouvriers peut déboucher sur une grande collision de classes. Le développement des forces productives est tel, la forme « pure » de la République est telle, que toute question économique, sociale ou culturelle devient immédiatement politique, qu’elle révèle l’ampleur et la profondeur de la contradiction capital-travail et qu’elle pousse à l’exacerbation de la lutte des classes.
En un sens, l’expérience de la gauche au pouvoir peut contribuer à mettre ce phénomène en relief, puisque l’on voit bien d’une part que le problème-clé reste le « pouvoir économique » du capital, qui est la base de sa domination sur toute la société ; et d’autre part que ce pouvoir du capitalisme ne peut être renversé en l’absence de mesures révolutionnaires.
Cet acquis politique de la classe ouvrière explique son faible engouement pour tout groupe qui se présente à elle autrement que sous la forme d’un véritable parti politique (nous voulons dire d’un parti digne de ce nom, et non d’un groupuscule qui se colle l’étiquette de parti). Galvauder l’image du parti, c’était et c’est prendre à rebours cinquante ans d’expérience du mouvement ouvrier et connaître inéluctablement l’échec.
A la lumière de cette analyse, il faut revoir l’histoire du mouvement marxiste-léniniste, qui n’a pu jusqu’à aujourd’hui regrouper les ouvriers d’avant-garde dans un parti indépendant.
C’est un fait que les dirigeants du mouvement, tels Jurquet et d’autres (qui, aujourd’hui, rejoignent les trotskystes dans l’appui aux partis de gauche), ont toujours eu un rapport lointain avec le marxisme. Leurs idées « révolutionnaires » n’allaient pas plus loin que le socialisme petit-bourgeois, et c’est d’ailleurs à ce titre qu’ils ont adhéré au maoïsme, qui est bien plus proche de ce vieux courant que du marxisme. Nous ferons le moment venu le bilan de l’activité néfaste de ces dirigeants maoïstes qui ont empêché l’édification du mouvement marxiste-léniniste. Nous nous bornerons à noter pour l’instant qu’ils ont cherché à faire croire qu’un parti rabaissant le rôle de la théorie du socialisme scientifique, dépourvu de programme révolutionnaire, pourrait mobiliser et organiser les masses et « concurrencer » le PCF sur le terrain.
Nos tâches théoriques et programmatiques
De tout temps, l’abaissement du rôle de la théorie a représenté un grand danger et a revêtu des formes diverses. L’impuissance à faire progresser la pensée théorique se dissimule souvent derrière des appels creux à l' »activité pratique ». Cette tendance est aujourd’hui particulièrement nocive, parce que, face au parti révisionniste qui se présente comme le parti de la classe ouvrière, il ne suffit absolument pas d’arborer quelques grands principes et de limiter son marxisme à des affirmations non démontrées ou à quelques références littéraires. Le mouvement ouvrier n’a pas devant lui deux partis distincts, l’un révisionniste, l’autre marxiste-léniniste, se livrant à une lutte ouverte et entre lesquels il pourrait choisir en connaissance de cause. Cette lutte ouverte entre deux partis distincts ne peut apparaître d’un coup de baguette magique, par décret, par suite de la seule volonté des marxistes-léninistes. Dans les conditions de la lutte politique en France, aucun résultat pratique ne pourra être obtenu sans un immense effort sur le plan idéologique et politique pour restaurer l’autorité du marxisme, pour cimenter l’unité des marxistes-léninistes et convaincre les ouvriers d’avant-garde de la nécessité de la lutte révolutionnaire marxiste-léniniste. Notre expérience prouve que tout abaissement du rôle de la théorie s’accompagne d’un éclectisme et d’une absence de principes, qui viennent de ce que le b.a.-ba du marxisme n’est même pas assimilé et que la révolution n’est plus l’objectif fixé.
Nous avons encore sous les yeux les exemples de groupes qui débutent leur carrière par des appels creux à la lutte, en se fondant sur l’idée que le révisionnisme est démasqué, près de s’écrouler, que la classe ouvrière est sur le point de se jeter dans des batailles décisives et que, bien sûr, l’organisation, le « parti », est en prise sur ce mouvement ascendant. A les lire, il suffirait de brandir l’étendard de la lutte révolutionnaire, qui agirait comme un aimant pour attirer à eux les forces vives de la classe, comme si des dizaines d’années de domination révisionniste n’avaient eu le moindre effet tant sur la mentalité du mouvement ouvrier que sur la vitalité de la théorie révolutionnaire. Pour concrétiser ce rassemblement supposé, il suffirait de créer des « organisations de masse »… qui n’accueillent en définitive que les rares militants de la secte.
Dépourvue de toute pensée révolutionnaire, et par conséquent de tout programme scientifique, une telle organisation sectaire devient vite le jouet des événements et sa presse se contente de refléter pâlement les agitations de la scène politique, alors qu’elle cherche à convaincre de son rôle important par la seule vertu de la déclamation. Le « parti de l’action » apparaît comme celui du verbe, de la phraséologie, le « parti des ouvriers » comme celui des petits intellectuels tour à tour impatients, désespérés, serviles, cyniques, mais toujours péremptoirement déclamatoires. Le refus de toute « tâche de programme » et les appels à la lutte ne parviennent plus à cacher des tares profondes : l’abandon de l’objectif révolutionnaire, l’éclectisme, le suivisme, le ralliement à tel ou tel courant bourgeois au gré des événements et, pour finir, à l’union de la gauche présentée comme étant le résultat d’une poussée du mouvement ouvrier. Lorsque le reflux ne peut plus être nié, plutôt que d’en tirer de justes conclusions pour les tâches du moment, la secte sans principes trouve dans l’apathie du mouvement une justification à sa propre apathie, elle voit dans l’inaction des ouvriers la cause de sa propre inaction et dans leur indifférence politique un argument pour son propre apolitisme. Bref, campant à l’arrière-garde du mouvement, elle ne peut qu’en contempler toutes les tares qui sont pour elle autant d’excuses à ses propres tares, autant de motifs de cultiver sa propre ignorance, autant de sources de sa propre décrépitude.
Selon Engels, le mouvement ouvrier doit lutter sur trois fronts : théorique, politique et économique pratique (résistance contre les capitalistes). L’activité des communistes dans les luttes politiques et économiques est étroitement liée à la lutte pour imposer la théorie marxiste-léniniste de la révolution dans notre pays, les communistes interviennent dans le mouvement pratique pour lui inculquer un programme socialiste révolutionnaire. Toutefois, cette activité dépend de la vigueur du mouvement pratique, qui connaît des flux et des reflux ; elle dépend aussi des liens que les communistes peuvent avoir avec lui. La lutte politique, nous l’avons rappelé, est, dans sa forme développée, une lutte de partis. Le parti marxiste-léniniste réalise la fusion du mouvement ouvrier (l’élément objectif, qui peut se développer indépendamment de l’activité des communistes) et du marxisme (l’élément conscient). Lorsqu’un tel parti n’existe pas, l’élément conscient est terriblement abaissé et les communistes, dispersés et coupés du mouvement ouvrier, n’ont guère de prise sur la lutte de classe.
A cela s’ajoute qu’aujourd’hui le mouvement ouvrier est en reflux par suite de l’échec de la voie où il s’était engagé derrière le PCF. Nous savons bien que la haine rentrée du prolétariat contre ses exploiteurs éclatera tôt ou tard, mais le mouvement ouvrier français n’a pas l’habitude de gaspiller son énergie. Il ne voit pas actuellement de débouché politique à une lutte d’envergure, à un affrontement général avec le capital (qui est la seule réponse à opposer à l’offensive de ce dernier depuis quatre ans). C’est dans ces conditions que le reflux intervient.
Mais cette situation ne saurait durer. Les antagonismes de classes s’aggravent et, sur le plan politique, la classe ouvrière se trouve aujourd’hui isolée du fait de l’échec complet que représente pour elle l’union de la gauche.
La politique mitterrandienne scelle l’alliance de la petite-bourgeoisie salariée avec la grande bourgeoisie, et sanctionne le retour au bercail de cette fraction de la petite bourgeoisie qui, en 1968, avait tenté de combattre le capital et l’Etat bourgeois. Elle sert aujourd’hui à perfectionner l’Etat bourgeois à travers les multiples institutions mises en place centralement ou localement et le risque existe que la petite-bourgeoisie se comporte en bloc comme une masse réactionnaire vis-à-vis de la classe ouvrière. Cette dernière fait face à une situation nouvelle, car elle se trouve rejetée de la vie politique non seulement en fait, mais même formellement par l’intermédiaire de « son » Parti, le PCF. Cette situation ne produit pas pour l’instant une grande collision politique. Le PCF, en déplaçant le centre de gravité de la lutte politique de l’Etat à l’entreprise, reconnaît que c’est là que se trouvent les ressorts de la domination bourgeoise, mais il le reconnaît à sa manière contre-révolutionnaire, en prétendant qu’ils peuvent y être brisés sans recours à l’appareil d’Etat.
Autrefois, le PCF conseillait à la classe ouvrière de patienter, d’attendre que la gauche soit majoritaire pour réaliser ses aspirations grâce à une nouvelle politique. Aujourd’hui, le parti révisionniste estime que les ouvriers peuvent améliorer leur sort immédiatement, sans s’occuper de politique, mais en s’intéressant uniquement à la gestion de leur entreprise. Il est certain que la classe ouvrière ne suivra pas le PCF dans cette voie, parce qu’elle ne verra pas les choses changer (c’est pourquoi la CGT veut paraître quelque peu en retrait sur ce point). Il est clair aussi que les marxistes-léninistes peuvent avoir prise sur cette situation si ce processus de décomposition du PCF provoque un sursaut, une réaction chez certains ouvriers d’avant-garde (voir plus loin la troisième partie de cet article). Mais pour cela, il faut que les marxistes-léninistes se soient solidement emparés du socialisme scientifique, qu’ils se regroupent fermement autour de ce drapeau, qu’ils rassemblent leurs forces éparpillées pour défendre les principes révolutionnaires. Rien ne doit nous détourner de cette lutte, qui relève de notre seule capacité à assimiler la doctrine et à l’appliquer aux conditions concrètes de notre pays. En toute situation, la base théorique de la lutte pour le socialisme, c’est-à-dire le marxisme-léninisme, présente une importance déterminante et la lutte pour imposer cette doctrine scientifique (que ce soit dans des œuvres scientifiques, un programme, une stratégie et une tactique) est décisive. Alors que le marxisme est coupé du mouvement ouvrier et que le révisionnisme garde une influence redoutable, il n’y a aucune chance pour les marxistes-léninistes de devenir une force politique s’ils n’ont pas au préalable affirmé leur doctrine (en définissant la voie de la révolution en France) et réduit à néant le révisionnisme sur le plan idéologique. Le socialisme est faible aujourd’hui parce qu’il n’est pas l’objectif de la lutte politique de la classe ouvrière. Dans cette situation, les marxistes-léninistes doivent plus que jamais affirmer leurs convictions, démontrer l’inéluctabilité du passage de la France capitaliste à la France socialiste et définir les voies concrètes de ce passage, d’autant plus que, depuis 198l, la contradiction entre le capital et le travail s’est aggravée, que les salaires ont baissé et que les conditions d’emploi de la force de travail se sont dégradées.
Pour rendre cette situation supportable, la bourgeoisie mène une « politique sociale » qui vise à masquer les contradictions, à mobiliser la classe ouvrière vers de fausses solutions d’attente (introduction des techniques nouvelles, formation continue, gestion du chômage, aides sociales diverses…). Nous devons montrer que ces mesures aggravent les antagonismes de classe.
De nos jours, le développement des forces productives pose à la bourgeoisie de redoutables problèmes qu’elle ne pourra résoudre « pacifiquement ». Elle lance ses bataillons de théoriciens qui viennent démontrer, chacun à leur manière, que « la crise » que traverse actuellement le capitalisme est un processus de longue durée, qu’il s’agit donc d’une transition entre une période d’équilibre et une autre, certes douloureuse mais pacifique, que « l’issue à la crise » peut être hâtée si la classe ouvrière consent des sacrifices. Contre ces théories, nous devons démontrer que la crise, la véritable crise, n’a pas encore éclaté, que nous n’en sommes qu’aux prémisses, à l’aggravation des contradictions – situation dont la seule issue, si la révolution n’éclate pas, est la crise mondiale, porteuse de guerre.
Le capitalisme moderne, loin d’atténuer les contradictions internes du système, les pousse à l’extrême. La bourgeoisie ne peut qu’aggraver les maux inhérents du mode de production capitaliste : militarisation de l’économie, croissance de l’étatisme, développement inégal…, et les pousser jusqu’au déclenchement d’une catastrophe sans précédent.
Nous devons montrer que la seule issue pour la classe ouvrière est de prendre le pouvoir, d’exproprier totalement les capitalistes, de détruire l’ancienne machine d’Etat bourgeoise et de la remplacer par un pouvoir populaire apte à assurer la tâche de l’édification socialiste. Nous devons montrer à l’aide d’une analyse concrète que cette voie universelle de la révolution, loin d’appartenir aux dogmes du passé, répond aux exigences du développement de la société française d’aujourd’hui.
Vers qui se tourner ?
La fusion du mouvement ouvrier et du socialisme scientifique est un processus difficile et long, qui s’opère par des voies originales selon les conditions spécifiques de la lutte politique propres à chaque pays et à chaque période. Mais, en tout temps et en tout lieu, ce processus passe par la mobilisation des ouvriers conscients, non pas de quelques-uns d’entre eux, mais d’un grand nombre.
Dans le mouvement communiste, une question primordiale a toujours donné lieu à d’intenses débat : quelle catégorie de la classe ouvrière le parti doit-il en priorité organiser, vers quelle catégorie doit-il diriger sa propagande ? D’innombrables écrits de Lénine, notamment des quinze premières années de son activité, traitent de cette question et ces analyses, bafouées par le maoïsme, n’ont rien perdu de leur valeur. Lénine a maintes fois rappelé que la propagande politique ne pouvait être subordonnée à l’état de conscience des masses, la « social-démocratie », écrivait-il, ne peut représenter que les ouvriers conscients. Il a montré que pour avoir une chance de contrecarrer l’idéologie bourgeoise qui « spontanément » s’impose à l’ouvrier, la théorie socialiste ne doit pas capituler elle-même devant la spontanéité. Lénine est allé très loin dans la généralisation théorique de cette question notamment dans Que faire ?, qui traite des rapports entre le mouvement ouvrier spontané et la théorie socialiste, l’élément conscient. Les principes dégagés par Lénine jettent les fondements idéologiques du parti communiste.
Dans d’autres textes tout aussi importants, Lénine aborde un autre aspect de la même question : le rôle des éléments d’avant-garde de la classe, de ces éléments conscients par qui l’idéologie du socialisme scientifique peut s’emparer de la masse et devenir une force.
« Ouvriers conscients », « ouvriers cultivés », « couche avancée des ouvriers », Lénine a toujours montré que la « social-démocratie » représente avant tout cette fraction de la classe ouvrière, qu’elle s’adresse avant tout à elle pour lui transmettre le socialisme scientifique, pour galvaniser son énergie et en faire une force d’entraînement pour toute la masse.
Lénine présente ainsi les rapports entre cette fraction cultivée et la masse :
« L’idée générale de la lutte politique ne sera évidemment assimilée que par l’ouvrier cultivé, à qui la masse emboîtera le pas, car elle se rend parfaitement compte de son asservissement politique (…), et ses intérêts quotidiens les plus immédiats la font constamment se heurter à toutes sortes de manifestations de l’oppression politique. Dans aucun mouvement politique ou social, dans aucun pays, il n’y a jamais eu et il ne peut y avoir d’autre rapport que le suivant entre la masse d’une classe donnée ou d’un peuple et ses peu nombreux représentants cultivés : en tout temps et en tout lieux, une classe déterminée a pour guides ses représentants d’avant-garde, ses représentants les plus cultivés. (…) C’est pourquoi la tendance à vouloir méconnaître les intérêts et les besoins de cette couche avancée des ouvriers, à vouloir s’abaisser jusqu’au niveau de compréhension des couches inférieures (au lieu d’élever constamment le niveau de conscience des ouvriers) doit nécessairement avoir des effets profondément nuisibles et faciliter la pénétration dans le milieu ouvrier de toutes sortes d’idées qui n’ont rien de socialiste ni de révolutionnaire » (Œuvres, t. 4, p. 300).
Pour avoir une chance de capter l’attention de cet ouvrier conscient, il est évident que les marxistes-léninistes, aujourd’hui, doivent faire preuve d’une grande maturité idéologique et politique et, qu’en particulier, ils doivent tracer nettement la voie du socialisme révolutionnaire (voir la deuxième partie de l’article).
Mais quels sont les rapports entre cet ouvrier conscient et le révisionnisme ? Cette question est capitale. Considérons le cas d’un ouvrier adhérant au PCF et qui aspire au socialisme : peu à peu, les contradictions qui l’opposent à ce parti s’accentuent, il voit que le travail syndical n’avance pas et, sans comprendre les revirements de la direction du parti, il constate l’impasse de sa politique. Cet ouvrier peut-il se détacher du PCF ? Dans les circonstances actuelles, il se peut qu’il verse dans l’indifférentisme, quelquefois dans l’anarchisme, la révolte individuelle. Il peut aussi conserver son attachement au PCF en estimant que, quelles que soient ses erreurs, c’est là que se trouvent les défenseurs de sa classe. Sans considérer le PCF comme une machine de guerre pouvant prendre d’assaut le capital, il peut estimer qu’il constitue un rempart contre les agressions de la bourgeoisie (« la droite ») et se cantonner alors dans une attitude défensive. Mais cette soumission au PCF agit peu à peu sur sa conscience et le lie davantage au révisionnisme moderne, précisément parce que la mission historique de sa classe lui apparaît de moins en moins nettement et qu’il ne juge plus le PCF par rapport aux tâches révolutionnaires.
Cet ouvrier peut-il discerner par ses seules forces la vraie nature du parti révisionniste et se détacher de lui pour former un authentique parti ouvrier ? Non. Dans le mouvement ouvrier, le pas décisif sera franchi lorsqu’un nombre important d’ouvriers comprendra que la lutte contre les chefs révisionnistes (dans les syndicats, dans le parti, dans les divers organismes de l’Etat où ils agissent) fait partie intégrante de la lutte contre le capital, qu’elle en est même la condition. Le pas décisif sera franchi lorsque ces ouvriers formeront un courant qui comprendra qu’il est impossible d’en finir avec le capitalisme sans en avoir fini avec le réformisme et le révisionnisme dans le mouvement ouvrier.
Il est aisé de comprendre que, pour aider ce courant à se former, les marxistes-léninistes doivent en priorité assumer leurs « tâches programmatiques » et renforcer le niveau de leur propagande. Mieux nous affirmerons nos convictions, plus grande sera notre chance de convaincre les éléments les plus conscients de la classe ouvrière. Nous ne céderons pas aux illusions qui pourraient nous détourner de notre voie.
Notre travail connaîtra un débouché politique lorsque se manifestera (aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur du PCF) un sursaut chez les ouvriers conscients, lorsque les contradictions qui les opposent au révisionnisme seront telles qu’ils comprendront que les révisionnistes les forcent à accepter l’inacceptable condition d’esclave salarié. Nous devons tout faire pour préparer ce sursaut et être capables, le moment venu, de lui donner une force et une orientation qui redonnent confiance aux militants ouvriers. Tous les marxistes-léninistes peuvent aujourd’hui contribuer à cette tâche. Notre travail est un travail lent, patient, opiniâtre, tenace, souvent invisible et sans résultat immédiatement spectaculaire, mais qui portera ses fruits si nous maintenons fermement notre orientation.
___________________
- Dans ce texte de 1905 où il critique l’esprit sans-parti, Lénine écrit dans les lignes qui précèdent la citation : « La bourgeoisie ne peut manquer d’aspirer à l’absence de partis parmi ceux qui combattent pour la liberté de la société bourgeoise, car cela signifie l’absence d’une lutte nouvelle contre la société bourgeoise elle-même. (…) Dans une société fondée sur la division en classes, la lutte entre les classes ennemies devient inévitablement, à un certain stade de son évolution, une lutte politique. » ↑