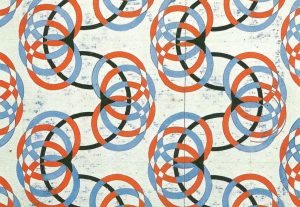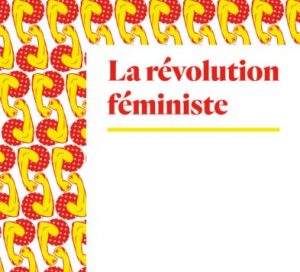De mai à juillet 1987 s’est déroulé à Paris le procès de Klaus Barbie. Ce moment fut singulier. Plusieurs éléments de la situation montraient clairement combien il était difficile pour « la démocratie » de se draper dans ses « valeurs » pour juger un fasciste, un nazi. Les témoignages des Résistants écartés, des avocats de la défense rappelant les crimes colonialistes de la France, et, par ailleurs un monde intellectuel agité par un débat où il était de bon ton de défendre le philosophe nazi Heidegger – tout cela composait un étrange paysage qui poussait à poser la question fondamentale : pourquoi la démocratie bourgeoise a-t-elle engendré le fascisme ?
Le texte suivant cherche à répondre à cette question. Il tente par ailleurs une analyse de la crise économique qui peut être ou le terreau fertile de la révolution ou la pourriture, ferment du fascisme et de la guerre. Il a été publié dans la revue La voie du socialisme en 1988.
LA DEMOCRATIE ET LA CRISE
In LA VOIE DU SOCIALISME n°3 (1988)
La société capitaliste diffère de tous les systèmes sociaux qui l’ont précédée par ceci que les phénomènes qui contiennent en puissance (mais en puissance seulement) l’abolition du capital sont produits et utilisés par le capital lui-même – avec comme conséquence de faire sortir la production capitaliste de ses propres limites et d’en retarder la chute, mais aussi d’en aggraver les contradictions. Ainsi, les éléments qui portent en eux la dissolution de la société capitaliste et ceux qui préfigurent la nouvelle société socialiste se mêlent étroitement (et parfois même s’identifient dans leur forme).
Cette contradiction vivante, si parfaitement analysée par Marx ou par Lénine, est particulièrement difficile à saisir. Son étude est d’autant plus contrariée qu’elle ne peut aboutir qu’à une conclusion : la dissolution de la société capitaliste fera place au socialisme et au communisme, celui-ci étant « le mouvement réel qui abolit l’état actuel des choses »[1].
La pensée officielle, en particulier dans sa version réformiste, fige ce mouvement (et on comprend pourquoi !). Plus le caractère social de la production s’affirme, plus le réformisme trouve des raisons de croire à la possibilité d’un développement spontané et pacifique du système vers plus de liberté, de richesse, de rationalité, de progrès. Ce courant proclame que le capitalisme contient en lui-même la possibilité de se réguler, de s’organiser avec raison et efficacité et qu’il peut ainsi éviter le retour des cataclysmes. Mais quand ceux-ci approchent, le réformisme bat de l’aile, il doit lui-même se renier et accomplir sa dernière mission : vanter les mérites de l’idéologie « opposée », le libéralisme, qui lui apparaît, face au fascisme montant, comme la seule version acceptable de l’idéologie bourgeoise. Tel est le sort misérable qu’il a connu sous le septennat de Mitterrand.
Les discours officiels actuellement diffusés par les différents courants politiques paraissent davantage adaptés aux périodes dites de prospérité qu’à ces temps troubles qui précèdent les grandes crises. Leur vacuité, leur éloignement des réalités sont autant d’indices de l’inadaptation des formules utilisées pour fonder la légitimité du pouvoir bourgeois. D’autres symptômes sont plus inquiétants, comme par exemple la persistance et la confusion du débat sur le nazisme au sein d’une partie de la classe politique et intellectuelle. Ou encore les nombreux avertissements lancés ici ou là sur les difficultés qui s’annoncent, la crise qui arrive, etc.
Les périodes qui précèdent le déclenchement des grandes convulsions du monde moderne (crises, guerres, révolutions) sont aussi celles des incertitudes et des confusions politiques et idéologiques. Le rejet de la politique, cette coupure entre « le système politique » et « la vie réelle » que de nombreux commentateurs relèvent aujourd’hui, en sont une caractéristique. Les prodromes de la crise font prendre conscience que la politique officielle et son habillage idéologique sont impuissants à expliquer et à combattre la misère sociale et l’oppression qui deviennent insupportables. Peu à peu, il apparaît que les vieilles formules de la domination bourgeoise ont fait leur temps. L’épais brouillard qui enveloppe le corps social se dissipe et laisse entrevoir les déchirements et les contradictions de la société. Notre pays a connu cette situation dans les années 20. Mais à l’époque, il existait une autre voie (certes semée d’embûches et de pièges) que celle de la politique officielle. La social-démocratie elle-même se réclamait du marxisme. Blum prônait l’« unité prolétarienne » – à vrai dire sous la pression de la rue et après qu’elle se fut réalisée sans son accord ! Pour le mouvement ouvrier, le parti communiste représentait le parti indépendant susceptible de le conduire sur la voie de la révolution. Rien de tel n’existe aujourd’hui. Il y a longtemps que les socialistes français ont explicitement renoncé à combattre le système bourgeois. Ils n’ont plus besoin de s’empêtrer dans des explications fumeuses pour justifier leur « loyale gestion du capitalisme », comme Blum devait le faire lorsqu’en 1935 il expliquait qu’« exercer le pouvoir » n’est pas « prendre le pouvoir ».
Sous la houlette de ses dirigeants et sur ordre de Khrouchtchev, le PCF a rejoint les positions les plus classiques du réformisme social-démocrate que pourtant il critiquait autrefois. Ne subsiste donc aujourd’hui que la politique officielle. C’est l’ère du consensus, du « vide idéologique ».
(…)
La seule idéologie que la bourgeoisie peut opposer à la révolution sociale, c’est celle qui fut portée sur les fonts baptismaux de la démocratie bourgeoise : l’individualisme. La société bourgeoise a donné naissance à cet étrange paradoxe : d’un côté, les rapports sociaux y atteignent leur plus grand développement ; de l’autre, surgit cette conception de l’individu au singulier, cette idée que les rapports sociaux ne sont pour l’individu qu’un simple moyen de parvenir à ses fins personnelles. L’individualisme triomphe avec le libéralisme, mais il se développe aussi à l’abri du réformisme et de sa démagogie sociale.
Cependant, s’achève un siècle qui a vu la démocratie engendrer le nazisme, la crise économique trouver sa solution dans deux guerres mondiales. Comme condition de sa survie, le capital impose à l’humanité et s’impose à lui-même les plus violentes destructions. Le spectre de la crise de 1929 surgit, qu’on veut conjurer parce qu’il demeure difficile d’effacer des esprits le lien qu’elle entretient avec le nazisme et la guerre. En France, fabriqué et soutenu à bout de bras par l’ensemble de la classe politique bourgeoise, un courant raciste et fasciste tente une percée, préparant le moment où il pourra organiser en sections d’assaut les déçus du réformisme et de l’individualisme.
Des événements récents montrent qu’est engagé ce passage de l’ordre au chaos : les débats autour du procès Barbie, ceux concernant les relations entre Heidegger et le nazisme (voir plus bas la première partie) se déroulent alors que la crise économique et monétaire s’aggrave (voir les deuxième et troisième parties). Les paroles lénifiantes ne parviendront pas à stopper ce processus. Le chaos fasciste et la guerre ne sont inévitables que si le mouvement ouvrier et démocratique laisse encore agir le réformisme porteur de capitulation et de pessimisme. Il est urgent que s’organise la bataille pour la révolution sociale et la dictature du prolétariat !
I. – La démocratie bourgeoise engendre le fascisme
Le procès de Klaus Barbie, organisé sur les lieux du crime en mai-juin 1987, doit être considéré comme l’acte d’exorcisme exemplaire par lequel la démocratie voudrait voiler sa propre face et faire oublier qu’elle a le pouvoir d’engendrer elle-même le chaos. Plus de quarante ans après la victoire sur le nazisme, la démocratie française a jugé un SS exemplaire. Entre-temps, ce dernier, comme nombre de ses pairs, avait été récupéré par les Etats-Unis, pour continuer à servir la démocratie en combattant le communisme ; un peu plus tard, en 1951, on le retrouvait, proclamant publiquement sa fidélité à Hitler et au nazisme, et travaillant pour les services spéciaux boliviens (sous la dictature de Banzer, il échafaudera un « projet d’épuration de la race indienne »).
Quelle justice a pu être rendue par la démocratie française, bafouée, impuissante à voir réaliser ses demandes d’extradition, mais surtout honteuse ? Honteuse au point de montrer honteusement ces rescapés et ces résistants, scandaleuse au point de mettre en doute leur qualité de « témoins » après leur avoir scandaleusement fermé la bouche pendant plus de quarante ans. Pourrie et nauséabonde au milieu de ses procédures et de ses petits classements sionistes : c’est au nom de la démocratie qu’on a voulu séparer victimes juives et combattants antinazis. Elie Wiesel, qui aujourd’hui compatit aux malheurs de Tsahal « obligée » de massacrer les enfants de Palestine, déplorait que la justice française eût demandé à Barbie de rendre des comptes pour toutes ses victimes
« juifs et combattants de la Résistance, juifs et antinazis, juifs et prisonniers politiques ; en d’autres mots, dit-il, l’aspect spécifique, unique et même ontologique de la tragédie juive sera perdu. » 3
Et c’est aujourd’hui en « rendant hommage à la démocratie qui règne en Israël » qu’on nous permet d’assister en direct aux massacres des Palestiniens en lutte. Mieux que tout discours, que toute « démonstration », la lutte des Palestiniens et la répression israélienne montrent avec clarté pourquoi la démocratie française fut et reste incapable de juger le nazisme, puisque c’est son passé et son contenu essentiel qu’il lui faudrait juger.
Selon la pensée dominante, il ne faudrait voir qu’un malencontreux accident dans cette « monstruosité de l’histoire » que fut le nazisme. Qui donc pourrait juger en effet les compromis des socialistes de Weimar avec Hitler, le soutien des démocraties bourgeoises au nazisme, la collaboration des dirigeants du mouvement sioniste avec l’Allemagne hitlérienne et le vote du Parlement français (la chambre du « Front populaire ») en faveur de Pétain ? Ce n’était donc pas cela qui était jugé à Lyon, et qui, de toute façon, appartient à un passé si lointain déjà et si compliqué…
Dans un répugnant face-à-face avec elle-même, la démocratie française a laissé aux avocats du SS la charge d’exposer les crimes commis sous le masque démocrate et restés impunis. D’autres « témoins » furent invoqués, les milliers d’enfants algériens exterminés dans les camps de regroupement, les dizaines de milliers de victimes de Sétif et de Constantine de 1945, les centaines de milliers de Malgaches massacrés en 1947. Evoquant le martyre des ouvriers africains sur le chantier du Transocéan, Me M’Bemba cite Aimé Césaire :
« Lorsque Hitler a commencé à vociférer, cela ne nous a pas étonnés car nous avions déjà entendu ce langage-là dans la bouche de nos maîtres. »
Aimé Césaire rappelait que ce qu’on ne pardonne pas à Hitler, c’est
« d’avoir appliqué à l’Europe des procédés colonialistes dont ne relevaient jusqu’ici que les Arabes d’Algérie, les coolies de l’Inde et les nègres d’Afrique[2]. »
Le dogme est ainsi rabâché : la barbarie nazie ne peut avoir de base matérielle ni d’explication rationnelle, car elle serait alors d’essence commune avec la démocratie. Celle-ci est rationnelle par nature, et donc par nature étrangère à la barbarie. Nul n’a à juger de ses crimes, puisqu’il ne peut y avoir de tribunal pour le démocrate, même si ses crimes ont des raisons bassement matérielles.
Il faut feuilleter le livre noir écrit deux ans avant la libération de l’Algérie par Hafid Keramane[3] pour prendre la mesure de l’extermination : les camps de concentration, édifiés aussi bien en France qu’en Algérie ; la guerre bactériologique (inoculation de virus mortels à des bébés) ; l’organisation de la famine en bloquant le ravitaillement de la population ; des dizaines d’Oradour où des vieillards et des enfants sont enfumés dans des grottes ou asphyxiés dans des caves ; de futures mères éventrées…
Le nazisme peut avoir commis de tels actes, puisqu’il est barbare par définition, par sa dénaturation diabolique. La démocratie ne le peut pas, et elle trouve partout d’ardents avocats, qui tous fondent leur argumentation sur l’opposition absolue entre « les deux grandes formes de domination de la bourgeoisie : la démocratie bourgeoise et le fascisme ». Le colonialisme, même lorsqu’il est critiqué, bénéficie de circonstances atténuantes, et se voit exempté du crime le plus infâme, celui de génocide.
Le consensus est ici robuste, des révisionnistes et de leurs satellites à Chirac qui célèbre à Marseille[4] le passé colonial de la France, « œuvre de pacification et de civilisation » dont il est « fier » – en passant par Chevènement. Ce dernier, rendant compte du livre de Gilbert Comte, L’empire triomphant[5], invite à « réévaluer » la période coloniale, en priant le lecteur de bien se rappeler que « la France a joué, somme toute, un rôle progressiste, en introduisant ces peuples dans le mouvement de l’histoire universelle ». La colonisation fut aussi, dit-il, « l’œuvre de la République », qui offrit aux Africains une possibilité de promotion à travers l’armée et l’école. L’ancien ministre socialiste propose donc de clore le procès conduit par l’anticolonialisme, car celui-ci représente « un moment de doute et de découragement, un moment de la décomposition de l’idéologie républicaine », qui empêche la France d’assumer « ses devoirs envers l’Afrique ».
Tout autre est le débat en Allemagne : on est loin du révisionnisme français à la Faurisson, et de la défense « abstraite » de la Démocratie, puisque d’emblée le débat est posé comme le terrain d’un enjeu très actuel (et dont les termes sont au demeurant très classiques : à l’opposition « socialisme ou barbarie », on substitue la réponse « socialisme = barbarie »)[6]. L’historien Ernst Nolte, un ancien élève de Heidegger, réclame une révision de l’histoire du IIIe Reich, « réveille ce passé-tabou » en évoquant pêle-mêle l’Indochine, le Cambodge, le Vietnam, Israël, le « génocide bolchevique », la dénazification constitutionnelle de l’Allemagne de l’Est, la pauvreté culturelle de l’Allemagne fédérale, etc., voulant démontrer qu’en ce monde rien n’est tout à fait blanc, ni tout à fait noir, et que la démocratie a parfois des faiblesses, dues précisément à son refus d’étudier l’innommable (le peuple allemand, un « peuple sans histoire »). Ainsi, l’idéologie réactionnaire la plus violemment anticommuniste fouille et creuse la « faille » de la démocratie, son lien avec le nazisme, et mêle à chaque ligne guerres de libération et guerres d’agression, les « massacres et génocides » de la Révolution russe et ceux du nazisme.
Or, si les communistes vrais peuvent répondre à de telles infamies, que peuvent dire nos démocrates pour leur défense ? L’ampleur, dans notre pays, de la polémique sur Heidegger montre le degré de leur embarras, de leur détresse et de leur ignominie. Dans sa préface au livre de Farias[7] qui a relancé la polémique, Christian Jambet n’hésite pas à écrire que « Heidegger est devenu, depuis la guerre, un philosophe français »[8].
On pourrait méditer longuement sur l’« état de la pensée » révélé par cet engouement français pour le philosophe nazi qui a fini par « se substituer à Marx comme une sorte de nouvel « horizon indépassable » »[9]. Comme toujours en effet, deux courants se complètent : ceux qui veulent opposer Marx et Heidegger, et ceux qui veulent les concilier. Ainsi, peu de temps avant que ne paraisse le livre de Farias, Jean-Marie Vincent publiait un essai[10] dans lequel il se propose d’exposer « la fécondité de la confrontation Marx-Heidegger ».
Les heideggériens français ont défendu leur maître à penser avec une conviction et une mauvaise foi peu communes. Alors que depuis longtemps en Allemagne, mais aussi en France, les articles de philosophes de gauche mettant en cause l’attitude de Heidegger sont publiés et connus, le livre de Farias provoque une animosité d’une nouvelle violence[11]. C’est que Farias ne se demande pas s’il existe un lien entre la pensée de Heidegger et le nazisme. Pour lui, cela va de soi. Il commet là un impardonnable crime de lèse-philosophie et doit subir le pire des verdicts : son livre serait « inconsistant du point de vue philosophique ».
Mais les faits sont accablants. Aussi les philosophes livrent-ils toute une palette d’arguments : Heidegger ne fut pas nazi ; il le fut « à moitié » ; et s’il le fut complètement, ce n’est pas si grave que cela. On argumente : Heidegger n’aurait pas commis de déclarations publiques en faveur de la politique raciale et de l’extermination des juifs[12]. Il fut nazi, mais pas raciste. Voilà qui le sauve. Il n’a pas franchi ce fossé qui sépare la démocratie du nazisme. Il reste donc du bon côté. Qu’importe qu’il ait dénoncé des juifs, Fédier nous apprend qu’il a aussi dénoncé des non-juifs, preuve qu’il n’était point raciste[13]. Pierre Aubenque dit que, recteur de l’université de Fribourg (1933-34), Heidegger appliquait la politique raciale du régime « sans zèle particulier »[14] !
Ainsi voit-on par quel tour de passe-passe la démocratie prétend être sauvée. Ici, en France, un courant politique peut être raciste et parler du « détail » des chambres à gaz, mais la démocratie s’autoproclame grande et pure puisqu’elle permet à un tel courant de s’exprimer. Là, un philosophe peut soutenir activement le régime nazi, prendre des mesures contre les « non-aryens », être l’ami intime d’Eugen Fischer (le directeur de l’Institut de l’hygiène raciale de Berlin), mais il resterait démocrate en évitant toute « déclaration publique ».
Tout ce qui relève de l’activité pratique, politique de l’« immense penseur » allemand ne serait que « détail ». Tout lui est d’avance pardonné, puisque la boue du monde extérieur se mue en un pur et limpide concept lorsqu’elle pénètre dans le cabinet de travail du philosophe. Ainsi Crétella, remarquant que Heidegger parle davantage du Führer que de Hitler, explique doctement :
« Se prononcer en faveur de la figure du « guide » — en allemand : « Führer » — ne saurait en effet être assimilé au culte de la personnalité qui l’incarnait.[15] »
Pour ces gens, l’adhésion de Heidegger au nazisme se comprend. Elle est celle d’un petit bourgeois de province, humilié par l’intelligentsia cosmopolite et salonnarde de Berlin. Et puis, parmi les motivations du philosophe,
« quelques-unes ne sont pas entièrement méprisables, comme la revendication qu’on dirait aujourd’hui « écologique » ou le souci de réhabiliter le travail manuel et de rapprocher les étudiants du monde du travail, même si l’on doit juger après coup (c’est nous qui soulignons) absurde l’espoir mis dans les nazis pour les satisfaire.[16] »
Alors que les philosophes soutiennent Heidegger parce qu’il a, jugent-ils, débarrassé à tout jamais la philosophie de la question des rapports de l’être et de la pensée, ils somment tout critique de concevoir « en termes philosophiques » le lien entre la pensée immense de Heidegger et son être nazi. Là encore le piège du sophisme se referme sur le démocrate antinazi : ou bien il révèle (il « dévoile » !) l’être nazi, et on lui rétorque que cela est bien petit en regard de l’« immense pensée » et on le met au défi de résoudre le problème du lien entre l’un et l’autre. Ou bien il met en évidence l’essence réactionnaire de la pensée, en phase avec le nazisme, et on lui oppose l’impossibilité d’une telle démonstration puisque, par principe, philosophie et nazisme s’excluent (tout comme démocratie et nazisme).
Henri Crétella, le plus ardent défenseur de Heidegger, écrit : « Entre penser et tuer, il faut opter[17] ». (D’où sa définition du nazisme, qui « n’est rien d’autre que le refus de penser porté à son extrémité »[18]). Le démocrate pense, il ne peut donc tuer, sauf par erreur (ou par « obligation », comme Tsahal). Le nazi ne pense pas. Heidegger pense, donc il n’est pas nazi. C’est ce sophisme que développe Finkielkraut dans son article du Monde[19]. Le cheminot qui conduit les trains d’extermination vers Auschwitz est surtout coupable d’un crime : il ne pense pas. Car le « bureaucrate du génocide » est dépourvu de pensée. Or Heidegger pense, il est un « immense penseur ». Il ne peut donc être nazi. Mieux, ceux qui le critiquent aujourd’hui et qui organisent contre lui un « procès stalinien », sont suspectés par le philosophe français de n’être point des penseurs :
« Quelle délicieuse revanche pour le bon sens excédé d’avoir été si longtemps tenu en respect par une pensée qu’il ne comprend pas ! »
Crétella a d’ailleurs poussé à son comble ce sophisme, qui exclut toute possibilité de se prononcer sur le nazisme. Le nazisme, écrit notre professeur de philosophie (on tremble en pensant à ses élèves !), le nazisme en tant que non-pensée, est dangereux, car « inapparent » :
« Aussi contamine-t-il aujourd’hui ceux qui, superstitieusement (?), en accablent autrui.[20] »
Penser quoi, peu importe. C’est justement ce que la coterie des philosophes salue chez Heidegger depuis quarante ans : de les avoir délivrés de l’angoissante question du contenu de la pensée. Avec Heidegger, penser c’est simplement s’apercevoir de la présence de l’être (sans chercher à l’expliquer ou à en rendre raison). Il est probablement très difficile pour la philosophie du XXe siècle d’assumer le dualisme du sujet et de l’objet, soit en l’acceptant et en tombant dans l’idéalisme traditionnel depuis longtemps réfuté, soit en le dépassant mais pour aller vers où, sinon, après Hegel, vers Marx et le matérialisme dialectique. Heidegger offre une élégante solution. Sa façon de « poser la question de l’être », de disserter sur « l’ouverture à l’être », le « dévoilement », d’accéder à la question de l’être par le langage (ou plutôt par des jeux de mots), bref toute cette mystique qui prétend dissoudre le dualisme du sujet et de l’objet permet en fait de refuser de penser leur unité dialectique. Que peut donc faire le philosophe du XXe siècle quand, du côté du sujet, de si grandes choses se sont accomplies, vérifiant que « la philosophie trouve dans le prolétariat ses armes matérielles comme le prolétariat trouve dans la philosophie ses armes intellectuelles » ? [21]
Le « sujet » aujourd’hui, ce ne peut plus être l’individu, c’est la masse. Voilà ce qui tourmente nos philosophes. Car la masse agit, cela ne fait aucun doute – sinon comment le philosophe pourrait-il à la fois disposer de temps pour philosopher et de moyens pour le faire savoir ? Mais la masse n’agit plus en silence. Elle se met à penser, en tant que masse, et à prendre conscience qu’elle est le sujet de l’histoire. Althusser avait cru s’en sortir en décrétant que « l’histoire est un procès sans Sujet ni Fin(s) ». Mais ce genre de pirouette ne suffit pas pour liquider le marxisme. L’immense penseur de la Forêt Noire exprime une aversion plus radicale, avec sa critique du « on », de la représentation nivelante et anonyme, son concept d’existence inauthentique, qui se traduit par la chute de l’homme, sa « déchéance » (Verfallen), la « vie dans la moyenne » (Durschnittlichkeit), le « nivellement des possibilités d’être » (Einebnung).
II. – L’ordre ou le chaos
« Peut-on penser Auschwitz ? » demande Glucksmann, le héraut de la nouvelle philosophie, avant de répondre négativement. Effectivement, on ne le peut pas si l’on ne pense pas le capitalisme. Mais le philosophe, le sociologue, l’économiste peuvent-ils penser le capitalisme si toute leur science les conduit à oublier le mouvement historique de notre société ? Les forces de destruction qui marquent de leur empreinte barbare l’entrée en scène du capital sont toujours là, à la différence qu’il y a deux ou trois siècles elles étaient au service d’une bourgeoisie conquérante, alors qu’elles sont aujourd’hui utilisées à grande échelle pour retarder sa chute.
« La Force est un agent économique »[22]. La force concentrée et organisée de la société, c’est-à-dire le pouvoir d’Etat, est aujourd’hui utilisée de toutes les manières pour permettre la survie d’un système condamné, soit directement, soit indirectement. C’est ainsi que tout le système de crédit, de sa base monétaire jusqu’à son sommet spéculatif, « remplace la violence directe »[23] pour acquérir et accumuler du capital, asservir les nations et mettre des continents entiers en coupe réglée.
De même que les politiciens invoquent le modèle d’une démocratie pure, les économistes bourgeois ont inventé un paradis perdu, un monde d’économie pure que le capitalisme pourrait, en théorie, retrouver, pour peu que les classes et les nations coopèrent. Ce modèle unique reçoit des contenus différents selon les courants. Pour le libéral, le monde perdu est celui du Grand Marché, débarrassé des interventions de l’Etat comme de toute espèce de puissance collective. Les théoriciens du régulationnisme cherchent leur modèle du côté du capitalisme administré, façon « New Deal » ou « Trente glorieuses » à la française. De leur côté, les révisionnistes prolongent la longue tradition du « socialisme subventionné » d’un Proudhon (la « Banque du peuple » dispensant aux ouvriers et aux artisans le « crédit gratuit ») ou d’un Lasalle (les « associations productives » subventionnées par l’Etat prussien) : laissant intacte la propriété privée des moyens de production, ce programme veut éliminer les mauvais côtés du capitalisme pour faire renaître le bon capitalisme, celui d’avant les monopoles, les crises, les guerres… et les révolutions !
La reconnaissance de la propriété privée, fondement de l’appropriation capitaliste, reste en effet le bien commun de toutes ces théories, opposées par ailleurs sur des points importants.
Par principe méthodologique, l’économie bourgeoise est sans histoire. Elle vit de la conjoncture et pour le bien de tous, et quand l’une lui échappe, ou que l’autre se dégrade trop manifestement, elle invoque « la structure ». Pour être un bon économiste, il faut être sans mémoire, myope et « constructif ». Sinon, comment continuer à croire une seule seconde au réalisme de ces échafaudages abstraits et bien-pensants ? Comment ne pas voir que la barbarie est la lèpre de la civilisation bourgeoise, le fil qui rattache les camps d’extermination nazis aux atrocités du régime colonial, un des piliers de l’accumulation du capital, que l’esclavage, la famine organisée, la misère programmée tout comme Auschwitz, sont la vérité de la société bourgeoise, qui révèle, comme le suggérait Marx, « ce que le bourgeois fait de lui-même et des travailleurs partout où il peut, sans gêne, modeler le monde à son image »[24].
La référence mythique des « Trente glorieuses » repose sur la thèse suivante : les terribles destructions de la Deuxième Guerre mondiale furent finalement un « moindre mal » puisqu’elles ont créé les conditions d’une nouvelle impulsion donnée au mode de production capitaliste, cette fois de manière rationnelle, avec un développement continu du progrès économique, social et culturel. L’interprétation du nazisme, mentionnée plus haut, joue ici son rôle : le nazisme n’ayant pas de base matérielle et économique, le théoricien ne cherche pas à comprendre comment il se fait que le capitalisme ne peut retrouver un cours harmonieux qu’en se détruisant lui-même et en exterminant une partie de l’humanité. Un désastre qui demeure inexpliqué a frappé la planète, mais au moins il permit au capitalisme de repartir sur de nouvelles bases, et par conséquent à la démocratie de se renforcer.
(…)
La plupart des économistes voient dans les « années glorieuses » d’après-guerre le rôle des institutions de concertation et de réglementation qui façonnent le visage d’un Etat démocratique moderne et perfectionnent sa cohésion : une nouvelle loi de l’accumulation est apparue, celle de la progression de la « demande effective ». Ils ne voient pas le mouvement réel et contradictoire que cache cette apparente et fugitive progression linéaire des revenus, où sont poussés à l’extrême crédit, endettement, pillage de continents entiers, vente forcée, militarisation. Aux Etats-Unis, le salaire réel des travailleurs a chuté de 14 % en dollars constants entre 1972 et 1986. Cette baisse est artificiellement freinée, mais elle demeure à l’ordre du jour. Kenneth Bacon, l’éditorialiste économique du Wall Street Journal, écrivait le 3 août 1987 :
« La réduction des salaires fait partie du réajustement que doivent mener les Etats-Unis pour améliorer leur compétitivité face aux Japonais et aux pays asiatiques à bas salaires. Ce réajustement est loin d’être terminé. L’économie américaine est en grave déséquilibre : elle consomme plus qu’elle ne produit ; elle investit (improductivement) plus qu’elle n’épargne ; et elle emprunte à l’étranger pour boucher les trous.[25] »
Pas plus aujourd’hui qu’hier l’accumulation n’est atteinte par un état d’équilibre (entre capital et travail, entre les sections de la production), mais au contraire par de profonds déséquilibres qu’elle provoque et dont elle se nourrit. Nous en verrons les conséquences avec la crise monétaire et financière dans la troisième partie de cet article.
En 1847, Marx raillait en ces termes l’optimisme des économistes concernant la prospérité de l’industrie cotonnière anglaise :
« Peut-être en parlant d’amélioration, les économistes ont-ils voulu parler de ces millions d’ouvriers qui durent périr aux Indes orientales, pour procurer au million et demi d’ouvriers occupés en Angleterre à la même industrie, trois années de prospérité sur dix.[26] »
A quelle échelle le massacre doit-il être aujourd’hui organisé pour que messieurs les professeurs d’économie puissent manifester leur optimisme ?
En novembre 1985, un article d’US News and World Report[27] donnait les indications suivantes sur l’économie nord-américaine : depuis 1945, les taux de chômage les plus bas, les gains les plus forts du PNB et les durées d’expansion les plus longues ont été obtenus pendant la guerre de Corée et pendant la guerre du Vietnam[28].
Tout ceci signifie précisément la chose suivante : les conditions exceptionnelles qui ont présidé à l’essor économique d’après-guerre, à savoir une économie nord-américaine hégémonique après les destructions infligées à l’Europe en 1939-1945, un dollar imposé comme monnaie internationale, des nations exsangues obligés de quémander « l’aide américaine », ces conditions exceptionnelles n’ont pas suffi pour garantir le procès d’accumulation du capital. On comprend mieux qu’après les années 70, alors que l’impérialisme américain n’a pas la possibilité d’exercer ses talents guerriers sur une échelle comparable aux deux guerres d’agression précitées, le capital nord-américain exige pour son accumulation une militarisation croissante (conquête de l’espace, guerre des étoiles) ainsi qu’une « contribution » plus forte non seulement des pays en développement, mais de ses alliés.
Pour poursuivre l’extraction de la plus-value, l’hégémonisme crée des déséquilibres toujours plus graves. La dette du tiers-monde s’élève aujourd’hui à plus de 1 000 milliards de dollars, ce qui représente la moitié des exportations de ces pays. En 1980, le service de la dette absorbait plus des 9/10 des exportations de matières premières, et, fin 1986, équivalait à 136 % de ces exportations. Si le travail des enfants est interdit ici, là, en revanche, des millions d’enfants travaillent dans d’effroyables conditions ; si, ici, le salaire est réglementé, là les ouvriers et les employés peuvent travailler des mois sans être payés, etc. Même si, respectant les œillères de l’économie bourgeoise, nous restons à l’intérieur des « riches métropoles », on observe que toute réglementation du marché du travail vise à exclure certains salariés et à organiser les conditions d’exploitation des bénéficiaires.
Ainsi, la misère, chassée vers ce que l’économie politique appelle la « périphérie » du système, plonge jusqu’au cœur de la population active des métropoles qu’on maintient à la disposition du capital toujours avec la même violence et la même brutalité. Perpétuer la misère parmi le peuple travailleur reste encore le seul article important du code du travail. Qu’est-ce qui sépare en effet les propos des politiciens d’aujourd’hui de ceux, cyniques, prononcés il y a deux siècles par le révérend J. Townsend, ministre anglican :
« L’obligation légale du travail donne trop de peine, exige trop de violence, et fait trop de bruit ; la faim au contraire est non seulement une pression paisible, silencieuse et incessante, mais comme le mobile le plus naturel du travail et de l’industrie, elle provoque aussi les efforts les plus puissants.[29] »
La seule différence avec le siècle dernier, c’est que la frontière entre indigents (que les libéraux souhaitaient assister) et les chômeurs (qu’ils voulaient tenir par la famine pour conserver leur « employabilité »), tend à s’estomper. Lorsqu’il dénombre la grande pauvreté en France, le Conseil économique et social compte 2,5 millions de personnes « aux revenus notoirement insuffisants », soit un million de chômeurs non indemnisés, 400 000 personnes sans couverture sociale et entre 200 et 400 000 sans-abris. Comment agit l’Etat à l’égard de ces chômeurs-indigents ? En octobre 1987, le gouvernement, appuyé ensuite par Mitterrand, avait annoncé le lancement d’un « plan contre la précarité », qui visait ni plus ni moins à substituer la précarité d’emploi à la précarité sociale : une allocation de 2000 F par mois serait versée aux citoyens sans ressources ni allocations-chômage, en contrepartie d’un travail à temps partiel au service des collectivités ou des associations.
Dans le même esprit, dans une lettre adressée le 23 janvier 1988 au directeur général de l’ANPE, Philippe Séguin demande à l’Agence de radier les jeunes chômeurs qui refuseraient les TUC. Quelques jours auparavant, au colloque organisé par son Ministère et par l’OCDE sur l’emploi américain, Séguin avait fait comprendre que la frontière entre indigent et chômeur pouvait s’estomper parce que disparaissait celle entre emploi et pauvreté :
« Nous pouvons relever le défi du chômage. Il faut en connaître le prix. L’emploi d’hier était celui du grand salariat industrialisé (sic). L’emploi d’aujourd’hui est celui d’un salariat plus fragile. »
Et il concluait, s’appuyant sur l’exemple américain :
« Je note qu’on peut travailler et être pauvre »[30].
Loin d’agir par lui-même, le « marché libre » est constamment organisé, maintenu sous pression par l’Etat, les lois et le code du travail.
III. – L’impénétrable mystère des crises monétaires
En apparence, les domaines monétaires et financiers offrent l’image d’un terrain d’action privilégié des Etats souverains. Un merveilleux ensemble de règles organise l’architecture de cette belle pyramide, dont la base est formée par les industriels et les autres agents privés, les étages intermédiaires par les banques et les organismes financiers, l’étage supérieur par la Banque centrale et le sommet par l’Etat exerçant son pouvoir régalien d’émission de la monnaie et de contrôle du crédit, des taux d’intérêt et de change. Avec le capitalisme moderne, c’est une monnaie purement idéale, « dématérialisée », qui circule comme un fluide accélérant le mouvement de ce beau mécanisme : monnaie fiduciaire avec les billets de banque, scripturale avec les dépôts bancaires, et surtout monnaie de crédit avec l’ensemble des titres qui circulent de manière autonome. Ainsi, le lien entre marchandise et monnaie semble s’être extrêmement distendu, et la forme la plus fictive, la monnaie de crédit, prend le pas sur toutes les autres formes — amenant l’illusion que la monnaie est un pur instrument de financement, créé et géré pour la bonne cause. Tel est le modèle de base des théories dominantes.
Ces dernières conduisent à d’inextricables difficultés et contradictions. Car, comme le note Marx ces « choses sociales » que sont la marchandise et la monnaie « tombent et ne tombent pas sous les sens »[31]. Ce que manipule l’Etat souverain — comme ce que manipule l’économie bourgeoise — ce sont des choses qui tombent sous les sens : le prix, l’intérêt, la masse monétaire, l’obligation etc., et qui ont perdu tout lien apparent avec « ce qui ne tombe pas sous les sens », et qui contient les véritables rapports sociaux et leurs contradictions internes.
C’est pourquoi les réformistes sont toujours poussés à considérer que les convulsions qui secouent la sphère monétaire et financière découlent non pas de la logique interne du système capitaliste, mais des excès d’une gestion mauvaise et immorale. De Proudhon au PCF, on invoque la spéculation, l’usure, le « capital prédateur », le « cancer financier ».
A l’opposé, le marxisme permet de comprendre la nature et la portée des phénomènes monétaires et financiers, des crises monétaires et financières et de leur lien avec la crise réelle. La théorie monétaire de Marx repose sur la loi de la valeur et sa théorie du système de crédit repose sur sa théorie monétaire et sur son analyse de la reproduction et de la circulation de l’ensemble du capital social[32]. C’est une théorie « unitaire ». Marx montre comment le capitalisme développe les contradictions déjà contenues dans l’échange privé entre producteurs privés. Dans ce rapport social fondé sur la propriété privée, les marchandises ne peuvent s’échanger immédiatement. La nécessaire médiation de la monnaie entraîne chez celle-ci des fonctions « purement techniques », dit Marx. Ainsi, une fraction du capital doit-elle toujours exister sous forme de capital-argent potentiel : l’inflation, la spéculation, la suraccumulation de capital de prêt sont des phénomènes immanents à cette fonction technique du capital-argent dans la reproduction du capital total. Ce ne sont pas des phénomènes extérieurs, liés à une mauvaise gestion du système ou au comportement immoral des dirigeants. Ainsi, les mouvements purement techniques que l’argent effectue dans le procès de circulation du capital industriel et commercial, en prenant de l’autonomie, deviennent la fonction d’un capital particulier, le capital financier[33].
De leur côté, la démonétisation de la monnaie et le système de crédit sont aussi inclus dans le mouvement de l’échange privé. Dans sa théorie de la monnaie, Marx a montré que toute monnaie qui circule (y compris la monnaie métallique) se démonétise du fait même de son emploi comme moyen de circulation. La fonction de la monnaie métallique (ou, plus précisément, la fonction numéraire de l’or) devient indépendante de son poids. L’or peut donc être remplacé par de purs signes de valeur, sans valeur. « Son existence fonctionnelle absorbe, pour ainsi dire, son existence matérielle[34] ». D’où la possibilité (aujourd’hui réalité universelle) d’un papier-monnaie d’Etat avec cours forcé, inconvertible, qui, précise Marx, « naît spontanément de la circulation métallique[35] ».
D’autre part, l’échange privé contient en lui la possibilité du crédit. L’argent qui, en tant que moyen de circulation, engendre la démonétisation et le papier monnaie inconvertible, joue aussi le rôle de moyen de paiement, fonction qui est la « racine naturelle » de la monnaie de crédit et du système de crédit.
Tant que la liquidité est assurée, et avec elle la fluidité des échanges, la contradiction est distendue entre l’argent comme forme purement idéale de monnaie de compte et l’argent comme marchandise absolue. Jusqu’au moment où, brutalement, l’argent doit quitter son existence purement fictive pour se présenter comme argent comptant, comme la seule marchandise qui compte : il devient la seule et unique richesse, marchandise absolue, « incarnation individuelle du travail social[36] ».
« Ce revirement subit du système de crédit en système monétaire ajoute l’effroi théorique à la panique pratique, et les agents de la circulation tremblent devant le mystère impénétrable de leurs propres rapports[37] ».
Quelques éléments sur la crise actuelle
1) Un premier problème est celui de la désorganisation du système monétaire international. A l’échelle du monde capitaliste, le marché de l’argent est aujourd’hui un « marché parfait », où aucune barrière ne semble faire obstacle aux flux financiers. Seules les variations des taux d’intérêt et de change peuvent réguler ce flux. Or ces variations se font de manière désordonnée, imprévisible, incontrôlée. Il suffit qu’une réunion des Sept soit organisée (à grand peine) pour qu’aussitôt les marchés viennent contredire ses timides décisions.
Une des causes fondamentales en est la crise du système monétaire international. A l’issue du dernier conflit mondial, l’accumulation du capital n’a pu repartir que grâce à l’institution, à Bretton Woods, de l’hégémonie du dollar, institué étalon-dollar, et n’ayant plus qu’une relation de pure forme avec l’or. Ce système est mort en 1971, après la décision de Nixon de non-convertibilité du dollar. Depuis lors, le monde capitaliste vit sans système monétaire stable. L’énorme quantité de capitaux qui doivent circuler pour rendre possible la production et le commerce (on estime que les transactions quotidiennes du marché international représentent deux fois le PIB annuel des Etats-Unis) n’a plus de référence stable.
Le caractère inextricable des contradictions de l’accumulation apparaît aujourd’hui lorsque le pays qui crée la devise internationale, les Etats-Unis, est en même temps celui qui est le plus endetté. Ce mécanisme s’entretient lui-même puisque ce pays règle ses dettes avec sa propre monnaie qu’il « emprunte », grâce à une ponction sans précédent de l’épargne mondiale, les créanciers des USA ne pouvant guère se réfugier sur une autre valeur.
Le moindre frémissement de l’économie nord-américaine (par exemple un point de plus de la croissance, un léger redressement des exportations, etc.) est à la fois salué comme un signe de bonne santé (et donne lieu à d’innombrables discours sur l’opposition « mystérieuse » entre l’économie réelle qui reste saine, et les soubresauts de la finance), et redouté dans ses conséquences. Wall Street joue à la baisse quand le déficit augmente, mais aussi quand le chômage baisse, car on craint une « surchauffe » de l’économie nord-américaine, entraînant une accélération de l’inflation, qui est elle-même anticipée par une augmentation des taux d’intérêt à long terme, etc., etc.
Il reste que c’est la monnaie la plus faible qui joue le rôle le plus fort dans le Système monétaire international. La dette nord-américaine est contradictoire avec le statut du dollar. Cette contradiction apparaît, de manière classique, sous la forme d’une concurrence accrue entre le dollar et d’autres devises, en fait le yen et le mark. C’est sur cette base que certains économistes prônent un système multi-devises, fondé sur la coopération[38]. Mais ils rêvent.
En effet, si les Etats-Unis ne parviennent pas à redonner au dollar son statut de devise-clé, le dollar reste prépondérant en dépit de la montée d’autres devises comme le mark ou le yen. Le dollar représentait encore, en 1985, 63 % des avoirs officiels de change des pays industrialisés.
Plus significatif peut-être est la ventilation des créances bancaires sur l’étranger. Fin 1985, les banques japonaises venaient en tête et détenaient 25,7 % de ces créances, contre 23,4 % pour les banques états-uniennes. Mais si l’on regarde par devises, on voit que le yen ne représente que 7,4 % de ces créances, alors que le dollar en constitue 62 % (le DM 12,3 % et le Franc, monnaie du futur leader de l’Europe selon Chirac, 1,5 %) !
Le système monétaire international ne peut donc retrouver son équilibre ni par le dollar, ni par une coopération multi-devises, puisque les marchés d’actifs en dollars sont encore prépondérants « physiquement » et sont les seuls à offrir une liquidité suffisante. Dans ces circonstances — et c’est ce qui explique l’actuelle paralysie des grands « centres de décision » du monde capitaliste — toute intervention risque de précipiter la crise. On attend donc qu’elle arrive « spontanément » pour amener ses solutions que l’humanité a déjà expérimentées !
La seule issue par laquelle la crise peut se développer et se résoudre, c’est bien toujours la brutale conversion du système de crédit en système monétaire, ce moment où l’argent devient la marchandise absolue et impose la destruction violente des autres marchandises. Marx remarquait que le capital est toujours prêt à sacrifier la valeur des marchandises pour assurer l’existence fictive et autonome de cette valeur dans la monnaie.
« Pour quelques millions d’argent, il faut donc sacrifier bien des millions de marchandises, chose inévitable dans la production capitaliste et qui en constitue une des beautés.[39] »
On sait aujourd’hui qu’il peut s’agir, et aussi par millions, de cette marchandise particulière qu’est l’être humain.
Marx parle ici de « beauté » parce que ce phénomène, loin de révéler la « monstruosité » du système, en exprime la rationalité même :
« Tant que le caractère social du travail apparaît comme la réalité monétaire de la marchandise, donc comme une chose extérieure à la production réelle, les crises monétaires sont inévitables, qu’elles soient indépendantes des crises réelles ou qu’elles les aggravent[40]. »
2) Il découle de cette situation, second problème, que les Etats souverains sont débordés de toutes parts.
Pour combattre cette hégémonie forcée de la devise la plus faible (celle du pays le plus endetté, les USA), les différents pays capitalistes ont mis en place des mécanismes qui, ajoutés aux réactions des USA, ont précipité le monde capitaliste dans la spirale de l’endettement et de la déréglementation.
Le capital monétaire est invariablement poussé à s’affranchir de toute réglementation. Par exemple, l’euromarché, qui prit son essor avec le recyclage des pétrodollars après 1973, et qui fut un des moyens mis en place par les Européens pour contrecarrer l’hégémonisme nord-américain (ce qui poussa les USA à créer un marché déréglementé à New York en 1981), se caractérise par un ensemble d’opérations financières en devises qui échappent aux réglementations du pays émetteur de devise.
Depuis 1981-82, les USA sont devenus le principal pôle d’attraction des capitaux mondiaux. Or à ce moment (et jusqu’à la fin 1986), ce sont les investisseurs privés qui se sont portés directement acheteurs de titres de la dette publique américaine. En 1986, le flux des capitaux privés entrant aux USA a dépassé les 100 milliards de dollars. Les Banques centrales ont été marginalisées, d’autant que ce mouvement des capitaux privés a poussé à la déréglementation, à la multiplication de produits financiers qui ont réduit le rôle de la médiation bancaire et le rôle d’intervention des banques centrales.
Mais qui contraint les marchés ? Il est impossible de cerner les fonctions de demande de monnaie mondiale. Ces énormes portefeuilles d’actifs financiers internationaux sont diversifiés entre les différentes monnaies (ainsi qu’entre les différents produits financiers), la moindre variation des taux de change (réelle ou anticipée) entraîne de gigantesques mouvements à l’intérieur de ces portefeuilles et entre eux. En retour, ces mouvements (réels ou anticipés) commandent en grande partie l’évolution des taux de change. La spirale semble sans fin.
Aucun réformisme démocratique ne peut avoir prise ici, car il existe une continuité entre le crédit commercial (base du crédit), le financement de l’accumulation à l’échelle de l’entreprise, de la nation et à l’échelle mondiale. De même qu’à l’aube du capitalisme, le crédit purement commercial a engendré la circulation autonome de traites (et la création de marchés « purement » financiers), permettant et gonflant la création de capital fictif et de capital porteur d’intérêt — de même aujourd’hui, la moindre opération de commerce international est à l’origine d’une cascade d’opérations de change qui nourrit ce qu’on appelle la spéculation du système financier international.
3) Le capital cherche donc à se prémunir de l’instabilité des taux de change et des taux d’intérêt.
Aujourd’hui, la moindre reproduction d’une activité économique (sans parler de tout financement d’une nouvelle activité) suppose une quantité d’opérations financières et commerciales à l’échelle mondiale. Il faut acquérir des matières premières, de l’énergie, des machines ou des pièces de rechange, des biens intermédiaires aux quatre coins du monde. Ces opérations se font à crédit et déclenchent une cascade d’opérations financières, de change, etc. Pour s’assurer des débouchés, le groupe concerné doit impérativement conquérir des marchés, qui supposent le financement d’activités commerciales à l’étranger, l’installation de filiales, le rachat d’entreprises étrangères pour conquérir ou protéger des marchés, etc., sans compter les sommes énormes dépensées pour corrompre les bureaucraties économiques et administratives, ainsi que le personnel politique des différents pays où le groupe agit. Toutes ces activités engendrent une circulation autonome des moyens de crédit, qui sert de base aux échanges purement financiers et à la spéculation. Sur les marchés des changes, de 200 à 300 milliards de dollars de devises s’échangent chaque jour : à peine cinq milliards le sont pour des raisons commerciales. Mais il faut bien comprendre que ces cinq milliards ne pourraient circuler et permettre le commerce mondial sans les centaines de milliards dits de spéculation ou d’échanges financiers.
Depuis quelques années, ces multiples activités et échanges se déroulent dans un monde sans référence stable, où les taux d’intérêt sont volatiles, les taux de change flottants, le dollar inconvertible et animé de mouvements contraires, etc. D’où la création d’une quantité de « produits financiers » à la disposition directe des grands groupes industriels. De nouveaux marchés apparaissent, comme le MATIF, pour « couvrir les risques ». De tout temps, les capitalistes ont recouru à toutes sortes de formes d’assurance, comme les options à terme, d’abord apparues sur le marché des matières premières, et qui ont ensuite gagné les marchés financiers. Aujourd’hui, le risque devient une chose, un bien économique considéré comme un objet d’échange et qui reçoit son prix.
En elle-même, l’obligation est du capital purement fictif. Il n’empêche que ce capital possède son propre mouvement qui engendre l’illusion que c’est du capital qui « s’investit », « se place » et « rapporte de l’intérêt ». Ainsi, la somme prêtée à l’Etat quand on achète une obligation, même quand elle n’est pas dépensée comme capital, rapporte un intérêt, qui n’est d’ailleurs pas autre chose que la fraction de l’impôt annuel qui échoit aux créanciers. L’obligation circule, et du point de vue subjectif de celui qui la rachète au créancier primitif, ce rachat représente un investissement de capital porteur d’intérêt. Un des buts du MATIF est de protéger ces portefeuilles obligataires (contre le risque lié aux fluctuations des taux d’intérêt, les cours des obligations évoluant en raison inverse du taux d’intérêt).
4) Les tendances actuelles du marché monétaire confirment ce que Marx avait mis en évidence dans sa théorie monétaire : le capital cherche à reculer le plus possible la frontière de la liquidité.
C’est dans ce sens que va la « mobiliérisation », ou la « sécuritisation », décrite dans la cinquième section du Livre III du Capital, et qui reçoit une nouvelle vigueur avec les mutations actuelles du système financier.
La première caractéristique est qu’un emprunteur substitue un financement par émission de titres (actions, obligations, billets de trésorerie) à des prêts bancaires plus difficilement mobilisables. Le second aspect, c’est que les banques peuvent émettre des certificats de dettes, représentatifs de prêts qu’elles accordent, certificats qu’elles vont placer auprès des investisseurs, rendant ainsi liquides des instruments financiers qui ne l’étaient pas. Cette multiplication des appels directs au marché permis après la « mobiliérisation » peut en effet, pendant un certain temps, engendrer l’illusion qu’il est toujours possible de vendre sans perte un actif financier. Mais le krach boursier de 1987 vient rappeler qu’on ne peut éternellement vendre à bon prix. Ce rappel à l’ordre va demain se faire sur le vaste marché des reconnaissances de dettes, qui s’est démesurément gonflé avec les innovations financières des années 80, et ses conséquences seront redoutables.
Pour éclairer ces phénomènes, il est nécessaire de comprendre le rapport entre moyen de paiement (« liquidités ») et capital porteur d’intérêt. La monnaie joue le double rôle de moyen de règlement et de réserve de valeur. Seules les devises censées conserver leur valeur peuvent être des réserves de valeurs (nous parlons ici des liquidités internationales). Or que se passe-t-il de nos jours ? La France, par exemple, a d’abondantes réserves de change en dollar. Leur valeur « liquide » dépend donc d’abord de la valeur du dollar. Quand ce dernier chute, comme actuellement, cela provoque des pertes de plusieurs milliards sur la contre-valeur en monnaie nationale des réserves en dollar. La « liquidité » dépend d’autre part de la capacité à mobiliser ces réserves de change. Or celles-ci sont de plus en plus constituées de Bons du Trésor américains. Vendre ces Bons, c’est-à-dire affirmer le caractère liquide des réserves, provoquerait une chute rapide du dollar (donc un effondrement de la valeur des réserves) et une hausse des taux d’intérêt (qui engendrera elle-même mécaniquement une chute de la valeur des obligations).
Cette abondance apparente et factice de liquidités masque le processus de déflation dans lequel le monde capitaliste est engagé depuis quelques années. L’inflation des années 70 a permis une accumulation de l’endettement. Mais le moment du retournement arrive. Les débiteurs surchargés ne peuvent plus payer, ce qui est une des causes de l’élévation des taux d’intérêt. La coïncidence du ralentissement de la hausse des prix, du fort chômage et de taux d’intérêt élevés est un signe évident de déflation. Les transformations récentes du système financier international représentent une adaptation à cette période de déflation, visant à sauver coûte que coûte le système de crédit.
5) Le système de crédit et ses contradictions. Plus le capitalisme se développe, plus les investissements de longue durée se multiplient, plus l’incertitude devient lourde de conséquences. D’où le développement du capital de prêt, car, avec lui, la propriété qu’a le capital d’être de l’argent qui engendre de l’argent apparaît sans mouvement intermédiaire, sans production ni circulation. Le détour par la production apparaît long, inutile, fastidieux et, de plus, aléatoire quant à ses résultats. Et encore, cette lourdeur du procès de production n’est-elle rien comparée à la rigidité des débouchés. Une surproduction chronique générale s’installe, alors que s’opposent toujours davantage la rapidité avec laquelle on peut augmenter la production et la lenteur avec laquelle s’étendent les marchés. Cette surproduction est masquée par le système de crédit.
« Dans le capital productif d’intérêt, le système capitaliste atteint la forme extrême de son aliénation et de son fétichisme[41]. » La disparition du chaînon intermédiaire des procès de production et de circulation laisse place à une formule vide de sens : l’argent crée de l’argent, le capital est une valeur qui crée elle-même mystérieusement son propre accroissement, une chose dont l’heureux propriétaire peut disposer à son gré — la dépenser comme argent, ou la louer comme capital.
« Nous tenons ici, dit Marx, la forme irrationnelle du capital, la perversion monstrueuse des rapports de productions mués en choses (…). C’est dans le capital productif d’intérêt que ce fétiche automatique trouve son expression parfaite, la valeur qui s’engendre elle-même, l’argent qui enfante de l’argent : sous cette forme, nulle cicatrice ne trahit plus sa naissance. Le rapport social se trouve achevé dans la relation d’une chose, l’argent, avec elle-même[42]. »
Cet automate (qu’on veut aussi programmable) réclame pour son fonctionnement des concentrations humaines comparables aux manufactures du XIXe siècle. A Londres, la salle des marchés de Salomon Brothers regroupe 1200 opérateurs. Comme dans l’industrie, cette concentration suppose toute une machinerie. Le capital fictif lui aussi est dominé par le capital fixe, énorme machinerie de traitement de données, de calculs, de transmissions. Comme il se doit, la science a été mobilisée, avec la classique coexistence de l’ingénieur surdoué et de la pifométrie du « savoir-faire empirique ». On a ici d’un côté une armée de mathématiciens, de statisticiens, d’informaticiens et d’économistes, et de l’autre, le gestionnaire financier en proie au désarroi, qui en est réduit au pilotage à vue, à l’« analyse chartiste » fondée sur les régularités qui apparaissent à la vue des graphiques d’évolution des cours[43]. Dans tout cela, le profit industriel devient une notion dérivée : c’est la plus-value moins l’intérêt. C’est donc ce dernier qui semble fixer la quantité du profit. Si l’intérêt est inférieur à la rentabilité économique, plus l’entreprise s’endette, plus sa rentabilité financière (donc sa rentabilité globale) s’accroît (par l’« effet de levier » positif). C’est la situation dans les années 70, jusqu’au début des années 80. Cette surdétermination du profit par l’intérêt conduit donc la « fonction financière » à prédominer dans les groupes industriels, puisque c’est la gestion financière qui, finalement, paraît déterminer le profit.
« Dans le contexte actuel, la variabilité des profits liés à la gestion financière apparaît le plus souvent supérieure à celle qui est attendue de l’activité principale de l’entreprise, notamment s’il s’agit d’activités industrielles[44]. »
Ainsi dit-on en RFA que « Siemens est une banque, avec une petite activité industrielle ». Le fait que les grands groupes ouest-allemands détiennent des actifs financiers considérables alors que leurs capitaux propres sont importants (bien plus que chez leurs homologues français) montre que la « fonction financière » n’obéit pas seulement à la logique du financement des activités économiques. Cette forme fétiche du capital, Marx dit qu’au fond elle découle des caractéristiques de l’argent. L’argent est la forme dans laquelle de la valeur (ici, du capital) existe comme valeur d’échange autonome Cette autonomie explique que l’argent, lorsqu’il prend avec le capital porteur d’intérêt la forme (l’apparence) d’un mécanisme automatique d’accroissement, cherche à s’affranchir de toute médiation, y compris bancaire.
Le capital est invariablement poussé à préférer la libre circulation des capitaux fictifs à la pesante obligation d’évaluer les risques à long terme lorsqu’il s’agit de financer la production. On le voit bien avec les nouvelles possibilités que la « mobiliérisation » offre aux entreprises. L’incertitude sur les variations à court terme des taux d’intérêt pousse toujours davantage ces entreprises à se comporter en agents financiers et à privilégier leurs interventions sur les marchés financiers. Mais la production doit cependant toujours être financée et s’accroître, parce que c’est là qu’est extraite la plus-value. Cette double tendance explique pourquoi le capitalisme présente un tableau où l’on voit d’un côté le capital accumulé (les « capitaux propres ») être transformé en capital porteur d’intérêt (c’est-à-dire être « placé », circuler sur le marché financier), et de l’autre le même groupe emprunter… pour investir.
Tant que les taux d’intérêt réels étaient négatifs, l’accumulation semblait sans limite et le système bancaire pouvait remplir sa fonction d’intermédiaire pour le financement des activités économiques. Aujourd’hui où les taux réels sont élevés (et ils le resteront tant que le dollar « devra » baisser), ce qui l’emporte c’est la restructuration des actifs industriels existants et le libre marché des capitaux. D’où cette cascade d’OPA, rendues encore plus aisées et nécessaires après le krach boursier de 1987, avec la Télémécanique, la Société générale de Belgique, etc. Des sommes énormes vont être dépensées, soit pour se protéger, soit pour conquérir de nouvelles positions.
D’un autre côté, malgré leur autonomie, ces mouvements des capitaux fictifs sont constamment nourris par la base même du système, par le développement ou le simple maintien de la production. Ils sont devenus une condition de la reproduction du capital — qui exprime au plus haut degré le caractère parasitaire de ce système en même temps que son état avancé de dissolution. C’est le système lui-même qui est parasitaire, et non sa seule « excroissance financière » comme le pensent les réformistes.
Le crédit existe en économie socialiste, du fait de l’existence de la production marchande, de la loi de la valeur. Le crédit y conserve une base monétaire puisqu’il découle de la fonction de la monnaie comme moyen de paiement. Mais il ne se forme pas un véritable « système de crédit », une véritable « monnaie de crédit », celle-ci restant tout à fait spécifique au capitalisme. La base monétaire du crédit, c’est l’argent provisoirement disponible (libéré par le mécanisme de la circulation des produits et des marchandises) : le crédit, c’est la mobilisation et la distribution de ces moyens libérés et mis à la disposition des entreprises qui en ont besoin. Cet argent est pour l’essentiel propriété sociale : il est par conséquent, dans le socialisme où n’existe plus la propriété privée des moyens de production, soumis à un contrôle social (plans de crédit ; contrôle de la destination du crédit ; garantie avec des valeurs matérielles ; remboursement dans un délai déterminé). Il ne peut donc se transformer en capital de prêt porteur d’intérêt, ni circuler et donner naissance à la monnaie de crédit.
« Dans l’économie socialiste, la catégorie de l’intérêt représente une partie de la valeur du produit pour la société, perçu par la Banque d’Etat comme paiement de l’utilisation des moyens qu’elle accorde avec le crédit[45]. »
Si le crédit a ici une base monétaire, par contre il n’existe pas de crédit commercial (qui constitue, dans le capitalisme, le point de départ de tout le système de crédit). D’autre part, le crédit ne représente pas la source de financement des investissements fondamentaux (qui sont directement financés par le budget d’Etat). Cette distinction entre le crédit pour ainsi dire « utilitaire », technique, dans le socialisme, et le crédit capitaliste par essence spéculatif, est fondamentale. Dans son analyse du procès de reproduction du capital, Marx explique bien comment une des bases de la spéculation capitaliste est constituée par les investissements de longue durée, qui immobilisent des capitaux sans contrepartie immédiate. Le capitalisme n’est pas capable de « réguler » ce phénomène. L’investissement de longue durée, c’est justement l’affirmation du caractère social poussé de la production, et qui réclamerait un contrôle social que le système capitaliste n’est pas à même de fournir. Pour le faire comprendre, Marx oppose ce système avec celui de la société communiste :
« Si nous imaginons à la place de la société capitaliste une société communiste, nous voyons disparaître en premier lieu le capital-argent, et avec lui tous les avatars des transactions qu’il entraîne à sa suite. Le problème se réduit simplement à la nécessité, pour la société, de calculer d’avance la quantité des moyens de production et de subsistance qu’elle peut, sans le moindre préjudice, employer à des entreprises (comme, par exemple, la construction des chemins de fer) qui ne fournissent ni moyens de production ou de subsistance, ni effet utile quelconque pendant un temps assez long, un an ou même davantage, mais soustraient à la production annuelle totale du travail des moyens de production et de subsistance. Dans la société capitaliste, au contraire, où l’entendement social ne s’affirme qu’après coup, de grandes perturbations peuvent et doivent sans cesse surgir. D’une part, il y a pression sur le marché monétaire, alors que, inversement, un marché monétaire libre de toute gêne provoque en masse ces entreprises, créant ainsi des circonstances qui pèseront plus tard sur le marché. Il y a pression parce que des avances d’argent-capital sur une grande échelle sont sans cesse nécessaires pour un temps assez long. Sans parler du fait que les industriels et les commerçants engagent constamment, dans des spéculations sur les chemins de fer, etc., le capital-argent nécessaire à la marche de leur propre industrie et le remplacent par des emprunts contractés sur le marché financier. D’autre part, il y a une pression sur le capital productif disponible de la société. Comme on retire constamment au marché des éléments du capital productif en y jetant simplement un équivalent en argent, la demande solvable augmente sans fournir elle-même aucun élément de l’offre. D’où hausse des prix pour les moyens de subsistance aussi bien que pour les matériaux de production. Ajoutez la pratique régulière de la spéculation et des transferts en grand de capitaux. Une bande de spéculateurs, d’entrepreneurs, d’ingénieurs, d’avocats, etc., s’enrichit. Ils provoquent sur le marché une forte demande d’articles de consommation, les salaires augmentant en même temps. Pour ce qui est des denrées alimentaires, l’agriculture reçoit sans doute une impulsion, mais comme la quantité de ces denrées ne peut augmenter brusquement en cours d’année, leur importation augmente, de même que celle des articles exotiques en général (café, sucre, vin, etc.) et des objets de luxe. D’où importations excessives et spéculation dans ce secteur commercial[46]. » 54
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Correspondance Œuvres de Marx Edition de la Pléiade – Editions sociales
Tome I, p. 407 : Contribution à la critique de l’économie politique, Editions sociales, 1957, p. 109
Tome I, p. 606 : Le Capital, tome 1, p. 85
Tome I, p. 668 : Le Capital, tome 1, p. 133
Tome I, p. 671 : Le Capital, tome 1, p. 135
Tome I, p. 681 : Le Capital, tome 1, p. 143
Tome I, p. 1164 : Le Capital, tome 3, p. 89
Tome I, p. 1213 : Le Capital, tome 3, p. 193 et p. 194
Tome II, pp. 693-695 : Le Capital, tome 4, pp. 292-293
Tome II, p. 1085 : Le Capital, tome 6, p. 325
Tome II, p. 1150 : Le Capital, tome 7, p. 55
Tome II, p. 1152 : Le Capital, tome 7, p. 56
Tome II, p. 1201 : Le Capital, tome 7, p. 140
Tome II, p. 1231 : Le Capital, tome 7, p. 177
Tome III, p. 1067 : L’Idéologie allemande, Editions sociales, 1968, p. 64.
-
Marx, Œuvres, La Pléiade, tome III, p. 1067. Les références aux textes de Marx renvoient à l’édition de La Pléiade en trois volumes (Gallimard). On trouvera à la fin de l’article un tableau de correspondance avec les Editions sociales. ↑
-
Aimé Césaire, Discours sur le colonialisme, 1950. ↑
-
La pacification, La Cité-Editeur, Lausanne, 1960. ↑
-
Discours du 10 mars 1988. ↑
-
Le Monde du 4 mars 1988. ↑
-
Cf. les textes récemment traduits aux Editions du Cerf (1988), Devant l’histoire. Les documents de la controverse sur la singularité de l’extermination des juifs par le régime nazi. ↑
-
Heidegger et le nazisme, Verdier, 1987. ↑
-
Idem, p. 13. ↑
-
Le Monde du 5 février 1988. ↑
-
Critique du Travail, le faire et l’agir, PUF, 1987. ↑
-
L’édifice pro-heideggérien repose sur des sables mouvants, puisqu’on apprend aujourd’hui que le gardien du temple, Jean Beaufret, avait commis quelques misérables petites lettres à Faurisson pour soutenir son entreprise révisionniste (Cf. Le Monde des 8 et 22 janvier 1988). ↑
-
On peut argumenter de la sorte d’autant plus aisément que, comme le rappelle Farias (op. cit., p. 307), l’utilisation à des fins scientifiques des manuscrits de Heidegger (qui se trouvent au Deutsches Literatur Archiv de Marbach) n’est pas autorisée, et ceci pour un temps indéfini. Dans la littérature, le terme « destruction des Juifs » est généralement utilisé sans mentionner l’extermination des Tziganes ni les persécutions des malades mentaux ou des homosexuels. Si nous reprenons l’expression des textes auxquels nous nous référons, nous n’oublions pas l’ampleur de la destruction raciale et raciste des nazis. ↑
-
Le Nouvel Observateur des 22-28 janvier 1988. ↑
-
Le Débat, n°48, janvier-février 1988, p. 117. ↑
-
Idem, p. 126. ↑
-
Aubenque, idem, p. 119. ↑
-
Idem, p. 124. ↑
-
Idem, p. 126. ↑
-
Du 5 janvier 1988. ↑
-
Idem, p. 126. ↑
-
Marx, Critique du droit politique hégélien, Editions sociales, 1975, p. 212. ↑
-
Marx, Oeuvres, La Pléiade, tome I, p. 1213. ↑
-
Marx, idem, tome II, p. 1201. ↑
-
Marx, idem, tome I, p. 1213. ↑
-
Cité par Le Monde diplomatique, octobre 1987, p. 21. ↑
-
Marx, op. cit., tome I, Misère de la philosophie, p. 71. ↑
-
Cité dans Problèmes économiques, n 1960 du 5 février 1986. ↑
-
45 mois d’expansion d’octobre 1949 à juillet 1953, avec un gain de 28 % du PNB et un taux de chômage de 2,5 % ; 106 mois de février 1961 à décembre 1969, avec 49 % de gain du PNB et 3,4 % de taux de chômage. Par ailleurs, avec la guerre du Vietnam, la croissance de la masse monétaire aux USA entraîna une explosion des réserves en dollars, elle-même cause de l’augmentation rapide des masses monétaires dans les pays créanciers. Ce fut un des principaux facteurs de l’inflation. ↑
-
Cité par Marx, op. cit., tome I, p. 1164. ↑
-
Le Monde du 25 janvier 1988. ↑
-
Marx, op. cit., tome I, p. 606. ↑
-
Un des meilleurs livres sur le sujet est de Suzanne de Brunhoff, La monnaie chez Marx, Editions sociales 1967, dont nous nous inspirons ici. ↑
-
« Les mouvements de ce capital monétaire sont donc, eux aussi, de simples mouvements d’une fraction autonome du capital industriel engagé dans son processus de reproduction. » (Marx, op. cit., tome II, p. 1085.) ↑
-
Marx, op. cit., tome I, p. 671. ↑
-
Marx, idem, p. 668. ↑
-
Marx, idem, p. 681. ↑
-
Marx, idem, p. 407. ↑
-
Aglietta conclut son ouvrage La fin des devises clés (La Découverte, 1986) par ces lignes : « Lorsque le degré de liberté collective n’est pas géré collectivement, l’arbitraire s’engouffre dans cette faille. Il a soit l’aspect angoissant de la rivalité toujours latente, soit la face hideuse de l’hégémonie. Le besoin d’un étage supranational dans l’institution monétaire finira par être reconnu. Car ce n’est pas une perte, mais un gain de liberté pour les nations. En instaurant la paix monétaire, la supranationalité permettra aux nations de se consacrer au bien-être de leurs citoyens et de conforter les vertus de la démocratie ». ↑
-
Marx, op. cit., tome II, p. 1231. ↑
-
Marx, idem, pp. 1231-1232. ↑
-
Marx, op. cit., tome II, p. 1150. ↑
-
Marx, idem, p. 1152. ↑
-
Cf. J. Régniez, Les nouveaux produits financiers, La Découverte, 1988, p. 108. ↑
-
J. Régniez, idem, p. 48. ↑
-
Akademia e shkencave e RPS të Shqipërisë, Ekonomia politike : socializmi, Tirana 1981, p. 371. ↑
-
Marx, Oeuvres, La Pléiade, II, pp. 693-695. ↑