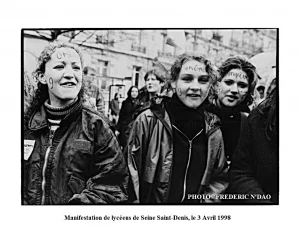Ce texte ne constitue pas un écrit politique proprement dit, il a été rédigé dans le cadre de mon activité professionnelle au Ministère de l’Education nationale. En 2004-2005, un séminaire a été co-organisé par le CEREQ et une direction de l’administration centrale (la DGESCO) dans le but d’étudier comment les nouvelles normes de certification pouvaient changer la nature des diplômes. J’ai rédigé cette note pour exposer mon point de vue, note qui n’a pas été publiée, mais simplement diffusée auprès des participants au séminaire et auprès de certains collègues.
En 1992, j’ai assisté à une Université d’été du Ministère dans laquelle le CNPF (ancêtre du MEDEF) était invité à s’exprimer. L’un de ses représentants, membre éminent de l’actuel Comité des Forges (c’est-à-dire de l’UIMM) a affirmé que le patronat avait pour but de liquider les conventions collectives (issues du Front populaire, puis de la Résistance avec les accords Parodi de 1945) : « cela prendra trente ans », ajoutait-il. Grâce à l’opposition du mouvement ouvrier, il en faudra davantage, mais le processus est bien engagé. Il passe par la destruction du lien entre qualification et diplôme (ou son équivalent en termes de durée de formation ou d’expérience professionnelle), lien qui est au cœur de la classification, et donc de la grille des salaires. La méthode la plus efficace a consisté à séparer le diplôme de la formation, puis de morceler l’un et l’autre en modules de compétences toujours plus étroits. Au-delà de la destruction du système diplôme-qualification, cet éclatement poursuit deux objectifs. Permettre une marchandisation et de la formation (elle existe depuis longtemps mais a été ainsi dynamisée), et de la certification : un vaste marché de l’une et de l’autre s’est développé, dont le volume financier approche celui du Ministère de l’Education lui-même. Le second objectif est d’affaiblir la transmission des savoirs, que la classe bourgeoise a toujours cherché à entraver. Presque vingt ans après la rédaction de cette note, le processus destructeur qu’elle décrit est bien avancé. Pourtant, la question de la formation du cœur de la classe ouvrière (ouvrier, employé, technicien) reste la grande absente des luttes sociales et politiques.
____________________________________
Note de janvier 2005
| Le capitalisme a exigé davantage… Il lui a fallu des méthodes de pouvoir susceptibles de majorer les forces, les aptitudes, la vie en général sans pour autant les rendre plus difficiles à assujettir
Michel Foucault, Histoire de la sexualité, I La volonté de savoir « Je retournerai pas à l’école parce que à l’école on m’apprend des choses que je sais pas » Le petit Ernesto, dans La pluie d’été de Marguerite Duras ___________________________ |
Depuis ses premiers travaux, notre séminaire tourne autour de la question suivante plus ou moins explicitement : le modèle du diplôme (mais quel est-il exactement ?) est rongé de toute part, sans qu’apparaisse clairement un modèle de substitution. Ce changement est installé par petites touches qui semblent dépourvues de signification en elles-mêmes, processus bien décrit par certains auteurs comme Annie Vinokur (« le changement sans réforme »[1]) ou Dockès (le « stroboscope »[2]). L’analyste se heurte alors à la redoutable difficulté de reconstituer morceau par morceau le modèle émergeant, au prix d’une grande liberté d’interprétation, dont les errements ne peuvent être limités que si les contradictions des mouvements en cours sont bien prises en compte.
C’est dire que les quelques considérations hâtives qui suivent sont exposées dans le but de nourrir le débat.
Par ailleurs, il est difficile de ne pas apparaître comme le champion du courant méritocratique lorsqu’on parle depuis une institution dont c’est la philosophie naturelle. Il n’est donc pas inutile de rappeler que, pour nous, le diplôme n’a pas de valeur[3] en lui-même, qu’il reçoit cette valeur de son appartenance à un système, le système diplôme-qualification-salaire (que nous nommerons le SDQ), dans lequel il ne joue pas le rôle déterminant. Le diplôme ne produit pas une hiérarchie sociale, il n’est pas un facteur de classement des individus le long d’une échelle sociale, même s’il en a hélas toutes les apparences : c’est pourquoi, entre autres, nous ne feindrons pas de nous étonner que la forte hausse du niveau de diplôme de la population a très peu d’effets sur la fluidité sociale[4].
Nous souhaitons donc d’emblée lever tout malentendu : loin de défendre le modèle méritocratique, nous estimons qu’il ne constitue pas une alternative au cours actuel des choses. Quel que soit le jugement porté sur lui (et à nos yeux il est détestable), il est plus important de souligner qu’il tient du rêve chimérique, puisqu’il ne pourrait fonctionner que dans un système éducatif non seulement autonome (ce qu’il est), mais indépendant des forces sociales qui l’entourent et qui nécessairement le composent. Il n’aurait alors aucune fonction économique.
Notre hypothèse est la suivante : le SDQ, dont nous dessinerons peu à peu les contours, persévère dans l’être en dépit de tout, en dépit des nouvelles idées qui tantôt le déclarent obsolète, tantôt cherchent à le ruiner. Pourtant, les éléments de sa désintégration se mettent en place. Le diplôme est noyé dans un ensemble désormais officiellement désigné comme l’univers de la certification. L’étape suivante est en cours, qui verra la certification noyée à son tour dans l’ensemble encore plus vaste et plus flou du certificat, de la simple attestation accompagnant chacun des gestes de la vie scolaire et professionnelle. Ce mouvement se poursuit sans que soit clairement établi quel système se substituera au SDQ. Du coup, le diplôme reste une référence qui devient quasi absolue et magique. La situation est intenable. Le Ministère de l’Education nationale reçoit l’injonction de délivrer un objet, le diplôme, plus nécessaire que jamais, mais proclamé sans valeur ou accusé de tous les maux. Une institution ne souffre pas ; mais que dire des personnes, des jeunes en particulier, qui sont priés de ne pas concourir à « l’inflation des diplômes », et à qui l’on dit que la formation ne vaut plus rien (ah ! l’expérience, le travail, dès quatorze ans !) tout en les sommant d’y revenir « tout au long de la vie » ?
Démonter ces apparents paradoxes permettra de voir quels sont les éléments du SDQ qui bougent réellement, et avec quelles conséquences pour les constructeurs de diplôme.
1. Du système à l’individu
La séparation entre certification et formation[5] a conduit à une neutralisation de la durée de formation et, de proche en proche, de la formation elle-même. Cette réduction, au sens chimique, ébranle le SDQ tout entier. En retour, les objets qui le composent perdent leur substance sociale. La désagrégation du diplôme et de la qualification laisse place à une réalité segmentée, chosifiée, où l’individu doit prouver sans relâche qu’il détient de multiples compétences comme autant de qualités intrinsèques, où il doit porter lui-même sur ses pauvres épaules le fardeau toujours plus lourd des petites attestations, exhibées comme autant de signes de sa valeur propre, que la société saura lui opposer le jour venu pour lui expliquer que sa situation de chômeur ou de non qualifié vient de son incapacité personnelle[6].
Ce passage du système à l’individu appartient au vaste mouvement qu’une expression peu heureuse dénomme individualisation des rapports sociaux. Une illustration en a été fournie lors d’une séance récente de notre séminaire, avec la présentation du portage individuel de la qualification (PIQ).
Le « portage individuel de la qualification » (PIQ), un oxymore
La proposition de la CGT pour un « Nouveau statut du travail salarié » est aujourd’hui présente dans les discours d’autres syndicats, de certains experts, et du gouvernement lui-même[7]. Pour la CGT, elle repose sur l’idée que tout salarié doit pouvoir bénéficier d’un cumul de ses droits, quels que soient les avatars de sa carrière. Les droits (concernant notamment le salaire, la classification, la convention collective) passeraient donc d’une relation contractuelle avec un employeur (individuel, ou collectif comme la branche) au salarié lui-même et lui appartiendraient en propre du début à la fin de sa vie professionnelle. Cette propriété individuelle des droits offrirait une garantie interprofessionnelle, transposable d’une entreprise à l’autre et opposable à chaque employeur. Même si la CGT insiste sur le côté collectif des droits octroyés aux salariés dans ce nouveau statut, il s’agit en fait d’un droit attaché à l’individu salarié, qui le suivrait tout au long de sa carrière, indépendamment du collectif de travail.
Au fil des années, les discours des responsables du syndicat donnent une coloration particulière à cette revendication en l’associant à un changement de régime du rapport salarial. Maryse Dumas par exemple indique : « Dans les quinze ans qui viennent, la moitié des salariés actuels sera partie en retraite, et avec eux une bonne partie des référents qui ont structuré les relations de travail depuis la libération ». Bernard Thibault enfonce le clou, en exposant que l’époque a changé, que nous ne sommes plus dans celle où l’essentiel du droit social était construit sur des bases professionnelles (dans le cadre des conventions collectives de branches[8]). Dans les débats nourris au sein de la CGT sur cette question du nouveau statut, nombre de syndicalistes ont d’ailleurs mis en doute la compatibilité du PIQ avec les conventions collectives.
Il faut souligner ici l’ampleur de l’attaque contre le SDQ. Cette question du rôle de la branche est essentielle : c’est à elle que l’Etat a délégué le rôle de « dire la loi ». Lui enlever ce rôle revient à s’en remettre d’un côté à l’entreprise (la CGT dénonce pourtant avec force la mise en cause de la hiérarchie des normes conventionnelles par la loi sur la formation professionnelle et le dialogue social du 4 mai 2004), de l’autre à l’Etat[9]. Ce dernier ne peut qu’avoir un rôle essentiel dans le dispositif proposé. Si le rapport salarial capitaliste demeure, qui suppose l’entière liberté d’embauche de l’employeur, l’Etat sera contraint d’intervenir d’une part pour forcer l’employeur à tenir compte des « droits accumulés » individuellement par le nouvel embauché (et on ne voit pas comment il le fera dans le contexte actuel), d’autre part pour garantir les droits du salarié entre deux contrats, mais dans une logique d’assistanat.
C’est pourquoi la discussion introduite au séminaire sur le PIQ est importante et devrait être prolongée : nous sommes bien devant la thèse d’un nouveau régime de relations sociales. Dans l’ancien modèle, les droits collectifs sont liés au salaire grâce au salaire socialisé (dans lequel l’Etat n’a aucun rôle de principe, et dans lequel l’argent circule en dehors des circuits financiers étatiques ou privés). Une part croissante des revenus liés au travail est détachée de l’individu (et donc du « travail individuel ») et relié au collectif des salariés. Bernard Friot[10] a mis en évidence l’opposition entre deux systèmes : dans l’un, qu’il nomme le système propriété/solidarité (l’Europe anglo-scandinave), les droits sont redistribués par une démarche individuelle, l’épargne salariale, et par la solidarité de l’impôt redistributif. Dans l’autre, le système du salaire socialisé (France), les droits ne sont pas re-distribués mais distribués directement grâce à la cotisation sociale qui est une partie intégrante du salaire. Ce système se fonde non pas sur l’individu (épargnant ou imposé), mais sur le travailleur collectif, inséré dans un système d’emplois où l’emploi octroie et finance (par le salaire socialisé) des droits hors du travail (chômage, maladie, handicap, retraite, etc…). Ainsi, le salaire « est la distribution politique de la part de la valeur créée par le travailleur collectif qui retourne aux travailleurs, employés ou non[11] ».
Or, il nous semble que le SDQ tire sa configuration et sa force du système du salaire socialisé, et qu’il serait utile d’examiner les liens entre les deux structures, leur parenté, leurs traits politiques communes. Cette étude est devant nous, mais constatons au moins que la mise en cause de l’une va de pair avec celle de l’autre, au nom de l’individualisation.
L’attrait du PIQ vient de ce qu’il semble donner à la « qualification de la personne » la prééminence sur la « qualification du poste ». Ce point mérite d’être examiné car il pose le problème du statut de la qualification et du diplôme.
Le rapport salarial est contradictoire : il est établi entre deux personnes réputées égales, pourtant l’une aliène… quoi précisément : sa vie, son temps, son travail ? La réponse pratique a consisté à distinguer la force de travail de la personne qui en est le vecteur. Une personne ne peut aliéner sa liberté contre de l’argent : on va donc dire que ce n’est pas la personne morale (appelons-là ainsi) qui est aliénée, mais « simplement » sa puissance technique de travail. Toute l’histoire du droit du travail, construite par les luttes sociales, consiste à réduire au maximum l’usage technique de la force de travail, et à augmenter le plus possible les droits de la personne (notamment hors du travail : maladie, chômage, retraite)[12].
A l’opposé, les employeurs défendent la conception d’une qualification liée au poste, point de vue solidement établi depuis l’apparition des critères classants[13]. Toutefois, la qualification, attribut de la personne, n’est pas niée : les employeurs sont réalistes, ils ont besoin de cette référence, tout leur effort consistant à conserver la maîtrise des conséquences de son attribution. La qualification liée à la personne est pour l’employeur virtuelle – la personne est considérée en tant que puissance de travail, c’est-à-dire travail en puissance. Cette qualification n’est donc pas prise en compte a priori (elle ne l’est qu’implicitement), mais uniquement lorsqu’elle s’exprime quand le salarié est à son poste de travail. D’où cette idée qu’elle doit être constamment évaluée, en situation, et par le seul employeur (c’est la fameuse gestion par les compétences). Le temps d’apprentissage est mis entre parenthèse, neutralisé en quelque sorte (car il est indissolublement lié à la personne), au profit des fameux résultats d’apprentissage (liés au poste)[14] – les conséquences en seront tirées dans la deuxième partie.
Quelles conséquences pour le diplôme ?
Le poste sans la personne n’est pas grand-chose, mais la personne sans le poste n’est rien. Oublier que le salarié n’est qu’une puissance de travail (c’est-à-dire un travail en puissance qui réclame d’être mis en contact avec les moyens de son exercice) conduit à des errements théoriques et pratiques redoutables qu’une longue tradition syndicale avait su éviter jusqu’alors, en comprenant que la qualification n’était pas un attribut de la personne, mais une réalité générique et conventionnelle, pour tout dire politique.
Traditionnellement, les syndicats revendiquent que la qualification/personne soit reconnue par le droit du salarié d’occuper un poste conforme à sa qualification et d’être rémunéré en conséquence. La reconnaissance de la qualification est nécessairement liée au poste occupé. La qualification s’est construite (et avec elle le SDQ) dans cette liaison entre qualification/personne et qualification/poste. Il ne saurait en être autrement tant que la définition des postes et l’allocation de la main-d’œuvre sont entièrement aux mains d’une des parties, les employeurs. Que le monde du travail, pour limiter cette toute puissante, ait mis en avant la qualification/personne ne doit pas aller jusqu’à l’illusion que celle-ci appartiendrait à l’individu, qu’elle serait une qualité qui lui donnerait, en tant que telle, un quelconque pouvoir de négociation. Cette illusion n’était pas trop répandue autrefois, à une époque où la qualification appartenait clairement à un système impersonnel d’où elle tirait sa force, en liaison avec un autre système impersonnel et collectif, celui du salaire socialisé.
Bref, tant que le rapport salarial existe tel qu’il est aujourd’hui, le salaire lié au poste (et définissant la hiérarchie des postes[15]) sera déterminant. Pour échapper en partie à l’implacable (et souvent arbitraire) hiérarchie des postes, les salariés ont contribué à mettre sur pied un système de qualification conventionnelle, où la qualification est générique, elle est un bien impersonnel, qui donne des marges d’action à l’individu par le biais du collectif. Le diplôme tire son sens de ce système auquel il appartient, et qui donne sa couleur singulière à sa méthode de construction comme à la structure du référentiel qui le compose.
Mais ce sens est caché. Les apparences, les discours, les enquêtes, voire les théories concourent à faire du diplôme l’élément déterminant de la qualification et du salaire[16], brouillant la dialectique des relations entre formation et emploi au cœur du SDQ. C’est parce que l’éducation est extérieure au travail que le diplôme a une valeur, mais une valeur extrinsèque, conféré par le monde économique. Il n’y a pas ici d’échange entre un individu, possesseur de son « capital humain », et un employeur qui lui distribuerait un salaire[17]. Contrairement aux apparences, c’est le salaire qui définit les niveaux de qualification et non l’inverse.
La difficulté de saisir le lien entre qualification et rémunération conduit le plus souvent à rendre obscur le rôle de l’éducation dans le salaire, d’autant plus qu’au plan micro-économique la relation entre niveau de formation et salaire est forte. L’éducation est une composante du salaire par le biais de la qualification. Si l’éducation sort du SDQ, ou si celui-ci est désintégré, la liaison entre formation et salaire a toutes les chances de s’affaiblir, voire de disparaître. Les bas salaires actuellement distribués à une grande partie des jeunes quel que soit leur niveau de formation tendent à vérifier cette hypothèse. Des dizaines de « mesures – jeunes » (qui composent en France cette « politique de l’emploi » si particulière) conduisent à sortir une partie des jeunes du SDQ. Les conséquences sur le salaire sont immédiates.
L’éducation est une composante du salaire d’une manière particulière. Elle cumule des traits singuliers que ne possèdent pas les moyens de subsistance qui compose le salaire comme la nourriture, le logement, la voiture, etc.
Elle déborde immédiatement et de toutes parts le cadre étriqué du rapport salarial, dans la mesure où son but est de transmettre des connaissances dont l’amplitude est difficile à cerner, et qui transforment l’être humain qui s’en imprègne plus radicalement et définitivement que la nourriture, le logement ou la voiture. C’est pourquoi tant d’obstacles ont été dressés dans le mouvement d’éducation de la force de travail, mouvement contradictoire qui doit sans cesse franchir les bornes qu’on lui impose[18]. Les employeurs ont toujours exprimé la crainte de « donner aux ouvriers un excédent de bagage théorique », comme le rappelle Guy Brucy[19], et ce n’est pas un DIF de 20 heures par an qui va changer la donne.
Pourtant, l’éducation a ceci de commun avec les autres moyens de subsistance qui forment le salaire d’être extérieure au processus de travail. La tendance actuelle qui consiste à la ramener (en partie) à l’intérieur du processus de travail (« le travail forme », « l’entreprise formatrice ») ne sera pas sans conséquences. Dès que l’éducation est incorporée au processus de travail, elle sort du salaire. L’esclave qui reproduit sa force de travail au sein même du processus de travail ne reçoit pas de salaire. En règle générale, ce qui s’acquiert dans le procès de travail ne reçoit pas une valeur s’inscrivant dans le SDQ. C’est la raison pour laquelle la VAE (validation des acquis de l’expérience) pose tant de problèmes et qu’elle amènera inéluctablement les employeurs à abaisser la valeur du diplôme ainsi obtenu comme ils ne cessent de le proclamer. C’est pour cette même raison que les CQP s’inscrivent dans un système parallèle au SDQ[20] et que les organisations d’employeurs refusent de leur affecter un niveau[21].
Ce n’est pas seulement l’éducation passée qui compose le salaire, mais celle future (celle des descendants), à la manière du prix de certaines marchandises qui contiennent une part des investissements nécessaires pour en assurer la production future. Les salaires plus élevés qui organisent l’échelle des postes qualifiés tiennent compte de cette reproduction d’une formation plus élevée. Cette fonction permet d’expliquer la persistance des inégalités entre classes sociales en matière éducative (car elle en assure la reproduction), malgré la hausse générale du niveau d’éducation[22].
Si la valeur du diplôme lui vient de l’extérieur, elle ne lui est pas pourtant attribuée par hasard. Lors des journées DESCO/CEREQ de septembre 2001, Jean-Paul de Gaudemar présentait le diplôme comme une « monnaie »[23]. Poursuivons la comparaison. Si une marchandise spécifique, l’or, a fonctionné comme équivalent général, c’est en vertu de ses qualités cette fois intrinsèques. Il en va de même pour le diplôme. Si la valeur de l’apprentissage s’est cristallisée dans le diplôme de l’Education nationale, c’est pour ce qu’il est dans le système éducatif : à savoir d’une part le résultat d’un apprentissage méthodique et complet, long, parfois si long, et d’autre part le parchemin sollicité par un million de candidats chaque année.
Où l’on retrouve donc inéluctablement la formation, la durée et…. la masse.
Le fétichisme de la certification
Qu’en est-il du diplôme et de la norme ? Le diplôme est-il une norme par lui-même[24] ? Sinon, quel est son rapport avec une norme dont il serait un des éléments ou une des connexions ? Vaste question qu’il serait nécessaire de traiter dans la suite du séminaire et que nous ne pouvons qu’effleurer ici.
Vaste question car elle renvoie à la nature et au statut de la connaissance. A partir du moment où la formation a été neutralisée (voir deuxième partie), la connaissance s’est effacée derrière le diplôme, qui peut dès lors être désigné comme une norme ou apparaître comme tel. Si la connaissance s’est effacée, elle ne s’est pas pour autant évaporée, mais sa consistance sociale n’est plus appréhendée. Elle devient une chose appartenant à l’individu, qui se présente comme une qualité intrinsèque qu’il doit à tout moment exhiber. Le fétichisme de la certification dissimule le lien réel entre diplôme et connaissance, qui persiste tant que le SDQ n’est pas entièrement brisé.
Avançons ici quelques idées qui mériteraient des pages de développement, mais qu’il est nécessaire d’indiquer même brièvement pour la suite de notre propos.
La connaissance ne saurait se conformer à des critères normatifs ou prédictifs : on pourrait dire d’elle ce que Georges Canguilhem disait des normes organiques qu’il décrit comme nécessairement intérieures, immanentes à la vie [25]. Si le diplôme est une norme, ou se réfère à une norme, il ne tient pas cette qualité d’une normalisation de la connaissance. Or, ce qui est en train de se passer avec le système hybride qui se met en place, c’est le transfert de la normativité propre au SDQ au sein de la connaissance elle-même, dans la production de la connaissance, dans les exigences imposées aux personnes en matière de connaissance.
Lors de la présentation du survey consacré aux effets de l’éducation[26], Christian Baudelot avait très justement rappelé qu’on ne sait pas véritablement dire ce qu’une personne sait. Un examen ne sert pas à dire ce qu’une personne sait, mais à montrer qu’elle est apte à obtenir un titre, un grade, une fonction (toutes choses qui appartient à un système de normes extérieures à la connaissance). A l’opposé, les nouvelles idées affirment qu’il est possible et nécessaire de savoir ce qu’une personne sait, quelles sont ses compétences, ses connaissances, et que tout cela doit être transparent et visible à tout moment
Ecoutons une fois encore le petit Ernesto, qui dit de la connaissance qu’elle « est comme un vent qui ne s’arrête pas. Un vent qu’on ne peut pas attraper, qui ne s’arrête pas, un vent de mots, de poussière, on ne peut pas le représenter, ni l’écrire ni le dessiner[27].
Malgré toutes ses imperfections, le SDQ laissait a priori la personne libre d’être traversée, portée, transportée par le souffle de la connaissance. Si le diplôme reste extérieur à la connaissance, il est cependant entièrement adossé à un système qui organise les lieux où la connaissance est transmise (et en partie produite). Si le diplôme ne peut « attraper » la connaissance, il sert néanmoins de jalon, il agit comme une cote, dans les divers usages du terme, marque servant à un classement mais aussi repère dans un parcours, il est une médiation entre ce que son titulaire sait et ce qu’il est capable de faire ou de savoir plus tard. Il est construit comme tel et cette qualité étrange, qui le rend parfois insaisissable comme la connaissance elle-même[28] vient de ses multiples liens avec divers univers sociaux et les agencements qui les organisent. La certification (en tant qu’attestation de petits savoirs ou savoir-faire limités, qui seraient incorporés dans l’individu) rompt ces liens, interrompt cette médiation entre passé et avenir (d’où cette certification « tout au long de la vie », ce « contrôle continu »), elle devient un fétiche à la fois sacralisé et dépourvu de sens et de valeur.
De surcroît, dès lors que les qualités instituées par un système impersonnel sont censées être des qualités intrinsèques de l’individu, les exigences imposées à la personne deviennent infiniment plus puissantes. Inévitablement, on passera de la qualification générique à une liste de compétences personnelles qu’il faudra sans cesse allonger. Paradoxalement, le diplôme sera exigé cette fois comme attribut de la personne, perdant son caractère de référence, qui autorisait des individus non diplômés à occuper des postes d’un certain niveau. Selon l’expression consacrée, le diplôme sera « plus nécessaire que jamais, mais moins suffisant ». Quel progrès !
Le processus d’individualisation des rapports sociaux entraîne un changement de sens de la norme qui affecte considérablement le rôle du diplôme. Dans le SDQ, le diplôme n’est pas une norme en soi. La norme est construite par la relation établie entre deux systèmes autonomes, formation et emploi. Elle appartient à une normativité partagée, impersonnelle, dans lequel l’individu peut s’inscrire librement. Les nouvelles idées rabattent la norme sur l’individu. D’où cette illusion mortifère de l’auto-construction des parcours individuels : l’individu construit son propre parcours de formation, d’emploi, sa propre employabilité, etc. Or, seule la normativité dotée d’une structure symbolique impersonnelle permet l’échange, la relation et, finalement, la subjectivité[29].
Ce n’est certainement pas un hasard si en 1980, au début des années « compétences », dans un séminaire destiné aux managers, Michel Fustier écrivait : « Si nous voulons nous comprendre, parlons le même langage qui est un langage d’action et non un langage de mots. Communiquer, non de parole à parole, mais d’être à être »[30].
D’être à être, directement, sans intermédiaire, sans système, sans institution, d’employé détenteur de son petit capital humain, à employeur détenteur du capital non humain, sans passer par ce long détour de la formation, sans l’école, ce lieu où l’on sait perdre son temps[31]
Toujours dans ces années 80, décidément fertiles en nouvelles idées, Yves Cannac avait déclaré lors d’un colloque organisé par la CEGOS sur « la bataille de la compétence » (1984) : « Face au savoir institué, qui a les caractères d’un bien public, la compétence professionnelle présente les traits d’un bien privé ». Au fond, tout est dit.
La valeur du diplôme peut apparaître comme étant la propriété de la personne qui accroche son parchemin dans sa chambre. Mais dès qu’il sort de ce cloître pour entrer dans le SDQ, le diplôme ne peut exprimer sa valeur que dans un rapport social agencé par la qualification, laquelle permet à l’apprentissage cristallisé dans le diplôme d’être pris en compte dans le salaire. C’est ce rapport social qui institue la valeur du diplôme, et qui seul peut l’inscrire dans une norme. Les illusions s’installent lorsque, oubliant cette réalité sociale, les nouvelles idées transforment ce qui est relatif en quelque chose d’absolu : le diplôme est alors sacralisé tout en étant récusé.
Pour conclure, il faut souligner une fois de plus que nous sommes davantage dans la destruction d’un système que dans la construction. Les nouvelles idées continuent à avancer en dépit des échecs rencontrés dans leur application. Pour l’instant, il est apparu impossible de reconstruire le système de repérage de la force de travail sur la base du jugement de l’individu et de la croyance en la transparence de ses compétences, dans tous les domaines (knowledge, skills, competencies dans les textes de l’UE, competencies regroupant aussi les comportements aux confins de la psychologie et de la morale).
Il est intéressant ici de souligner les apories auxquelles aboutit le projet européen de nomenclature des certifications (dit EQF) : ce cadre cherche à classer (en huit niveaux) des individus, en étalonnant leurs savoirs, savoir-faire (réduits à des learnings outcomes), compétences techniques, comportementales et morales. La contradiction est ici portée à son plus haut degré : les experts européens ont oublié qu’on ne peut classer des individus, mais seulement des groupes sociaux – un tel classement ne peut que renvoyer à une hiérarchisation sociale qui lui préexiste, et non à des jugements individuels sur la personne. Pour cette raison, la nomenclature proposée est à la fois inopérante et inacceptable (parce qu’elle décrit a priori ce que doit être un individu : par exemple, un individu peu formé sera nécessairement pourvu d’une maigre conscience sociale, incapable d’autonomie, peu disposé à apprendre, etc.).
Les apories d’EQF viennent de l’illusion que l’on peut classer des individus. Les experts européens auraient pu relire avec profit La barrière et le niveau (publié en 1925, dernière édition 1984 chez Gérard Monfort). Dans ce savoureux ouvrage sur la bourgeoisie et la distinction bourgeoise, Edmond Goblot démontre que toute démarcation sociale est à la fois barrière et niveau. Autrement dit, « tout nivellement distingue, toute distinction nivelle ». Une distinction individuelle n’a aucun sens.
2. La durée de formation, c’est fini ?
Au sein du système éducatif, la porte par laquelle les nouvelles idées sont entrées pour disloquer le SDQ, c’est la dissociation formation – certification, comprise comme mise entre parenthèse de la durée de formation[32]. Pourtant, l’éviction progressive de la référence à la durée d’apprentissage n’était pas nécessairement inscrite à l’origine du processus de dissociation.
Dans cette partie, le système éducatif joue à contre-emploi, puisque formation et durée de formation son consubstantielles, et que la durée de formation reste une référence économique essentielle (du moins tant que le SDQ demeure, même sur une base vacillante.
Dans leur vaste survey sur les effets de l’éducation, Baudelot et Leclercq rappellent que la corrélation entre le nombre d’années d’études effectuées par un individu et son salaire constituent l’une des « régularités empiriques les mieux établies en économie, quelles que soient la zone géographique et la période considérée »[33]. Comprendre la nature de cette réalité est une autre affaire, qui fait l’objet d’une copieuse littérature. Mais dans tous les modèles proposés, c’est bien la durée de l’apprentissage qui est pesée. Dans les enquêtes françaises, les diplômes sont liés à des « niveaux de formation », eux-mêmes étalonnés selon la durée des études. Dans le système qui relie diplôme, qualification, classification et salaire (le SDQ), c’est la durée, tant de la formation que de l’expérience, qui permet de relier les divers objets.
Aujourd’hui pourtant, la durée de formation est niée de deux manières. La première appartient depuis longtemps aux avatars de la négociation salariale et est sans conséquence sur le diplôme et le système éducatif. Mais l’autre, plus récente, en constitue un ferment de dissolution. Examinons ces deux registres.
La durée de formation, niée dans les discours, reconnue dans les faits
Le SDQ s’est construit dans la confrontation qui oppose employeurs et salariés, et qui se rapporte au niveau du salaire. Il est donc traversé de luttes, soumis à des tensions et forgé par des compromis successifs. Nous avons rappelé plus haut que, pour l’employeur, déprécier le rôle de la formation comme celui de l’expérience pour lui substituer un jugement sur les compétences de la personne, qui ne pourraient être évaluées qu’en situation, est de bonne guerre. Cette contestation trouve néanmoins ses limites dans la nécessité pour l’employeur de disposer de règles, d’une sorte d’assurance visant à limiter les coûts d’embauche et le dumping (le niveau de qualification est lié à un salaire conventionnel). Le SDQ constitue un terrain de compromis autour de règles soumises à de fortes tensions, mais qui sont relativement bien définies.
Pourquoi le compromis est-il possible ? Parce qu’il est nécessaire en raison même de la nature du rapport salarial, dans lequel les employeurs ne sont pas en mesure d’assurer par eux-mêmes les conditions de l’exploitation de la main-d’œuvre. De manière plus générale ils ne sont pas en mesure d’assurer par eux-mêmes la continuité du circuit économique[34]. Cette limite ouvre la possibilité du compromis, sans que soient nécessairement mises en cause les bases du rapport salarial.
Même mise entre parenthèse dans la négociation salariale, la durée de formation reste la référence obligée, comme en témoignent la multiplication de la mention des diplômes dans les conventions collectives[35].
Une durée de formation neutralisée par le système éducatif lui-même
L’employeur a intérêt à soutenir la séparation du savoir et des compétences, à affecter son mépris pour l’un et ses faveurs pour les autres. Mais pourquoi le système éducatif tiendrait-il pour vrai ce qui fait l’ordinaire tactique du patronat ? C’est un mystère que nous n’avons pas complètement éclairci, mais dont nous pouvons néanmoins mesurer toute l’épaisseur.
L’éviction de la durée de formation vient d’une confusion sur ce qui fait la valeur du diplôme : confusion entre la valeur extrinsèque (qui lui est conférée par la sphère économique et par son appartenance au SDQ) et sa valeur intrinsèque, qui est d’être une condensation d’un apprentissage méthodique et complet. Cette confusion a gagné le système à partir du moment où la mise en relation entre la formation et l’emploi s’est traduite par le déplacement de l’ordre scolaire à l’ordre des qualifications, selon les termes de Lucie Tanguy[36].
En prenant progressivement en charge lui-même la valorisation économique du diplôme, en s’attribuant un objectif d’insertion et de qualification[37], le système éducatif a peu à peu modifié la représentation que ses acteurs pouvaient avoir du rôle de l’éducation. L’autonomie du système éducatif (condition de son appartenance au SDQ) est amoindrie et entraîne une confusion entre ce qui appartient en propre aux deux sphères, éducation et travail. Au point que le système éducatif ne produirait plus que des « résultats d’apprentissage » (eux-mêmes décrits en termes de compétences), alors que de son côté le travail formerait. Ainsi, ce qui est le propre du travail est réputé être le fruit du système éducatif, quant à la formation, elle passerait du côté du travail.
C’est cette confusion qui rend nécessaire la mise de côté de la durée de formation, sa neutralisation. Si ce qui importe c’est le résultat d’apprentissage décrit en termes de compétences, quel que soit le processus qui a conduit à ce résultat, alors la mesure de la durée n’est plus utile ou n’a même plus de sens[38].
La mise en avant dogmatique des learnings outcomes conduit certains acteurs du système éducatif à une négation magique de la durée de formation (et donc de la formation elle-même, puisque les deux sont consubstantielles) et à tomber dans les paradoxes du brave mais fantasque Dogberry : « Être un homme bien fait est un don des circonstances, mais savoir lire et écrire, cela nous vient de la nature »[39] ;
De ce fait, la quête de la valeur économique est sans fin, puisqu’elle ne peut venir que de l’extérieur du système. Et les éléments qui fondent la valeur du diplôme changent de signe : l’apprentissage méthodique et complet devient un obstacle empêchant l’individu d’accéder au titre, le nombre de candidats devient synonyme « d’inflation scolaire » ou « d’inflation de diplômes ». Le système éducatif est pris dans une contradiction qui le rend incapable d’affirmer une quelconque volonté politique
Mise en place d’un système hybride
Cette paralysie vient du fait que la durée de formation demeure dans la réalité un élément essentiel : ceux qui la nient magiquement n’ont alors plus prise sur le réel. Tant que l’éducation se fera pour l’essentiel hors des lieux de travail, dans un système autonome[40], la qualification sera nécessaire pour mettre en relation la formation et l’emploi.
C’est pourquoi le temps de formation apparaît dès les premières grilles de qualification mises en place par l’Etat pour réguler les salaires au cours de la première guerre mondiale[41]. Par la suite, dans la première convention collective moderne (juin 1936), la hiérarchie des emplois, mesurée en temps de formation, fait apparaître le diplôme lorsque le temps d’apprentissage dépasse une certaine longueur. Quelques jours (manœuvre spécialisé), quelques semaines (O.S.) : cet apprentissage court était à l’époque à la charge de l’entreprise. La référence au CAP apparaît à partir de l’OP (l’ouvrier professionnel). En construisant la nomenclature des niveaux de formation, les planificateurs des années 60 ne faisaient que condenser un principe qui existait déjà, dont Pierre Naville avait souligné le sens en 1956 lorsqu’il avait vu que, avec les grilles de classification Parodi, la « qualification passait de la sphère du travail à celle des relations entre la formation et l’emploi salarié[42]».
Le mouvement paraît aujourd’hui inverse mais aussi frappé de deux impulsions contraires. D’un côté, s’affirme la tendance à désintégrer la base de la qualification (la relation formation emploi) en poussant celle-ci vers la sphère du travail où elle se dissout dans la multiplicité confuse des compétences individuelles[43]. Mais en même temps, un autre mouvement prend une autre direction qui tend à rabattre la qualification entièrement du côté du système éducatif et lui impose le même type de désintégration : la formation disparaît, dissoute dans l’univers des compétences, l’unité du diplôme se fragmente en « unités » prêtes à prendre leur autonomie[44].
Un système hybride se met en place, où l’une des parties, le système éducatif, prend aux mots, et même souhaite prendre en charge, ce que l’autre, le système productif, ne parvient pas à réaliser, le classement des individus selon leurs compétences individuelles[45].
La critique du diplôme, une critique molle
Les nouvelles idées se veulent une critique du diplôme, présenté comme trop sélectif et prédictif (il déterminerait la position sociale du titulaire une fois pour toutes). Toutefois, cette critique du modèle actuel du diplôme reste assez faible, en comparaison des analyses qui éreintaient le système éducatif dans les années 60-70. C’est pourquoi j’ai utilisé l’expression « modèle rongé, miné », plutôt que modèle critiqué. Ce genre de pseudo-critique peut conduire paradoxalement à renforcer le modèle dans ce qu’il a de plus contestable, les inégalités d’accès au savoir.
La critique ne propose pas de toucher aux fondements du système inégalitaire, alors qu’une abondante littérature souligne le rôle déterminant de l’origine sociale. La théorie déjà ancienne du capital humain de Gary Becker elle-même a montré le rôle des inégalités sociales, notamment par le cumul des « effets d’opportunités » et de « capacités » chez ceux qui disposent d’un fort capital économique au départ[46]. Les nouvelles idées restent bien en deçà et limitent la critique au simple constat que le travail scolaire produit des capitaux (humains et culturels) d’inégale importance, et qui ont des effets inégalitaires sur la position sociale (profession et revenu). Les nouvelles idées inversent le propos des anciens courants qui, pour la plupart, regrettaient le manque d’autonomie du système éducatif à l’égard d’un système productif générateur d’inégalités, ou bien mettaient en évidence que sa relative autonomie n’empêchait pas la reproduction des inégalités sociales. A l’opposé, les nouvelles idées voient dans l’autonomie du système éducatif la source de son inefficacité, de ses dysfonctionnements, tout en mettant en exergue la toute-puissance du diplôme, porteur de sélection et d’inégalités, sans qu’on sache bien comment un système autonome peut être doué d’efficience dans le monde économique. Ce renversement de perspective ne conduit pas seulement à relier plus étroitement le système éducatif et le système productif, mais à sortir la formation de son univers autonome pour en faire un attribut du travail. Valoriser « l’entreprise formatrice »[47], c’est le fin mot de la critique actuelle du diplôme.
Le travail, inscrit dans un système d’emploi dont la charpente est la division sociale du travail, source d’inégalités durables, deviendrait donc capable, par sa vertu formatrice, de compenser les inégalités dont le système éducatif est porteur (ou producteur). Comment le travail forme-t-il ? C’est une énigme que le séminaire n’a pas réussi à percer. Pour y parvenir, il faudrait, entre autres, démontrer que le captage de la puissance intellectuelle du travail par le système taylorien ne représenterait plus un obstacle à son épanouissement, que la science ne serait plus une force productive directe mise en action par un corps spécial de salariés. Cette démonstration n’est pas faite. La critique du taylorisme se contente aujourd’hui de faire reconnaître le savoir limité mis en œuvre dans tout travail, et laisse de côté l’immense savoir capté dont est dépossédée la majorité des salariés[48]. La confusion s’installe avec l’usage de concepts nomades (« compétences ») ou l’apposition d’épithètes à un même mot : initiale et continue pour formation (on peut disserter sans fin sur leur articulation), formelle, non formelle et désormais informelle pour apprentissage ou éducation. Il faudrait d’ailleurs faire une analyse des usages et des termes « éducation formelle, informelle et non formelle »[49].
Il ne s’agit pas ici de remettre en cause l’existence de savoirs acquis en dehors de l’école : heureusement qu’ils existent ! Que serait un monde où tous les savoirs ne seraient acquis que dans un système scolaire ? Mais le modèle qui surgit de l’ombre aujourd’hui pour remplacer le SDQ ne consiste-t-il pas à installer des petites écoles un peu partout, au travail, à la maison, sur son ordinateur, petites écoles et petits maîtres qui cette fois continueront à générer, « tout au long de la vie », de la sélection, des inégalités, du contrôle ?
* * *
La valeur extrinsèque du diplôme se fonde sur les hiérarchies sociales et les inégalités qu’elles engendrent. Prétendre atténuer ces hiérarchies en cassant le diplôme, c’est se tromper de cible. Rien ne prédispose l’éducation à être la source des hiérarchies sociales ou l’apparente mesure de leur étalonnage : cette réalité est une construction sociale récente, dont nous avons explicité quelques raisons plus haut. Détruire un seul côté du système (le diplôme, et son assise, la durée de formation) ne conduira pas magiquement à détruire l’autre côté. Les hiérarchies, les inégalités, les contrôles risqueront au contraire de se renforcer si, comme je le crois, diplôme et durée continueront à servir implicitement (et donc arbitrairement) de références pour classer les individus le long d’une échelle sociale.
Se met donc progressivement en place un système hybride, où l’appareil éducatif joue à contre-emploi en étant amené à ignorer son rôle social. Cette situation ne prédispose pas à l’existence de politiques éducatives dignes de ce nom. C’est pourquoi le système semble sans réaction[50] face à l’insoutenable – comme par exemple la stagnation depuis dix ans de l’accès au bac, la pauvreté de l’accès au troisième cycle universitaire, l’état, que nous avons du mal à qualifier, de l’enseignement professionnel…
C’est pourquoi une exigence s’impose à mes yeux : revenir sur la dissociation formation – certification. C’est cette porte par où les éléments de dissolution sont entrés qu’il faut fermer. Jusqu’où aller dans la nouvelle association formation – certification (par exemple, faut-il créer des diplômes spécialement pour les adultes et la formation continue) ? La discussion est ouverte.
Pour conclure, retour sur la séparation certification – formation
Ce texte a été rédigé avant la dernière séance du séminaire, le 26 janvier. Les propos tenus lors de cette séance incitent à orienter différemment la conclusion, ou plutôt à la pousser dans une direction qui n’était qu’entrevue dans une précédente rédaction. L’hypothèse que je propose en guise de conclusion est donc la suivante.
Le système hybride dont nous avons tenté de décrire la genèse, les impulsions contraires, les antinomies, les brouillages et les illusions est transitoire. A quel autre système laissera-t-il place (une fois dépassée l’illusion que le corps social peut vivre sans système) ? Les contours d’un autre modèle ont été esquissés le 26.
Ce modèle est constitué de deux réseaux éducatifs différents, fonctionnant selon des logiques opposées. Dans le premier réseau, la certification (incluant référentiel et programme de formation) est construite centralement et est imposée comme une norme à tout établissement de formation et à toute instance d’évaluation. Ce système est piloté au plan national. Le second réseau est organisé selon le principe de l’accréditation. L’organisme de formation compose lui-même son référentiel et ses programmes, il évalue lui-même les apprenants à qui il distribue un titre dont la valeur est garantie par l’accréditation de l’organisme (par l’Etat pour l’instant en France). Ce réseau est piloté localement. Ainsi, avec cette dernière séance, nous revenons à l’analyse critique développée par Annie Vinokur lors de l’ouverture du séminaire à propos de l’introduction de l’assurance qualité dans l’enseignement[51].
Dans ce nouveau système, la frontière se déplace : la coupure n’est plus entre certification et formation, qui n’a plus de sens ici (puisque c’est l’organisme de formation qui certifie), mais entre le référentiel de produit et la valeur de ce dernier. L’accréditation porte sur l’aptitude de l’organisme à fabriquer un produit, non sur le produit lui-même. Valeurs extrinsèque et intrinsèque du produit (la certification) se confondent : c’est du moins ce qu’impose le système, mais il n’est pas certain que cela fonctionne. Cette incertitude est d’ailleurs bien perçue par les acteurs du nouveau système. En effet, quelle garantie pourra-t-on avoir que la certification ainsi produite aura une valeur économique ? La réponse proposée nous ramène curieusement un siècle en arrière : la garantie sera fournie par la collaboration étroite avec les acteurs économiques locaux.
Pourtant un problème demeure. Au-delà de l’accréditation d’établissement ou de l’accréditation de programme, où est, pour les multiples « crédits » qui circuleront (les petites attestations qui voudront accéder au statut de monnaie), ou est le « prêteur en dernier ressort » ? La seule réponse apportée pour l’instant est d’élever d’un cran l’accréditation, et d’organiser un marché d’agences qui accréditent les agences chargées de l’accréditation, comme Vinokur l’a montré au séminaire.
Le système dual esquissé le 26 vient après plusieurs années d’évolution décrite dans ce papier, où le système éducatif a peu à peu pris en charge l’objectif de qualifier la main-d’œuvre juvénile (pour l’essentiel), voire de faciliter ou d’organiser son insertion, se soumettant ainsi plus directement à la division sociale du travail. Certes, auparavant la division du travail était reflétée dans le système avec l’organisation de filières différentes et hiérarchisées, mais avec de multiples passerelles, des paliers d’orientation sans cesse repoussés, une présence importante de l’enseignement générale y compris dans les formations professionnelles courtes, etc. Mais l’organisation d’un enseignement socialisé, de masse et gratuit (jusqu’à un certain point) permettait de desserrer l’étreinte de la division sociale du travail et d’entrer même en contradiction avec elle[52]. Avec le système dual, la soumission à la division du travail devient directe, réelle : les deux parties du système seront étanches, ne formeront ni les mêmes personnes, ni aux mêmes fonctions. Nous avons compris le 26 qu’un autre système dual fonctionnait (exception française) à l’intérieur même du système de l’accréditation, avec d’un côté les Grandes Ecoles, qui ont le droit de développer et de transmettre la science dans ses diverses disciplines, qui prétendent organiser la recherche, et de l’autre l’Université vouée à proposer des enseignements professionnalisés construits avec les employeurs du coin.
Dans cette partie du système, la qualification n’a plus de sens, parce que le salaire même (celui des cadres et des professions hautement qualifiées) n’est qu’une pure convention, qui n’a plus guère de lien avec la réalité du poste ni avec les éléments qui composent habituellement la rémunération[53].
Nous sommes loin de la problématique du SDQ. L’enjeu est tout autre, illustré par les innombrables initiatives des Universités pour « faire entrer en synergie » à un niveau territorial (mais « de dimension européenne »…) les PRES (pôles de recherche et d’enseignement supérieur) et les pôles industriels de compétitivité. L’enjeu est le suivant : qui va maîtriser l’organisation de la science et la disposition de ses résultats ? Comment vont être formées et comment vont circuler les personnes attachées à la fonction de production, de développement et d’application de la science ? La réponse esquissée le 26 va très loin, puisqu’elle propose que deux systèmes fonctionnent séparément, selon des logiques et des normes différentes, l’un destiné à préparer les travailleurs scientifiques, l’autre les employés qui auront, moins que jamais, accès à la science[54].
Pour conclure, je voudrais ouvrir sur un autre débat. Car la description des avatars du système hybride ne nous conduit qu’à mi-chemin dans la compréhension de la fonction sociale de l’institution éducative. La question est la suivante : comment le système éducatif a-t-il pu se soumettre aussi facilement aux impératifs de qualification et d’insertion ? Répondre à cette question nécessite d’analyser le fonctionnement interne de ce système et la raison pédagogique qui y est à l’œuvre : le séminaire doit-il s’interdire de creuser ce sillon sous prétexte que certification et formation sont séparées[55] ?
__________________________________________
- Formation Emploi n°79, juillet-septembre 2002 ↑
- Emmanuel Dockès, Le stroboscope législatif, Droit social n° 9/10, septembre-octobre 2005 ↑
- Valeur économique, la seule prise en compte aujourd’hui. ↑
- Il s’agit de la mobilité sociale mesurée indépendamment des transformations de la structure sociale. Voir Marie Durut-Bellat : « L’ouverture du système scolaire ne débouche pas mécaniquement sur davantage de mobilité sociale, et les évolutions de la structure des emplois importent bien plus que la diffusion de l’éducation », in L’inflation scolaire, les désillusions de la méritocratie, Seuil, 2006, page 18. ↑
- Depuis le début des années 80, la certification (c’est-à-dire le diplôme ou tout espèce de certificat) doit être déconnectée de la formation. Ce modèle, d’abord apparu dans l’enseignement professionnel, s’étend désormais à toutes les certifications. Celles-ci sont d’abord définis par un référentiel, renvoyant d’une part à l’activité professionnelle visée, d’autre part aux compétences et connaissances nécessaires à l’acquisition du diplôme. En théorie, le diplôme, comme toute certification, n’est donc plus lié à une formation, c’est-à-dire à un programme scolaire et à une durée d’études (note de 2023). ↑
- Ainsi se sont constituées des chaînes causales admises sans examen : tels individus sont chômeurs parce qu’ils sont sans diplômes, tels jeunes ne réussissent pas à l’école parce qu’ils sont issus de famille modeste ou immigrée… ↑
- Voir par exemple le rapport Cahuc-Kramartz, De la précarité à la mobilité : Vers une sécurité sociale professionnelle, 2004. Mais avant lui, le rapport Boissonnat (Le travail dans vingt ans, 1995) avait proposé un « contrat d’activité », et le rapport Supiot (Au-delà de l’emploi, 1999) un « statut professionnel ». Il faudrait aussi faire le lien avec la proposition d’un « revenu d’existence » ou d’une « allocation universelle », qui tire sa source des idées avancées par Milton Friedman dans les années 60 avec l’impôt négatif. Je sais que la CGT, ATTAC, et autres cherchent à se démarquer du très libéral Friedman, mais je constate que le point commun de ces diverses propositions vise à obtenir que le revenu soit dissocié de l’emploi, et donc du salaire, ce qui a pour conséquence d’affaiblir ce qui constitue le résultat le plus brillant des luttes sociales depuis deux siècles, le salaire socialisé. ↑
- Interview au journal VACARME, octobre 2005, voir http://www.vacarme.eu.org/article481.html ↑
- Dans un livre récent, Syndicats : lendemains de crise ? (Gallimard Folio, 2005), Jean-Marie Pernot note qu’en France la tendance est à la décentralisation de la négociation collective, alors que les syndicats européens continentaux, plus rompus aux usages de la négociation, ont dépensé toute leur énergie à maintenir le cadre de la branche (page 179). ↑
- Voir par exemple : La puissance du salariat, emploi et protection sociale à la française, La Dispute, 1998. ↑
- Bernard Friot, op. cit., page 47. ↑
- La contradiction du rapport salarial et ses développements sont fort bien analysés dans un texte d’Alain Mounier (2001), traduit par Bernard Fourcade, The Three Logics of Skills, doc. ronéo. ↑
- Les critères classants ne renvoient pas à la personne, mais au poste : ils définissent le niveau des connaissances requises pour occuper le poste (note de 2003). ↑
- La mise en avant des résultats d’apprentissage est commode car il est impossible de les classer dans une nomenclature de niveaux. Les mésaventures du projet européen de nomenclature dit EQF en témoignent (voir plus loin). Un classement ne peut prendre en compte que les durées de formation. Les employeurs jouent sur cette différence lorsqu’ils refusent d’affecter un niveau aux CQP (certifications de qualification professionnelle délivrées par les branches). (Depuis lors, une nouvelle nomenclature liée à l’Europe est en usage, qui, dans les premiers niveaux de qualification, ne renvoie plus à une durée de formation : le patronat… a donc décidé que l’on peut affecter un niveau aux CQP – note de 2023). ↑
- Nous sommes bien en présence d’une hiérarchie sociale et non technique, c’est pourquoi, contrairement aux apparences, c’est le salaire qui définit les niveaux de qualifications, et non l’inverse (voir Mounier, op.cit.) ↑
- Dans son dernier ouvrage, L’inflation scolaire, Marie Duru-Bellat passe en revue les divers courants qui attribuent au diplôme une efficacité économique. ↑
- Marx note que, dans le rapport salarial, ce qui est considéré comme « capital », c’est l’interruption de travail du salarié ; ce sont ses heures de sommeils qui lui permettent de recommencer son échange avec le capital (voir par exemple Grundrisse, Pléiade, tome II, page 243). ↑
- Cet appel à la limitation de l’éducation se retrouve derrière tous les propos actuels sur « l’inflation des diplômes » ou le « déclassement ». ↑
- Ce thème récurrent est analysé tout au long de son ouvrage Histoire des diplômes de l’enseignement technique et professionnel – 1880-1965, Belin, 1998. ↑
- Voir l’accord prolongeant l’ANI. ↑
- Voir note 14. ↑
- Les années 80 ont apporté, ici comme ailleurs, leur précieuse contribution à ce système clos et irrationnel, en faisant de la rente foncière (une catégorie issue de la féodalité) l’instrument principal de répartition des jeunes enfants dans le système scolaire, et du loyer un élément de régulation plus puissant que les politiques éducatives. ↑
- « Nous sommes à notre manière une « banque centrale » », in La construction de la certification, journées de travail DESCO-CEREQ, Paris, 13-14 septembre 2001, page 10. ↑
- F. Maillard (notamment dans son mémoire de HDR) montre comment la possession du diplôme s’est imposée comme une norme sociale. Elle en montre les conséquences, en particulier dans la contradiction désormais établie qui veut que les « droits individuels » s’imposent par affaiblissement des « droits collectifs ». Notre propos se situe dans cette perspective. ↑
- Voir par exemple Le Normal et le pathologique. Le souhait de conformer la santé à des critères prédictifs ou à des normes extérieures conduit vite à l’eugénisme. ↑
- Christian Baudelot et François Leclercq (dir.), Les effets de l’éducation, La Documentation française. ↑
- Marguerite Duras, op. cit., Folio, page 56. ↑
- Puisque c’est elle qui nous saisit. ↑
- Ainsi l’enfant parle-t-il d’abord de lui à la troisième personne ; ce n’est qu’une fois qu’il a compris son inscription dans l’impersonnel qu’il peut dire « je ». « Je est un autre » lance Rimbaud en pleine Commune de Paris (lettre à Paul Demeny du 15 mai 1871). ↑
- Cité par Jean-Pierre Le Goff, Le mythe de l’entreprise, La Découverte 1992. ↑
- Ecole, de schola qui veut dire « loisir ». Quant au lycée, il désigne un lieu hors d’Athènes, Lukeion, « lieu où il y a des loups »… ↑
- Nous nous intéressons ici à certains aspects contradictoires de l’éviction de la formation. Sur la dissociation certification – formation et ses conséquences, voir les analyses de Fabienne Maillard, présentées au début du séminaire et lors de la séance 3 du 17 mars 2005, ainsi que dans ses diverses publications. F. Maillard a par ailleurs montré que, contrairement à ce qu’affirment maintes critiques, les diplômes ne sont pas de simples « attestations de savoirs pratiques ». C’est bien pourquoi il faut étudier le mouvement qui conduira à dissoudre le diplôme dans l’attestation. ↑
- Christian Baudelot et François Leclercq (dir.), op. cit., page 117. ↑
- Voir l’ouvrage de Suzanne de Brunhoff, Etat et capital, La Découverte, 1982. De Brunhoff y montre que le maintien de la continuité du circuit économique capitaliste passe par l’Etat, par la gestion étatique et de la monnaie, et de la force de travail. ↑
- La place du diplôme y est parfois ambivalente. Ainsi, la convention collective Hôtels, cafés, restaurants précise : « la référence aux diplômes ne signifie pas l’exigence de la possession des diplômes mais l’exigence de l’acquisition effective et donc contrôlable des connaissances équivalentes ». D’un côté le diplôme est amoindri, mais de l’autre, il devient l’étalon d’un niveau de connaissances. Il devient ainsi conforme à son concept, qui est de condenser une durée de formation. ↑
- Voir par exemple La mise en équivalence de la formation avec l’emploi dans les IVe et Ve Plans (1962-1970), Revue française de sociologie, 43-4, 2002. ↑
- En 1995, avec François Bayrou, le MEN s’est appelé Ministère de l’insertion professionnelle. ↑
- Le problème est que le système veut continuer à classer, à étalonner, mais il a perdu son unité de mesure. On verra plus loin comment tout cela fonctionne de manière bancale et non sans dissimulation. ↑
- Shakespeare, Beaucoup de bruit pour rien, acte III ; scène 3. ↑
- L’essentiel est bien l’autonomie, et non la forme de l’apprentissage : celle-ci pouvait être très élaborée, voire « scolaire », dans certaines corporations. Mais tant qu’il restait intégré à l’activité de travail, nul besoin du système de la qualification et du diplôme, et, nul besoin par exemple d’un centre d’études et de recherches sur la qualification, ou d’une mission Etudes au MEN. ↑
- Voir Jean Saglio, Hiérarchies salariales et négociations de classification, France 1900-1950, in Travail et Emploi n° 27, mars 1986, pages 7-19. ↑
- Claude Dubar et Pierre Tripier, Sociologie des professions, Armand Colin, 1998, page 143. ↑
- On pourrait pointer aussi le retour progressif du « métier », sans doute parce que le métier permet d’échapper à la hiérarchie du salariat en niveaux : voir Dubar – Tripier, op. cit. ↑
- Aidés par le système ECVET de la Commission européenne (European Credit system for vocational Education & training). (Depuis la loi du 5 septembre 2018, tous les diplômes sont découpés en « bloc de compétences ». Cette approche modulaire de l’apprentissage et de la certification conduira tôt ou tard à composer un jeu de lego qui sera plus aisé à utiliser par le marché – note de 2023). ↑
- Les difficultés de la réorganisation des relations entre l’individu et le collectif à travers la « démarche compétence » sont maintenant bien connues. Voir Damien Brochier (coord.), La gestion des compétences, acteurs et pratiques, Economica, 2002. Par ailleurs, selon l’enquête REPONSE de la DARES, très peu d’entreprises ont mis en place réellement la « gestion par les compétences ». ↑
- Les inégalités de revenus et les « inégalités des capacités » engendrent des inégalités de niveaux de formation. ↑
- Henri de Navacelle, dans une interview récente au Centre Inffo dont je n’ai pas retrouvé la référence, a pourtant rappelé que l’entreprise n’était pas formatrice. ↑
- Les travaux sur la VAE de l’équipe de Clot, Prot et Cie sont essentiels à cet égard, pour comprendre la différence entre les types de connaissance et ses conséquences sur les relations entre diplôme et expérience. ↑
- Voir par exemple les définitions proposées par l’UNESO, l’OCDE, la CE, qui ne paraissent pas identiques. ↑
- En dehors de la mise en place de numéros verts pour appeler le psychologue, le juge ou le policier du coin. ↑
- Voir Annie Vinokur, Mesure de la qualité des services d’enseignement et restructuration des secteurs éducatifs, in Cahiers de la recherche sur l’éducation et les savoirs, hors-série n°1, 2005, pp. 88-108. ↑
- C’est cette contradiction qui s’exprime si clairement dans les discours déplorant le déclassement : la « production » du système éducatif va trop loin et ne rentre pas dans les étroites limites de la division du travail. ↑
- Marx avait déjà souligné que dans un univers social hautement hiérarchisé, la notion de travail qualifiée était très mouvante et conventionnelle. Voir par exemple : « La distinction entre le travail complexe et le travail simple (skilled and unskilled labour) repose souvent sur de pures illusions, ou du moins sur des différences qui ne possèdent depuis longtemps aucune réalité et ne vivent plus que par une convention traditionnelle ». Le Capital, livre I, tome I, Editions sociales 1950, page 197. ↑
- La fonction sociale de l’institution éducative deviendra un enjeu considérable dans les années qui viennent. Les Etats qui sont dirigés par des libéraux sans être pour autant prisonniers de l’idéologie libérale l’ont bien compris, qui investissent à nouveau des sommes énormes pour le développement de la science mais aussi du système éducatif public (USA, GB). Mais l’école d’aujourd’hui, comme le système productif de son côté, forment une base très étriquée au regard des possibilités du développement de la science, l’une parce qu’elle est divisée en filières qui privent une masse importante de jeunes de l’accès à la science, l’autre parce que la science y est avant tout incorporée dans un système de machines, et non accaparée par le travail vivant. Malgré tout au siècle dernier, l’Ecole, parce qu’elle entre peu ou prou en contact avec le flux incessant et lumineux des connaissances, avait su dépasser les objectifs étroits que la division sociale du travail pouvait lui assigner. Les filières les plus professionnalisées dépassaient l’idiotisme du métier par la « culture générale » selon le fameux principe : « former des producteurs et des citoyens ». Saura-t-elle dans le siècle présent trouver les mêmes ressources pour dépasser les étroites exigences de « l’ordre certificatoire » (F. Maillard) et ouvrir les portes de la science à la masse des jeunes et des adultes ? ↑
- Je termine aussi sur cette interrogation afin que le lecteur ne conclue pas que plaider pour une association entre certification et formation supposerait de se satisfaire du fonctionnement actuel du système éducatif. La critique molle du diplôme pointée plus haut ne permet pas d’aller très loin dans l’analyse des failles de ce système. La réflexion la plus utile que j’ai trouvée récemment vient d’un livre réédité par Jacques Rancière, Le maître ignorant. Rancière y montre que le même axiome gouverne le système social et le système éducatif, l’axiome inégalitaire. Mais le propre du système éducatif est de se fixer comme but l’égalité, y compris l’égalité sociale, que le pouvoir fantasmatique attribué à l’école aurait la possibilité de réaliser. S’appuyant sur l’expérience de Jacotot, ce maître qui, dans les années 1820, enseignait ce qu’il ignorait avec une efficacité qui porterait au rouge les circuits d’évaluation de la DEP, Rancière montre que l’axiome de l’inégalité des intelligences (le maître sait, l’élève est ignorant, le savoir passe de l’un à l’autre) conduit à une pédagogie qui vise la réduction de l’inégalité sans jamais y parvenir, dans une progression scolaire qui « est aussi l’art de limiter la transmission du savoir, d’organiser le retard, de différer l’égalité ». Dans le droit fil de la philosophie du droit naturel, Jacotot-Rancière estiment que l’égalité n’est pas un but à atteindre (à partir d’une situation inégalitaire), mais qu’elle est le point de départ (l’égalité des intelligences). Il s’agit au fond non d’une question de méthodes pédagogiques, mais d’une question philosophique et politique : la parole du maître est-elle un témoignage d’égalité ou d’inégalité ? Instruire, est-ce confirmer une incapacité ou forcer une capacité à se reconnaître ? Où l’on retrouve pour finir le petit Ernesto… ↑